

L’expression relations de travail — ou relations professionnelles — désigne le système dans lequel les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, ainsi que le gouvernement par voie directe ou indirecte, échangent leurs points de vue et conjuguent leurs efforts pour fixer les règles de base de la conduite des relations de travail. Cette expression désigne aussi un champ de recherche voué à l’étude de ces relations. Il s’agit d’un legs de la révolution industrielle, dont les excès ont conduit à l’émergence de syndicats pour représenter les travailleurs et au développement de régimes collectifs de relations professionnelles. Tout système de relations de travail ou de relations professionnelles est à l’image des interactions entre ses principaux acteurs: l’Etat, l’employeur (ou des employeurs ou une association d’employeurs), les syndicats et les travailleurs (qui peuvent adhérer ou non aux syndicats et à d’autres organismes se proposant de les représenter). Les expressions «relations de travail» et «relations professionnelles» sont également employées à propos de diverses formes de participation des travailleurs; elles peuvent aussi englober la relation individuelle d’emploi entre un employeur et un travailleur aux termes d’un contrat de travail écrit ou tacite, bien que cette relation soit habituellement qualifiée de «relation d’emploi». L’usage de ces expressions varie considérablement selon les époques et les endroits et reflète en partie l’évolution qui caractérise ce domaine. Toutefois, on convient généralement qu’elles comprennent la négociation collective, diverses formes de participation des travailleurs (comme les comités d’entreprise et les comités d’hygiène et de sécurité) et les mécanismes de règlement des différends collectifs et individuels. La grande diversité des systèmes de relations professionnelles dans le monde suppose d’assortir les analyses comparatives et les classifications de certaines mises en garde au sujet des risques de généralisation et d’analogies trompeuses. Traditionnellement, on distingue quatre types de gestion en milieu de travail: dictatoriale, paternaliste, institutionnelle, participative; ce chapitre traite principalement des deux derniers types.
Tout système de relations professionnelles met en jeu des intérêts à la fois privés et publics. L’Etat en est également partie prenante, mais son rôle va de l’interventionnisme à la passivité selon les pays. La nature des rapports entre le monde syndical, le patronat et le gouvernement en matière de sécurité et de santé est révélatrice de la situation globale des relations professionnelles dans un pays, une branche d’activité, et vice versa. Un système de relations professionnelles sous-développé tend à l’autoritarisme, l’employeur dictant des règles sans la participation directe ou indirecte des salariés qui se bornent à accepter un emploi aux conditions offertes.
Tout système de relations professionnelles comporte à la fois des valeurs de société (liberté syndicale, sens de la solidarité au sein du groupe, recherche du profit maximum) et diverses techniques (méthodes de négociation, organisation du travail, consultation et règlement des différends). Par tradition, les systèmes de relations professionnelles sont classés par modèles nationaux, mais la validité de cette façon de voir s’estompe devant la diversité de plus en plus marquée des pratiques dans les pays et la montée en puissance d’une économie mondiale, aiguillonnée par la concurrence internationale. Certains pays sont connus pour avoir des modèles de relations professionnelles de type coopératif (Allemagne, Belgique), tandis que d’autres ont des modèles qualifiés de conflictuels (Bangladesh, Canada, Etats-Unis). Divers systèmes ont également fait l’objet d’une distinction sur la base de leur régime centralisé de négociation collective (par exemple, les pays nordiques, bien qu’ils tendent à s’en éloigner, comme on le voit en Suède), la négociation par branche sectorielle ou industrielle (Allemagne), ou la négociation par entreprise ou par établissement (Etats-Unis, Japon). Dans les pays qui sont passés d’une économie planifiée à une économie de marché, les systèmes de relations professionnelles sont en période de transition. Par ailleurs, de plus en plus d’études analytiques portent sur la typologie des relations individuelles d’emploi en tant qu’indicateurs des types de systèmes de relations professionnelles.
Même les descriptions classiques des systèmes de relations professionnelles ne sont pas du tout figées, car ces systèmes évoluent et s’adaptent aux nouvelles situations, qu’elles soient d’ordre économique ou politique. La mondialisation de l’économie de marché, l’affaiblissement de l’Etat en tant que réelle force agissante et le déclin du pouvoir syndical dans bon nombre de pays industrialisés constituent autant de sérieux défis lancés aux systèmes traditionnels de relations professionnelles. Le progrès technologique a modifié le contenu des tâches et l’organisation du travail; ces changements, en retour, influent profondément sur la capacité d’épanouissement des régimes collectifs de relations professionnelles et sur leur orientation. Le schéma traditionnel — horaires de travail communs pour tous les salariés dans un même lieu — cède graduellement la place à des horaires plus variés et à l’exécution décentralisée des tâches en divers endroits, y compris à domicile, avec moins de surveillance directe de la part de l’employeur. Les relations d’emploi dites «atypiques» méritent de moins en moins ce qualificatif puisque les effectifs de la main-d’œuvre précaire ou occasionnelle continuent de grossir. Par ricochet, cette situation exerce une pression sur les systèmes établis de relations professionnelles.
Des formes nouvelles de représentation et de participation des salariés sont en train de donner une dimension supplémentaire au tableau des relations professionnelles dans un certain nombre de pays. Tout système de relations professionnelles établit les règles de base, formelles ou non, qui déterminent la nature des régimes collectifs de relations professionnelles, ainsi que le cadre de la relation d’emploi individuelle entre un travailleur et son employeur. Du côté patronal, de nouveaux acteurs viennent compliquer la situation, notamment les bureaux de placement temporaire ou agences d’intérim et les sous-traitants fournisseurs de main-d’œuvre qui peuvent avoir des responsabilités envers des travailleurs sans exercer pour autant de contrôle sur les conditions d’exécution du travail, ou sans avoir la possibilité d’assurer la formation à la sécurité. De plus, les employeurs des secteurs public et privé sont régis par une réglementation distincte dans la plupart des pays; il existe souvent des écarts considérables entre ces deux secteurs pour ce qui est des droits et de la protection des salariés. En outre, le secteur privé est exposé à la concurrence internationale, qui n’influe pas directement sur les relations professionnelles dans le secteur public.
Enfin, l’idéologie néolibérale, qui privilégie la conclusion de contrats d’emploi individuel au détriment des conventions collectives, constitue une autre menace pour les systèmes traditionnels de relations professionnelles. Ces systèmes sont nés de l’émergence de la représentation collective des travailleurs, le passé ayant démontré qu’isolés, ceux-ci sont en position de faiblesse par rapport à l’employeur. L’abandon de toute représentation collective risquerait de rétablir une notion largement répandue au XIXe siècle selon laquelle chaque personne est libre d’accepter un travail dangereux, et que c’est là une question de libre arbitre. La mondialisation croissante de l’économie, le rythme accéléré des changements technologiques et, partant, l’appel à une flexibilité accrue des institutions de relations professionnelles lancent à ces dernières de nouveaux défis dont dépendent leur survie et leur prospérité. En fonction de leurs traditions et de leurs institutions actuelles, les parties à un système de relations de travail peuvent réagir très différemment à des pressions identiques, exactement comme les gestionnaires peuvent choisir une stratégie établie en fonction des coûts ou, plutôt, une stratégie axée sur la valeur ajoutée pour affronter une concurrence accrue (Locke, Kochan et Piore, 1995). Le degré de participation des travailleurs ou le rôle de la négociation collective dans un système de relations professionnelles influe sans aucun doute sur l’approche des gestionnaires face aux problèmes de sécurité et de santé dans l’entreprise.
Par ailleurs, une autre constante demeure, celle de la dépendance économique du travailleur individuel par rapport à l’employeur; cette réalité qui sous-tend leur relation comporte de graves conséquences potentielles en matière de sécurité et de santé. On considère que l’employeur a l’obligation générale de garantir un milieu de travail sûr et salubre, de former son personnel et de lui fournir l’équipement nécessaire pour qu’il puisse effectuer son travail en sécurité. Réciproquement, il incombe au travailleur de se conformer aux règles de sécurité et de santé et d’éviter de se blesser ou de blesser autrui dans l’accomplissement de ses fonctions. Tout manquement à ces obligations ou à d’autres prescriptions peut aboutir à des conflits, dont le règlement repose sur le système de relations professionnelles. Les mécanismes de règlement des différends comprennent les règles qui régissent non seulement les arrêts de travail (grèves, ralentissements de travail ou grèves perlées, grèves du zèle, etc.) et les lock-out, mais encore les mesures disciplinaires et le licenciement des salariés. De plus, dans de nombreux pays, les employeurs sont tenus de cotiser à divers organismes de prévention, d’assurer la surveillance de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles et, indirectement, d’indemniser les travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
La gestion des ressources humaines est définie comme «la science théorique et pratique qui traite de la nature de la relation d’emploi et de la totalité des décisions, actions et enjeux qui ont trait à cette relation» (Ferris, Rosen et Barnum, 1995; voir figure 21.1). Elle englobe les politiques et les pratiques formulées par l’employeur qui envisagent l’utilisation et l’administration du personnel comme une ressource commerciale dans la stratégie globale de l’entreprise visant à améliorer la productivité et la compétitivité. Cette expression est fréquemment employée pour désigner une conception de l’administration du personnel qui met l’accent sur la participation des salariés, normalement dans une organisation non syndiquée (mais pas toujours), afin d’encourager les travailleurs à améliorer leur productivité. Cette discipline, qui a vu le jour à l’époque de la première guerre mondiale, s’est constituée à partir de la convergence des théories scientifiques sur la gestion, des travaux portant sur l’assistance sociale et la psychologie du travail; elle a considérablement évolué depuis lors. Actuellement, elle met en valeur les techniques d’organisation du travail, les méthodes de recrutement et de sélection du personnel, l’évaluation du rendement, la formation, le perfectionnement professionnel et l’organisation des carrières, ainsi que la participation directe du personnel et la communication. La gestion des ressources humaines est présentée comme une solution de rechange au «fordisme», le type classique de la production à la chaîne où les ingénieurs sont chargés de l’organisation du travail et où les tâches assignées aux travailleurs sont fractionnées et étroitement délimitées. Les formes courantes de participation du personnel comprennent des systèmes d’incitation à l’initiative et aux suggestions, des enquêtes sur les attitudes, des programmes de valorisation du travail, le travail en équipe et d’autres formes de responsabilisation du même ordre, des programmes de qualité de la vie au travail, des cercles de qualité et des groupes de travail spéciaux. Le cas échéant, une autre caractéristique de la gestion des ressources humaines consiste à lier, individuellement ou collectivement, le salaire au rendement. Signalons que l’un des trois objectifs définis par le Comité mixte OIT/OMS de la santé au travail est «l’adoption de systèmes d’organisation du travail et de cultures d’entreprise susceptibles de contribuer à la sécurité et à la santé au travail et de promouvoir un climat social positif et le bon fonctionnement de l’entreprise» (BIT, 1995b). C’est ce que l’on appelle la recherche d’une «culture de la sécurité» dans l’entreprise.
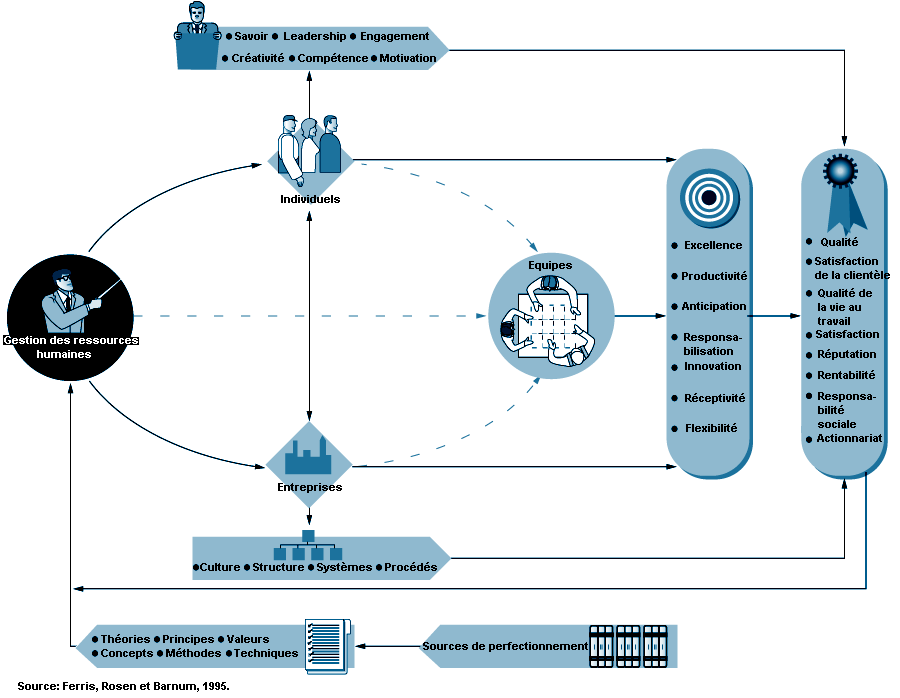
L’exemple d’un programme de gestion de la sécurité au travail illustre certaines théories de la gestion des ressources humaines sur le plan de la sécurité et de la santé des travailleurs. Comme l’ont expliqué Reber, Wallin et Duhon (1993), cette approche a beaucoup contribué à la diminution des absences dues aux accidents. Elle consiste à déterminer quels sont les comportements sûrs et les comportements dangereux, à enseigner aux salariés à les reconnaître et à encourager ceux-ci à observer les règles de sécurité en leur fixant des objectifs et en les informant des résultats. Le programme fait largement appel à une technique de formation consistant à montrer aux travailleurs les méthodes sûres et correctes par des montages vidéo ou des démonstrations. Ils ont alors la possibilité de s’exercer afin de changer de comportement et sont régulièrement informés des résultats. De plus, certaines entreprises décernent des prix et des récompenses aux salariés qui adoptent un comportement respectueux de la sécurité et y participent activement (au lieu de se contenter d’avoir moins d’accidents). La consultation du personnel est aussi un élément important du programme.
Les répercussions de la gestion des ressources humaines sur la pratique des relations professionnelles continuent de prêter à controverse. C’est particulièrement vrai des programmes de participation du personnel qui sont perçus par les syndicats comme une menace. Dans certains cas, des stratégies de gestion des ressources humaines sont menées parallèlement à la négociation collective; dans d’autres, la gestion des ressources humaines s’inscrit dans une perspective visant à supplanter ou à entraver les activités des organisations indépendantes qui défendent les intérêts des travailleurs. Des partisans de la gestion des ressources humaines soutiennent que, depuis les années soixante-dix, la fonction de gestion du personnel dans la gestion des ressources humaines a évolué; autrefois simple soutien des relations professionnelles, elle occupe maintenant une place de premier plan qui revêt une importance cruciale pour l’efficacité d’une organisation (Ferris, Rosen et Barnum, 1995). La gestion des ressources humaines étant un outil à la disposition de la direction pour mener sa politique de personnel plutôt qu’un élément de rapprochement entre l’employeur et les représentants choisis par les salariés, elle n’occupe pas une place prépondérante dans le présent chapitre.
Les articles de ce chapitre décrivent les principales parties à un système de relations professionnelles et les principes fondamentaux qui en charpentent l’interaction: la liberté syndicale et le droit de représentation. Le corollaire naturel de la liberté syndicale est le droit de mener des négociations collectives, phénomène qu’il faut distinguer des arrangements concernant la consultation et la participation des travailleurs non syndiqués. La négociation collective a lieu entre les représentants choisis par les travailleurs et ceux de l’employeur; elle aboutit à une convention conclue d’un commun accord et liant les deux parties et peut porter sur une gamme étendue de sujets. D’autres formes de participation des travailleurs, les organismes consultatifs au niveau national, les comités d’entreprise et les délégués à la sécurité et à la santé dans l’entreprise sont également des éléments importants de certains systèmes de relations professionnelles; ils sont donc étudiés dans ce chapitre. La consultation peut prendre diverses formes et se dérouler à différents niveaux: national, régional, branche d’activité, entreprise. Les représentants du personnel qui siègent aux organismes consultatifs peuvent avoir été choisis ou non par les travailleurs, et rien n’oblige l’Etat ou l’employeur à donner suite aux souhaits exprimés par ces représentants ou à se plier aux résultats de la consultation. Dans certains pays, la négociation collective et la consultation coexistent, mais elles ne peuvent alors fonctionner convenablement que si l’on a pris soin d’en harmoniser les dispositifs. Dans les deux cas, le droit à l’information en matière de sécurité et de santé et le droit à la formation revêtent une importance cruciale. Enfin, ce chapitre tient compte du fait que, dans tout système de relations professionnelles, des différends peuvent survenir, qu’ils soient individuels ou collectifs. Les questions de sécurité et de santé peuvent mener à un conflit en matière de relations professionnelles et entraîner des arrêts de travail. Après une analyse du rôle de l’inspection du travail dans les relations professionnelles, le chapitre se termine par la description des modes de règlement des différends en matière de relations professionnelles, dont l’arbitrage, la médiation ou le recours aux tribunaux ordinaires ou aux juridictions du travail.
On identifie habituellement trois acteurs en tant que parties à un système de relations professionnelles: l’Etat, les employeurs et les représentants des travailleurs. Il faut maintenant y ajouter les forces qui dépassent ces catégories: les accords d’intégration économique régionaux, multilatéraux et autres passés par les Etats et les multinationales en tant qu’employeurs qui n’ont pas une identité nationale, mais peuvent être considérées comme des institutions du marché du travail. L’impact de ces phénomènes sur les relations professionnelles étant encore mal connu à bien des égards, l’analyse portera surtout sur les acteurs traditionnels, en gardant à l’esprit les limites d’une telle démarche dans une société de plus en plus mondialisée. En outre, il faudrait affiner l’analyse du rôle de la relation d’emploi individuel dans les systèmes de relations professionnelles et l’impact des nouvelles formes de travail.
Depuis toujours, l’Etat a exercé une action sur l’ensemble des relations professionnelles, fût-ce indirectement. Source de la législation, il influence inévitablement l’apparition et le développement de tout système de relations professionnelles. Les lois peuvent entraver ou faciliter, directement ou indirectement, la création d’organisations représentant les travailleurs et les employeurs. La législation établit aussi un niveau minimal de protection des travailleurs et fixe «les règles du jeu». Par exemple, elle peut accorder une protection plus ou moins grande aux délégués à la sécurité et à la santé, ou aux salariés qui refusent d’exécuter un travail qu’ils ont des motifs valables de considérer comme trop dangereux.
Par l’orientation qu’il imprime à son administration du travail, l’Etat pèse aussi sur le fonctionnement du système de relations professionnelles. S’il fait appliquer efficacement la loi grâce à l’inspection du travail, la négociation collective peut prendre le relais au point où s’arrête le droit. En revanche, si l’infrastructure étatique permettant de faire valoir des droits ou contribuant au règlement des différends entre employeurs et travailleurs est faible, les parties devront elles-mêmes créer d’autres institutions ou mettre au point d’autres arrangements.
L’attention que l’Etat porte à la mise en place d’un mécanisme — judiciaire ou autre — de règlement des différends peut également influer sur la tournure des relations professionnelles. La simplicité d’application des droits reconnus aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives peut se révéler tout aussi importante que les droits proprement dits. En effet, la décision d’un gouvernement de créer des juridictions spécialisées ou des instances administratives pour trancher les différends collectifs ou individuels peut signaler la priorité accordée à ces questions dans la société.
Dans de nombreux pays, l’Etat joue un rôle direct dans les relations professionnelles. Dans les pays qui ne respectent pas les principes de la liberté syndicale, ce rôle risque de se résumer à dominer purement et simplement les organisations d’employeurs et de travailleurs ou à s’ingérer dans leurs activités. L’Etat peut tenter d’invalider les conventions collectives quand il y voit un obstacle à ses objectifs de politique économique. Il faut toutefois admettre qu’en règle générale le rôle de l’Etat dans les pays industriels tend à promouvoir des relations professionnelles ordonnées en établissant le cadre législatif indispensable, y compris un minimum de protection pour les travailleurs et des services mis à la disposition des parties en matière d’information, de conseil et de règlement des différends. Cela peut aller de la simple acceptation des institutions de relations professionnelles et des parties prenantes à l’incitation active de ces institutions. Dans quelques pays, l’Etat participe activement au système de relations professionnelles, y compris aux négociations tripartites à l’échelle nationale. Depuis plusieurs décennies en Belgique et, plus récemment, en Irlande, les représentants gouvernementaux siègent avec ceux des milieux patronaux et syndicaux pour conclure un contrat ou pacte national portant sur une vaste gamme d’enjeux sociaux et de problèmes liés au travail. Autre exemple: le système de relations professionnelles en Argentine et au Mexique compte depuis longtemps un mécanisme tripartite de fixation du salaire minimum. L’intérêt de l’Etat à agir de la sorte réside dans sa volonté d’orienter l’économie nationale dans un certain sens et de maintenir la paix sociale pendant la durée du pacte; ces accords bi- ou tripartites créent le «dialogue social» tel qu’il est pratiqué en Australie (jusqu’en 1994), en Autriche, en Belgique, en Irlande et aux Pays-Bas, par exemple. Les avantages et les inconvénients de ce que l’on appelle l’esprit «corporatiste» ou «néocorporatiste» en matière de relations professionnelles ont été largement débattus au fil des ans. Elle-même dotée d’une structure tripartite, l’Organisation internationale du Travail prône de longue date une coopération tripartite soutenue, où les «partenaires sociaux» jouent un rôle important dans l’élaboration des politiques gouvernementales sur de nombreux sujets.
Dans certains pays, l’idée même de voir l’Etat intervenir comme négociateur dans des négociations du secteur privé est impensable; tel est le cas en Allemagne ou aux Etats-Unis. Abstraction faite de sa fonction législative, l’Etat se limite, en général, dans ce type de systèmes, à aider les parties à conclure une entente, par exemple en offrant des services volontaires de médiation. Actif ou passif, l’Etat n’en demeure pas moins un partenaire incontournable dans tout système de relations professionnelles. De plus, chaque fois qu’il est lui-même l’employeur ou qu’il s’agit d’une entreprise publique, l’Etat participe bien entendu directement aux relations professionnelles avec les salariés et leurs représentants. Dans ce contexte, la motivation de l’Etat ressortit à son rôle de prestataire de services publics ou d’acteur de la scène économique.
Enfin, l’impact des accords d’intégration économique régionaux sur les politiques de l’Etat se ressent également dans le domaine des relations professionnelles. Les Etats membres de l’Union européenne ont adapté leurs pratiques aux directives concernant la consultation des travailleurs et de leurs représentants, notamment les directives en matière de sécurité et de santé. Des accords commerciaux multilatéraux, comme l’accord de coopération dans le domaine du travail conclu dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain (Canada, Etats-Unis, Mexique) (ALENA), ou les accords relatifs à la mise en œuvre du Marché commun du cône sud (Argentine, Brésil, Chili, Paraguay, et Uruguay auxquels se joindra bientôt la Bolivie) (MERCOSUR), contiennent aussi parfois des clauses ou des dispositifs relatifs aux droits des travailleurs qui, avec le temps, peuvent avoir des répercussions indirectes sur les systèmes de relations professionnelles des signataires.
|
L’Organisation internationale des employeurs (OIE), dont le siège est à Genève, regroupait, en 1996, 118 organisations centrales nationales d’employeurs de 116 pays. La structure particulière des organisations affiliées peut différer d’un pays à un autre, mais pour pouvoir adhérer à l’OIE, elles doivent toutes satisfaire à certaines conditions: être l’organisation la plus représentative des employeurs (des employeurs exclusivement) de leur pays, être une organisation libre, entièrement indépendante, sans contrôle ou ingérence extérieurs d’aucune sorte; soutenir et défendre le principe de la libre entreprise. On trouve parmi les membres de l’OIE des fédérations et des confédérations patronales, des chambres de commerce et d’industrie, des conseils, des associations. Les organisations régionales ou sectorielles ne peuvent en faire directement partie, pas plus que des entreprises particulières, quelles que soient leur taille ou leur importance. L’OIE peut se présenter ainsi en porte-parole de l’ensemble des employeurs, et non de tel ou tel secteur ou de telle ou telle entreprise. La principale activité de l’OIE, au demeurant, est de défendre les positions patronales sur les problèmes du travail et les questions sociales au niveau international, c’est-à-dire principalement au sein de l’OIT — institution des Nations Unies chargée de ces questions — où elle a un statut consultatif. L’OIE a également le statut consultatif (catégorie I) auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, où elle intervient lors de l’examen de problèmes qui intéressent les employeurs. L’OIE est l’une des deux organisations que les entreprises ont constituées pour représenter leurs intérêts au niveau international. L’autre, dont le siège est à Paris, est la Chambre de commerce internationale, qui se préoccupe principalement des questions économiques. De structure très différente, les deux organisations se complètent. Leur coopération est régie par un accord qui définit leurs compétences respectives; elle est favorisée par les bonnes relations qu’entretiennent leurs représentants et, dans certains cas, par la présence en leur sein des mêmes organisations. Bien des questions chevauchent les mandats de l’une et de l’autre; elles sont traitées de façon pragmatique, sans nulle friction. Sur d’autres sujets, les entreprises multinationales, par exemple, les deux organisations agissent de concert. par la rédactrice de ce chapitre (texte tiré de BIT, 1994) |
Les employeurs — au sens de fournisseurs de travail — font habituellement l’objet d’une distinction dans les systèmes de relations professionnelles en fonction de leur appartenance au secteur privé ou au secteur public. D’un point de vue historique, le syndicalisme et la négociation collective ont d’abord pris leur essor dans le secteur privé, mais ces dernières années, le phénomène s’est répandu aussi dans de nombreux milieux du secteur public. La situation des entreprises appartenant à l’Etat — dont le nombre diminue de toute façon dans le monde entier — en tant qu’employeur varie selon les pays (ces entreprises continuent à jouer un rôle clé en Chine, en Inde, au Viet Nam et dans de nombreux pays africains). En Europe centrale et orientale, l’une des gageures du postcommunisme a résidé dans la constitution d’organisations indépendantes d’employeurs.
La situation dans le secteur privé se résume comme suit:
Les employeurs ont des intérêts communs à défendre, des causes précises à faire avancer. Les buts qu’ils poursuivent en constituant des organisations déterminent le caractère de celles-ci: chambres de commerce ou d’industrie, associations économiques, organisations patronales (pour les problèmes du travail et les questions sociales) [...] Pour ce qui touche au domaine social — droit du travail, négociation collective, salaires et conditions de travail, sécurité et santé au travail, mise en valeur des ressources humaines, les employeurs se regroupent, pour coordonner leur action, dans des organisations de type patronal de nature toujours volontaire [...] (BIT, 1994a).
Certaines organisations d’employeurs ont été constituées initialement en réponse à la pression exercée par les syndicats en vue de négocier, mais d’autres s’inscrivent dans le droit-fil des guildes médiévales ou autres, fondées pour défendre des intérêts commerciaux particuliers. Les organisations d’employeurs sont définies comme des associations patronales structurées dont la mission est de défendre et de représenter les employeurs affiliés, de les conseiller et d’en renforcer la position au sein de la société en général en ce qui concerne les questions de relations professionnelles, par opposition aux questions économiques [...] Contrairement aux syndicats qui sont composés d’individus, les organisations d’employeurs sont composées d’entreprises (Oechslin, 1995).
Comme l’a constaté Oechslin, trois fonctions principales (avec un certain chevauchement) sont en général communes à toutes les organisations d’employeurs: la défense et la promotion des intérêts de leurs membres, la représentation dans la structure politique et la prestation de services à leurs membres. La première fonction se traduit en grande partie par des pressions exercées sur le gouvernement pour le convaincre d’adopter des politiques favorables aux intérêts des employeurs et par des actions visant à influencer l’opinion publique, surtout au moyen de campagnes dans les médias. La fonction de représentation peut s’exercer dans la structure politique ou les institutions chargées des relations professionnelles. La représentation politique est présente dans les systèmes où la consultation des groupements d’intérêts économiques est prévue par la loi (par exemple, en Suisse), où des conseils économiques et sociaux assurent la représentation patronale (par exemple, en France, dans les pays francophones d’Afrique et aux Pays-Bas), et où il y a participation à des forums tripartites tels que la Conférence internationale du Travail et d’autres activités de l’OIT. De plus, les organisations d’employeurs peuvent exercer une influence considérable au niveau régional (en particulier dans l’Union européenne).
Le mode de représentation dans le système de relations professionnelles dépend étroitement du niveau de la négociation collective dans un pays donné. Ce facteur détermine aussi en grande partie la structure de l’organisation patronale. Si la négociation est centralisée au niveau national, cela transparaîtra dans la structure interne et le mode de fonctionnement de l’organisation patronale (banque centrale de données statistiques et économiques, création d’un système d’assurance mutuelle en cas de grève, fort sens de la discipline au sein du groupe, etc.). Même dans les pays où la négociation a lieu au niveau de l’entreprise (comme aux Etats-Unis ou au Japon), l’organisation patronale peut procurer à ses membres de l’information, des lignes directrices et des conseils. Bien entendu, la négociation sectorielle (comme en Allemagne où, cependant, certains employeurs se sont récemment dissociés de leurs associations) ou multisectorielle (comme en France ou en Italie) influe aussi sur la structure des organisations patronales.
Quant à la troisième fonction, «il n’est pas toujours facile de tracer une ligne de démarcation entre les activités de soutien des fonctions susmentionnées et celles qui sont entreprises dans l’intérêt des membres», fait observer Oechslin (1995). La recherche illustre parfaitement cette situation, car elle peut servir à des fins multiples. Dans le domaine de la sécurité et de la santé, les employeurs appartenant aux diverses branches d’activité peuvent utilement partager des données et de l’information. Souvent, des concepts nouveaux ou des réactions à des développements novateurs dans le monde du travail sont le produit d’une vaste réflexion au sein des organisations patronales. Ces groupes offrent aussi à leurs membres de la formation sur de nombreux sujets concernant le management et mènent une action sur le plan social, par exemple en favorisant la création d’habitations pour les travailleurs ou en soutenant les activités communautaires. Dans certains pays, les organisations patronales aident leurs membres en cas de saisine des tribunaux du travail.
La structure des organisations d’employeurs dépend non seulement du niveau de la négociation, mais encore de l’étendue du pays, du système politique et, parfois, des traditions religieuses. Dans les pays en développement, le défi principal réside dans l’intégration des membres qui forment un groupe très hétérogène pouvant comprendre des petites et moyennes entreprises, des sociétés d’Etat et des filiales de multinationales. La force d’une organisation patronale correspond aux ressources que ses membres sont disposés à lui consacrer, qu’il s’agisse de cotisations et de contributions, ou de savoir-faire et de temps.
La taille d’une entreprise est un facteur déterminant de l’approche en matière de relations professionnelles, l’employeur dont la main-d’œuvre est peu nombreuse étant plus susceptible de recourir à des moyens informels pour traiter avec ses travailleurs. Les petites et moyennes entreprises, dont les définitions varient, se trouvent parfois au-dessous du seuil légal qui commande la participation des travailleurs. Quand la négociation collective se situe au niveau de l’entreprise, il y a beaucoup plus de chances d’en constater l’application concrète dans les grandes entreprises; quand elle se déroule aux niveaux sectoriel ou national, ses effets se feront généralement sentir là où, historiquement, les grandes entreprises dominent le marché du secteur privé.
En tant que groupes d’intérêts, les organisations patronales — comme les syndicats — sont aux prises avec leurs propres problèmes pour ce qui est du leadership, de la prise de décisions interne et de la participation des membres. Toutefois, les employeurs ayant tendance à être individualistes, il est encore plus difficile pour les organisations patronales de maintenir la discipline parmi leurs adhérents. Comme le signale van Waarden (1995), «en général, les associations patronales comptent des ratios de densité élevés [...] Pourtant, les employeurs ont beaucoup plus de mal à se plier aux décisions et aux règlements pris par leurs associations parce que cela empiète sur la sacro-sainte liberté d’entreprise». Les tendances constatées dans la structure des organisations patronales correspondent dans une large mesure à celles du marché du travail — pour ou contre la centralisation, pour ou contre la réglementation de la concurrence. Van Waarden poursuit: «quand bien même la pression en faveur d’une flexibilité accrue se maintiendrait dans ‘l’après-fordisme’, cela ne rendrait pas pour autant les associations patronales superflues ou moins influentes [...] Elles continueront de jouer un rôle important en coulisses pour la coordination des politiques relatives au marché du travail, comme conseillères des entreprises ou des associations sectorielles qui pratiquent la négociation collective». Elles peuvent aussi assurer une fonction de solidarité; par l’entremise des associations patronales, les petits employeurs ont accès à des services de conseils ou à des services juridiques qui seraient, sinon, hors de leurs moyens.
Dans le secteur public, les employeurs ne se considèrent comme tels que depuis peu. A l’origine, les gouvernements estimaient que la syndicalisation des fonctionnaires était incompatible avec le service de l’Etat souverain. Par la suite, ils ont opposé un refus aux appels à la négociation collective, sous le prétexte que le pouvoir législatif, et non l’administration publique, était le véritable trésorier-payeur et qu’il était donc impossible à l’administration de conclure une convention. Cependant, ces arguments n’ont pas empêché des grèves (souvent illégales) de fonctionnaires dans bien des pays; ils ont été peu à peu abandonnés. En 1978, la Conférence internationale du Travail a adopté la convention (no 151) et la recommandation (no 159) sur les relations de travail dans la fonction publique, portant sur le droit des fonctionnaires de s’organiser et sur les procédures de détermination de leurs conditions d’emploi. La négociation collective dans le secteur public est à présent entrée dans les mœurs dans de nombreux pays développés (Australie, France, Royaume-Uni), ainsi que dans plusieurs pays en développement (par exemple, dans de nombreux pays francophones d’Afrique et des pays d’Amérique latine).
Le niveau de représentation de l’employeur dans le secteur public dépend en grande partie du système politique du pays. Dans certains pays, la représentation est centralisée (comme en France), tandis que dans d’autres elle correspond aux divers paliers de gouvernement (comme aux Etats-Unis où l’une des parties à la négociation peut être le gouvernement fédéral, un Etat fédéré ou une municipalité). L’Allemagne présente un cas intéressant: les milliers de collectivités locales ont formé un front commun représenté par un seul agent négociateur chargé de traiter avec les syndicats du secteur public dans tout le pays.
Les employeurs du secteur public faisant partie de l’Etat, ils ne sont pas assujettis aux lois exigeant l’enregistrement des organisations patronales. La désignation de l’agent négociateur dans le secteur public varie considérablement d’un pays à un autre; ce peut être une commission de la fonction publique, le ministère du Travail, le ministère des Finances ou n’importe quel autre organe gouvernemental. Les positions adoptées par un employeur du secteur public pour traiter avec ses employés tendent à s’aligner sur l’orientation politique du parti au pouvoir. Cela peut aller d’une prise de position donnée dans la négociation au refus catégorique d’accorder aux fonctionnaires le droit de se syndiquer. Bien que la fonction publique devienne un employeur beaucoup moins important dans de nombreux pays, on constate malgré tout une ouverture croissante de la part des gouvernements pour entreprendre des négociations et des consultations avec les représentants des salariés.
Selon la définition classique, un syndicat est «une association permanente de salariés ayant pour but de maintenir ou d’améliorer leurs conditions d’emploi» (Webb et Webb, 1920). Les origines du syndicalisme sont aussi anciennes que les premières tentatives d’action collective concertée au début de la révolution industrielle. Toutefois, le syndicalisme moderne a vu le jour vers la fin du XIXe siècle lorsque les gouvernements ont commencé à reconnaître l’existence légale des syndicats (auparavant, ceux-ci étaient perçus comme des coalitions illégales entravant la liberté du commerce, ou comme des groupes politiques hors la loi). Les syndicats incarnent la conviction que les travailleurs ne peuvent améliorer leur situation qu’en unissant leurs forces. Les droits syndicaux sont nés de luttes économiques et politiques dans lesquelles des sacrifices individuels ont été consentis dans l’immédiat au profit de gains collectifs à long terme. Les syndicats ont souvent une action importante dans la politique nationale et influent sur l’évolution du monde du travail aux niveaux régional et international. Pourtant, leurs rangs se sont clairsemés ces dernières années dans plusieurs pays (en Amérique du Nord et dans certains pays européens), et leur rôle est contesté par plusieurs observateurs (voir figure 21.2). Toutefois, il ne s’agit pas d’une tendance uniforme dans le monde entier: les effectifs syndicaux augmentent dans la fonction publique de nombreux pays et on assiste à un renouveau du syndicalisme dans des endroits où les syndicats étaient inexistants ou les activités syndicales sévèrement restreintes (par exemple, en Corée, aux Philippines, dans plusieurs pays d’Europe centrale et orientale). L’épanouissement des institutions démocratiques va de pair avec l’exercice des libertés syndicales, comme le montrent à l’évidence le Chili et la Pologne dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Dans plusieurs pays, on peut également constater un mouvement de réforme interne et de réorientation du monde syndical pour diversifier les effectifs et attirer un plus grand nombre de personnes, notamment les femmes. Seul le temps dira si ces efforts et d’autres facteurs seront suffisants pour faire contrepoids aux tendances à la «décollectivisation», qualifiée aussi d’«atomisation» des relations professionnelles, qui accompagne la mondialisation croissante de l’économie et la poussée de l’individualisme idéologique.
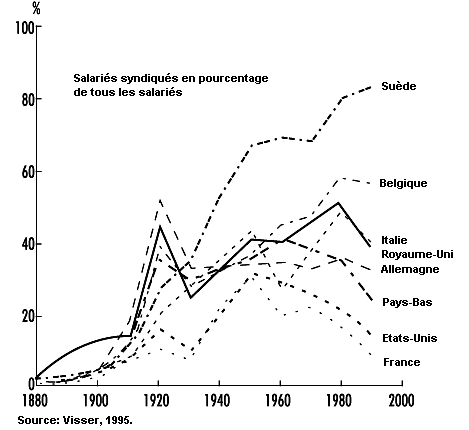
Dans les systèmes contemporains de relations professionnelles, les fonctions remplies par les syndicats et les organisations d’employeurs sont, pour l’essentiel, les suivantes: défense et promotion des intérêts des membres; représentation politique; prestations de services aux membres. La fonction de représentation des syndicats comporte un autre aspect, le contrôle de leur légitimité qui dépend en partie de leur capacité à maintenir la discipline dans leurs rangs, par exemple lorsqu’il s’agit de déclencher une grève ou d’y mettre fin. Pour les syndicats, le défi permanent consiste à renforcer leur représentativité, c’est-à-dire le nombre de leurs membres exprimé en pourcentage de la main-d’œuvre recensée dans le secteur structuré. Les membres des syndicats sont des individus dont les cotisations, appelées contributions dans certains systèmes, alimentent les activités syndicales (les «syndicats maison», financés par les employeurs, et les syndicats financés par les gouvernements, comme c’était le cas dans les anciens pays communistes, ne sont pas pris en compte ici, car seules les organisations de travailleurs indépendantes sont de véritables syndicats). En règle générale, l’affiliation est une question de choix personnel et volontaire, bien que certains syndicats qui ont réussi à négocier des clauses d’exclusivité ou de sécurité syndicale soient tenus pour les représentants de tous les travailleurs visés par une convention collective donnée (par exemple, dans les pays où les syndicats sont reconnus comme les représentants des travailleurs au sein d’une unité de négociation définie). Les syndicats eux-mêmes peuvent s’affilier à des fédérations ou confédérations au niveau d’une branche d’activité ou aux niveaux national, régional ou international.
Les syndicats sont structurés selon divers schémas: par métier ou occupation, par branche d’activité, parfois même par entreprise ou selon qu’ils rassemblent des cols blancs ou des cols bleus. Il existe aussi des syndicats interprofessionnels qui groupent indifféremment les travailleurs de plusieurs métiers ou branches d’activité. Même dans les pays où les fusions de syndicats industriels et de syndicats interprofessionnels sont à l’ordre du jour, la situation des travailleurs agricoles ou ruraux favorise souvent la mise sur pied de structures spéciales pour ce secteur. En outre, un syndicat est souvent divisé en unités territoriales et en sous-unités régionales et, parfois, locales. Dans certains pays, le mouvement ouvrier a été le théâtre de scissions autour de lignes idéologiques (politique de parti), voire de convictions religieuses, que l’on retrouve ensuite dans la structure même du syndicat et chez ses adhérents. Le personnel de la fonction publique tend, pour sa part, à préférer une représentation syndicale distincte des salariés du secteur privé, mais cette règle connaît des exceptions.
Les syndicats peuvent avoir le même statut juridique que les autres associations, mais sont parfois assujettis à des règles spéciales. Dans un grand nombre de pays, les syndicats sont tenus de s’enregistrer et de donner certains renseignements de base aux autorités (nom, adresse, identité des dirigeants, etc.). Dans certains pays, ces exigences vont au-delà des simples formalités administratives et constituent une ingérence; dans les cas extrêmes de négation des principes de la liberté syndicale, les syndicats ont besoin de l’autorisation du gouvernement pour exercer leurs activités. En tant que représentants des travailleurs, les syndicats sont habilités à contracter des obligations au nom de leurs membres. Certains pays (dont les Etats-Unis) exigent préalablement la reconnaissance des syndicats par l’employeur pour toute négociation collective.
La représentation syndicale varie grandement d’un pays à un autre et à l’intérieur d’un même pays. Dans certains pays d’Europe occidentale, par exemple, elle est très élevée dans le secteur public, mais assez faible dans le secteur privé, surtout dans le tertiaire. Les taux de syndicalisation des cols bleus dans cette partie du monde sont variés: élevés en Autriche et en Suède, bas en France où, pourtant, le pouvoir politique des syndicats est bien supérieur à ce que le nombre de leurs adhérents laisserait penser. Il existe une certaine corrélation positive entre la négociation centralisée et la syndicalisation, mais elle n’est pas absolue.
En tant qu’associations volontaires, les syndicats établissent leurs propres règles, d’habitude sous la forme d’un acte constitutif et de statuts. Dans une structure syndicale démocratique, les membres choisissent leurs dirigeants syndicaux par scrutin direct ou par l’entremise de délégués à une assemblée générale. Les règles qui régissent l’administration interne d’un petit syndicat très décentralisé au sein d’un groupe professionnel donné seront généralement très différentes de celles qui prévalent dans un grand syndicat centralisé interprofessionnel ou de branche. Le syndicat doit répartir les tâches entre ses dirigeants, les délégués syndicaux rémunérés et les autres, et coordonner le travail. Les ressources financières dont dispose un syndicat varient aussi en fonction de son effectif et de la facilité de perception des cotisations. L’instauration d’un système de prélèvement des cotisations syndicales à la source et de versement direct au syndicat simplifie grandement ce problème. Dans la majeure partie de l’Europe centrale et orientale, les syndicats qui étaient dominés et financés par l’Etat sont en train de se transformer et d’être rejoints par de nouvelles organisations indépendantes; tous luttent pour prendre leur place et fonctionner avec succès dans la nouvelle structure économique. Les salaires extrêmement bas (et, partant, les faibles cotisations syndicales) qui sont versés dans cette partie du monde et dans les pays en développement où les syndicats sont encadrés par les gouvernements font qu’il est difficile d’y bâtir un mouvement syndical fort et indépendant.
En plus de leur importante fonction de négociation collective, les syndicats mènent une action politique qui, dans de nombreux pays, constitue l’une de leurs principales activités. Elle peut prendre la forme d’une représentation directe, un certain nombre de sièges leur étant réservés au parlement (par exemple, au Sénégal) ou dans des organismes tripartites qui participent à l’élaboration de la politique économique et sociale nationale (par exemple, en Autriche, en France et aux Pays-Bas), ou encore dans des organes consultatifs tripartites en matière de travail et d’affaires sociales (par exemple, dans de nombreux pays d’Amérique latine et dans certains pays d’Afrique et d’Asie). Dans l’Union européenne, les fédérations syndicales ont une nette influence sur l’élaboration de la politique sociale. Cependant, les syndicats font évoluer les choses en exerçant leur pouvoir (au besoin appuyé par la menace de grèves) et en faisant pression sur les décideurs politiques au niveau national. Les syndicats ont, certes, réussi à obtenir une protection accrue de la loi pour tous les travailleurs dans le monde entier; pourtant, d’aucuns pensent qu’il s’agit là d’une victoire à la Pyrrhus qui saperait, à long terme, leur raison d’être. Souvent, les objectifs et les enjeux de l’action syndicale sur le plan politique dépassent de loin les seuls intérêts du mouvement syndical; ce type de situation a été parfaitement illustré par la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud et par la solidarité internationale exprimée par des syndicats dans l’ensemble du monde, non seulement en paroles mais aussi en actes concrets (par exemple, en organisant avec l’aide des dockers le boycottage du charbon importé d’Afrique du Sud). Il va de soi que le caractère offensif ou défensif de l’action syndicale sur le plan politique dépend largement de l’orientation prosyndicale ou antisyndicale du gouvernement en place. Il dépend aussi des relations des syndicats avec les partis politiques; certains syndicats, notamment en Afrique, ont pris part à la lutte pour l’indépendance de leur pays et entretiennent des liens très étroits avec le parti politique au pouvoir. Dans certains pays, le mouvement syndical entretient traditionnellement des rapports privilégiés avec un parti politique (Australie, Royaume-Uni), tandis qu’ailleurs les alliances se font et se défont au fil du temps. Quoi qu’il en soit, le pouvoir des syndicats dépasse souvent ce que le nombre de leurs adhérents pourrait laisser supposer, surtout quand ils représentent les travailleurs de la fonction publique ou d’un secteur économique clé comme les transports ou les mines.
Outre le syndicalisme proprement dit, on a assisté à l’émergence de nombreux autres types de participation des travailleurs visant à assurer une représentation directe ou indirecte des salariés. Ils coexistent parfois avec les syndicats; d’autres fois, ils constituent le seul mode de participation ouvert aux travailleurs. Les fonctions et les pouvoirs des représentants des travailleurs aux termes de ces arrangements sont décrits dans l’article «Les formes de participation des travailleurs» du présent chapitre.
La troisième fonction principale des syndicats — fournir des services à leurs membres — s’exerce essentiellement sur le lieu de travail. Un délégué d’atelier dans une entreprise se trouve sur place pour veiller à ce que les droits reconnus aux travailleurs en vertu de la convention collective et de la loi soient effectivement respectés et, si ce n’est pas le cas, pour prendre les mesures qui s’imposent. Le travail du délégué syndical est de défendre les intérêts des travailleurs face à la direction, ce qui justifie sa fonction de représentation. Cela peut consister à présenter une réclamation individuelle en matière disciplinaire ou au sujet d’un licenciement, ou à coopérer avec la direction aux travaux d’un comité mixte de sécurité et de santé. Hors du lieu de travail, de nombreux syndicats offrent d’autres types d’avantages, notamment des modalités préférentielles de crédit et la participation à des programmes sociaux. La salle de réunion du syndicat peut également servir à des manifestations culturelles, voire à des cérémonies familiales réunissant un grand nombre d’invités. La vaste gamme des services qu’un syndicat peut offrir à ses membres reflète sa créativité, les ressources dont il dispose, ainsi que son milieu culturel.
Visser fait observer ce qui suit:
Le pouvoir des syndicats dépend de divers facteurs internes et externes. Nous pouvons établir une distinction entre le pouvoir organisationnel (quelles sources internes de pouvoir les syndicats peuvent-ils mobiliser?), le pouvoir institutionnel (sur quelles sources externes de soutien les syndicats peuvent-ils compter?) et le pouvoir économique (quelles forces du marché font le jeu des syndicats?) (Visser, 1995).
Selon Visser, les facteurs qui contribuent à une forte structure syndicale sont la mobilisation d’un nombre important et stable d’adhérents bien formés qui paient leurs cotisations (cet effectif correspondant à la composition du marché du travail, pourrait-on ajouter), la capacité d’éviter la fragmentation de l’organisation et les dissensions d’ordre politique ou idéologique, ainsi que la mise sur pied d’une structure organisationnelle garantissant une présence dans l’entreprise tout en centralisant le contrôle des fonds et la prise de décisions. Ce modèle, qui a jusqu’ici bien réussi au niveau national, peut-il s’adapter à la mondialisation croissante de l’économie? C’est le défi que les syndicats ont à relever.
|
Le mouvement syndical international sur le plan mondial, par opposition aux niveaux régional et national, est formé d’associations internationales de fédérations nationales de syndicats. A l’heure actuelle, il existe trois internationales syndicales qui sont animées par des tendances idéologiques distinctes: la Confédération internationale des syndicats libres (CISL); la Fédération syndicale mondiale (FSM); la Confédération mondiale du travail (CMT), relativement petite et, à l’origine, chrétienne. La plus importante, la CISL, comptait, en 1995, 174 syndicats affiliés dans 124 pays et représentait 116 millions de syndiqués. Ces groupes font du lobbying auprès des organisations intergouvernementales sur des questions de politique économique et sociale et militent en faveur d’une protection des droits syndicaux fondamentaux dans le monde entier. On peut les qualifier de force politique qui appuie le mouvement syndical international. La force du mouvement syndical international réside dans les associations internationales de syndicats organisés habituellement autour d’un métier, d’une branche d’activité ou d’un secteur de l’activité économique. Appelés Secrétariats professionnels internationaux (SPI) ou Unions internationales de syndicats (UIS), ils peuvent être indépendants, affiliés ou contrôlés par les organisations internationales. Traditionnellement, ils sont organisés par secteur, mais aussi, dans certains cas, par catégorie professionnelle (par exemple, les cols blancs) ou par employeur (du secteur public ou du secteur privé). C’est ainsi qu’en 1995 il y avait en fonction 13 SPI dont les vues étaient alignées sur celles de la CISL et qui étaient répartis dans les secteurs suivants: bâtiment et bois; chimie, mines; énergie; activités commerciales, professionnelles, techniques et de bureau; enseignement; spectacles; alimentation, agriculture, restauration; industries graphiques; journalisme; métallurgie; postes et télécommunications; fonction publique; textile, confection et travail du cuir; transports. Les SPI se concentrent surtout sur des enjeux particuliers aux branches d’activité — conflits de travail et salaires et, aussi, application des dispositions en matière de sécurité et de santé. Ils assurent, à leurs syndicats affiliés, des services d’information, d’éducation et de formation. Ils contribuent également à coordonner la solidarité internationale entre syndicats de différents pays et ils représentent les intérêts des travailleurs dans divers forums régionaux et internationaux. L’action des SPI est illustrée par la réponse syndicale internationale à la catastrophe de Bhopal, en Inde (fuite de méthylisocyanate, qui a fait des milliers de victimes le 3 décembre 1984. A la demande des syndicats nationaux indiens qui lui sont affiliés, la CISL et la Fédération internationale des syndicats de travailleurs de la chimie, de l’énergie, des mines et des industries diverses ont envoyé une mission d’enquête à Bhopal pour étudier les causes et les effets de ce dégagement accidentel de gaz. Cette mission a permis d’établir un rapport contenant des recommandations pour prévenir ce genre de catastrophe et une liste de principes de sécurité; ce rapport a été utilisé par les syndicalistes de pays industriels comme de pays en développement et a servi à l’élaboration de programmes de base visant à améliorer la sécurité et la santé au travail. Source: Rice, 1995. |
La consultation et la participation ne peuvent se révéler efficaces que dans un milieu où le droit des employeurs et des travailleurs de s’associer librement et le droit de leurs organisations respectives de pouvoir représenter efficacement les intérêts de leurs adhérents jouissent d’une reconnaissance et d’un respect adéquats. Très concrètement, on peut donc voir dans le droit de s’organiser un préalable fondamental de toute stratégie efficace en matière de sécurité et de santé au travail, aussi bien à l’échelon national et international que sur le lieu de travail. Cela étant, il convient d’examiner plus attentivement les normes internationales du travail en matière de liberté syndicale, tout en ayant à l’esprit la manière dont elles s’appliquent à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l’indemnisation et la réadaptation des victimes. Les normes en matière de liberté syndicale appellent une reconnaissance appropriée, en droit et en pratique, du droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et la reconnaissance correspondante du droit de ces organisations, dès qu’elles sont constituées, de formuler et de mettre en œuvre librement leurs programmes d’action.
Les droits d’association et de représentation soulignent aussi la nécessité d’une coopération tripartite (gouvernements, employeurs et travailleurs) dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Pareille coopération est préconisée dans les activités normatives de l’OIT, par exemple:
Le «droit d’association en vue de tous objets non contraires à la loi aussi bien pour les salariés que pour les employeurs» faisait partie des méthodes et principes stipulés à l’article 41 de la première Constitution de l’OIT (art. 427, 2) du Traité de Versailles). A présent, ce principe est expressément reconnu dans le Préambule de la Constitution comme l’un des préalables fondamentaux de la justice sociale, elle-même considérée comme le préalable fondamental d’une paix universelle et durable. Une reconnaissance expresse est également accordée à ce principe et à celui du tripartisme au paragraphe I de la Déclaration de Philadelphie, annexée à la Constitution en 1946. Cette confirmation constitutionnelle de l’importance du respect des principes de la liberté syndicale contribue à asseoir l’un des fondements juridiques du pouvoir de la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale et du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT d’ouvrir une information concernant les allégations de violation des principes de la liberté syndicale.
Dès 1921, la Conférence internationale du Travail adoptait la convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), laquelle dispose que les Etats la ratifiant s’engagent «à assurer à toutes les personnes occupées dans l’agriculture les mêmes droits d’association et de coalition qu’aux travailleurs de l’industrie». Cependant, cette convention est muette au sujet des droits à accorder aux travailleurs de l’industrie avec lesquels les personnes occupées dans l’agriculture doivent être traitées sur un pied d’égalité! Les tentatives amorcées dans les années vingt en vue d’adopter un instrument plus général portant sur la liberté syndicale se heurtèrent à l’intransigeance des employeurs et des gouvernements, qui exigeaient que le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier fût obligatoirement assorti du droit corrélatif de ne pas s’y affilier. La question a été rouverte tout de suite après la seconde guerre mondiale et réglée par l’adoption de la convention (no 84) sur le droit d’association (territoires non métropolitains), 1947, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Les conventions nos 87 et 98 figurent parmi les plus importantes et les plus ratifiées de toutes les conventions internationales du travail: au 31 décembre 1997, la convention no 87 avait été ratifiée par 121 Etats, la convention no 98 par 137. Ensemble, ces deux conventions énoncent ce que l’on peut considérer à juste titre comme les quatre éléments clés de la notion de liberté syndicale. Elles sont tenues pour le point de référence de la protection internationale de la liberté syndicale, comme le dénotent par exemple l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans la structure de l’OIT, elles forment l’assise des principes de la liberté syndicale élaborés et appliqués par la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale et le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, bien que, d’un point de vue technique, la compétence de ces organes dérive de la Constitution de l’Organisation plutôt que des conventions. Elles sont aussi au cœur des délibérations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail sur l’application des conventions et des recommandations.
Il faut comprendre qu’en dépit de leur rôle de pivot les conventions nos 87 et 98 ne sont nullement les seuls instruments normatifs qui aient été adoptés sous les auspices de l’OIT dans le domaine de la liberté syndicale. Au contraire, depuis 1970, la Conférence internationale du Travail a adopté quatre autres conventions et quatre autres recommandations qui traitent de manière plus approfondie des divers aspects des principes de la liberté syndicale ou de leur application dans certains contextes précis:
Les éléments fondamentaux des principes de la liberté syndicale énoncés aux conventions nos 87 et 98 sont les suivants:
Toutes les garanties données par la convention no 87 sont subordonnées à la condition énoncée à l’article 8, 1): «dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus [...] de respecter la légalité». Cette disposition est elle-même subordonnée à la condition suivante: «la législation nationale ne devra pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention» (art. 8, 2)).
Il convient également de signaler qu’en vertu de l’article 9, 1) de la convention no 87 il est permis, mais pas obligatoire, de déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues par cette convention s’appliqueront aux forces armées et à la police. L’article 5, 1) de la convention no 98 est identique, tandis que l’article 6 dispose que: «la présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut».
Le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier est la clé de voûte de toutes les autres garanties inscrites dans les conventions nos 87 et 98 et les principes de la liberté syndicale. Ce droit n’est assujetti qu’à la réserve énoncée à l’article 9, 1) de la convention no 87. Autrement dit, il n’est pas permis de priver quelque groupe de travailleurs que ce soit, hormis les membres des forces armées ou de la police, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Il s’ensuit que le refus ou la limitation du droit des fonctionnaires, des travailleurs agricoles, des enseignants, etc., de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier est incompatible avec les dispositions de l’article 2.
Toutefois, le règlement d’un syndicat ou d’une organisation patronale peut limiter les catégories de travailleurs ou d’employeurs habilités à s’affilier. L’important est que cette limitation résulte du libre choix des membres de l’organisation et ne soit pas imposée de l’extérieur.
Le droit d’association prévu à l’article 2 n’est assorti d’aucun droit corrélatif de ne pas s’associer. On se souviendra que les tentatives faites antérieurement visant à adopter une convention générale sur la liberté syndicale ont échoué en raison de l’intransigeance des délégués employeurs et de certains délégués gouvernementaux qui exigeaient que le droit de s’associer comportât automatiquement son corollaire, à savoir le droit de ne pas s’associer. Cette question a été soulevée à nouveau lors des débats sur les conventions nos 87 et 98. A cette occasion, un compromis a permis à la Conférence internationale du Travail d’adopter une résolution déclarant que la mesure dans laquelle les dispositifs de sécurité syndicale (notamment les arrangements en matière de monopole syndical d’embauche («closed shop»), de versement d’une cotisation de solidarité pour les travailleurs non syndiqués («agency shop») ou de prélèvement des cotisations à la source sont permis ou s’appliquent relève de la pratique et de la réglementation de chaque Etat. Autrement dit, les conventions ne sauraient être interprétées comme autorisant ou comme interdisant le monopole d’embauche et les autres clauses de sécurité syndicale, bien que ces mesures soient tenues pour inacceptables quand elles sont imposées par le pouvoir législatif, et non adoptées d’un commun accord par les parties (BIT, 1994b; 1995a).
La question la plus délicate concernant l’article 2 est la suivante: jusqu’à quel point confirme-t-il la notion de pluralisme syndical? En d’autres termes, le pouvoir législatif peut-il, sans contrevenir à l’article 2, limiter directement ou indirectement le droit des travailleurs (ou des employeurs) de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier en appliquant des critères administratifs ou législatifs?
Cette question soulève deux ensembles d’intérêts contradictoires. D’une part, l’article 2 vise indiscutablement à protéger le droit des travailleurs et des employeurs de choisir l’organisation à laquelle ils souhaitent s’affilier et de ne pas s’affilier aux organisations dont ils ne partagent pas les vues politiques, confessionnelles ou autres. D’autre part, les gouvernements (et en vérité les syndicats) peuvent soutenir que la multiplication excessive des syndicats et des organisations patronales à laquelle l’exercice illimité du libre choix risque d’aboutir n’est pas propice à l’épanouissement d’organisations libres et efficaces, ni à l’établissement et au maintien de procédures de relations professionnelles ordonnées. Le problème se posait de manière particulièrement aiguë à l’époque de la guerre froide, lorsque les gouvernements cherchaient souvent à restreindre, pour des motifs idéologiques, le choix des syndicats auxquels les travailleurs pouvaient adhérer. Cette question demeure très délicate dans de nombreux pays en développement où les gouvernements, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, veulent empêcher ce qu’ils jugent comme une prolifération excessive des syndicats, en imposant des restrictions quant au nombre ou à l’importance de ceux qui peuvent exercer leur activité dans un milieu de travail donné ou dans un secteur précis de l’économie. Les organes de contrôle de l’OIT tendent à adopter une attitude assez restrictive: ils autorisent le monopole syndical quand il résulte du libre choix des travailleurs dans le pays en question et admettent l’adoption de critères «raisonnables» d’enregistrement, mais ils désapprouvent fermement tout monopole imposé par voie légale et tous critères «déraisonnables» d’enregistrement. Ce faisant, les organes de contrôle de l’OIT se sont exposés à d’innombrables critiques, en particulier de la part de gouvernements de pays en développement qui les accusent d’adopter une approche eurocentriste pour l’application de la convention; ce reproche renvoie au fait que les préoccupations typiquement européennes en matière de droits de la personne sont réputées incompatibles avec les coutumes de nombreuses cultures non européennes où l’intérêt général de la collectivité l’emporte sur celui des individus.
Si l’article 2 de la convention no 87 protège le droit fondamental des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, l’article 3 peut être considéré comme son corollaire logique, qui protège le libre fonctionnement des organisations dès qu’elles sont constituées.
L’article 3, 1) précise clairement le droit d’élaborer, d’adopter et d’appliquer les statuts et règlements administratifs des organisations et de tenir des élections. Cependant, les organes de contrôle ont accepté qu’il soit permis aux autorités publiques d’imposer des conditions minimales visant la teneur ou l’administration des statuts et règlements «dans le but de protéger les droits des membres en assurant une bonne gestion et en prévenant des complications juridiques qui pourraient surgir en cas d’obscurité ou d’imprécisions des statuts et des règlements» (BIT, 1994b). Toutefois, si l’application de ces conditions est trop compliquée ou restrictive, il est probable que celles-ci seront déclarées incompatibles avec les exigences de l’article 3.
Depuis des années, les organes de contrôle ont constamment affirmé que «le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d’association syndicale protégé par la convention no 87» (BIT, 1994b):
La Commission [d’experts] est d’avis que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Ces droits se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l’entreprise et qui intéressent directement les travailleurs.
C’est l’un des aspects les plus controversés de toute la jurisprudence concernant la liberté syndicale; ces dernières années surtout, il a fait l’objet de critiques vigoureuses de la part des membres employeurs et gouvernementaux de la Commission de l’application des normes à la Conférence internationale du Travail (voir, par exemple, Conférence internationale du Travail, 80e session, 1993: Compte rendu des travaux, no 25, pp. 10-12 et pp. 58-64; Conférence internationale du Travail, 81e session, 1994: Compte rendu des travaux, no 25, pp. 92-94 et pp. 179-180). C’est pourtant un point solidement ancré dans la jurisprudence sur la liberté syndicale. Ce droit est clairement reconnu à l’article 8, 1) d) du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et a été approuvé par la Commission d’experts dans son Etude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective (BIT, 1994b).
Toutefois, il faut bien comprendre que le droit de grève, tel qu’il est reconnu par les organes de contrôle, n’est pas inconditionnel. Tout d’abord, il ne s’applique pas aux groupes de travailleurs pour lesquels il est permis de limiter les garanties énoncées à la convention no 87, à savoir les membres des forces armées et de la police. Par ailleurs, il a été décidé que le droit de grève peut être légitimement refusé aux «fonctionnaires publics agissant comme organes de la puissance publique» et aux travailleurs assurant des services essentiels, c’est-à-dire ceux «dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne». Cependant, toute restriction visant le droit de grève des travailleurs de ces deux catégories doit être assortie de garanties compensatoires, «par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est impératif que ces derniers puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait par ailleurs présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité; les décisions arbitrales devraient avoir un caractère obligatoire pour les deux parties et, une fois rendues, pouvoir être exécutées rapidement et complètement» (BIT, 1994b).
Il est également permis de restreindre temporairement l’exercice du droit de grève «dans une situation de crise nationale aiguë». Sur un plan plus général, il est possible d’imposer d’autres conditions préalables comme la tenue d’un vote sur le déclenchement d’une grève, l’épuisement des procédures de conciliation et ainsi de suite, qui restreignent l’exercice du droit de grève. Toutefois, toutes ces restrictions doivent être «raisonnables» et ne pas restreindre considérablement les possibilités d’action des organisations syndicales.
Le droit de grève est souvent qualifié d’ultime carte de la négociation collective. Si l’article 3 est interprété de manière à le protéger, il semble alors raisonnable de présumer que cet article doit aussi protéger la négociation collective proprement dite. Les organes de contrôle ont effectivement adopté ce point de vue à plusieurs reprises, mais en général ils ont préféré fonder leur jurisprudence concernant la négociation collective sur l’article 4 de la convention no 98 (pour une analyse plus détaillée de la jurisprudence de l’OIT sur le droit de grève, voir Hodges-Aeberhard et Odero de Dios, 1987; Ben-Israel, 1988).
L’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs est également traitée aux articles 4 à 7 de la convention no 87 et à l’article 2 de la convention no 98. L’article 4 dispose que ces organisations «ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative». Cela ne signifie pas qu’il ne soit pas possible d’annuler leur enregistrement ou de les dissoudre, par exemple lorsqu’elles commettent des fautes graves en matière de relations professionnelles ou lorsqu’elles ne sont pas gérées conformément à leurs statuts; cela signifie que, le cas échéant, toute sanction de cet ordre doit être imposée par un tribunal dûment constitué ou par tout autre organe approprié, et non par décision administrative.
L’article 5 protège le droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier, et le droit de toute organisation, fédération ou confédération de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. De plus, selon l’article 6, les garanties énoncées aux articles 2, 3 et 4 s’appliquent aux fédérations et aux confédérations de la même façon qu’elles visent les organisations du premier niveau, et l’article 7 prévoit que l’acquisition de la personnalité juridique par les organisations d’employeurs ou de travailleurs ne peut être subordonnée «à des conditions de nature à mettre en cause l’application des dispositions des articles 2, 3 et 4».
Enfin, l’article 2, 1) de la convention no 98 dispose que «les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration». En pratique, il paraît peu probable que des syndicats veuillent ou puissent effectivement entraver le fonctionnement interne des organisations d’employeurs. En revanche, il est tout à fait concevable que, dans certaines circonstances, des employeurs ou leurs organisations cherchent à s’immiscer dans les affaires internes d’organisations de travailleurs — par exemple, en les finançant partiellement ou intégralement. Cette éventualité est expressément évoquée à l’article 2, 2):
Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence au sens du présent article des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens, financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs.
Pour que les garanties énoncées aux conventions nos 87 et 98 s’appliquent concrètement, il convient que les personnes qui exercent leur droit de constituer des organisations de travailleurs et de s’y affilier soient protégées de toutes formes de discrimination ou de représailles et qu’elles n’en soient pas victimes à la suite de leur décision. Cette logique est reconnue à l’article 1, 1) de la convention no 98, lequel dispose en effet que «les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi». L’article 1, 2) précise:
Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:
a) subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat;
b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail.
Les actes de discrimination antisyndicale commis à ces fins comprennent le refus d’embauche et le licenciement, ainsi que d’autres mesures: «transfert, mutation, rétrogradation, privations ou restrictions de tous ordres (rémunération, avantages sociaux, formation professionnelle)», qui peuvent causer un très grave préjudice au travailleur qui en est victime (voir aussi les articles 5 a), b) et c) de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, ainsi que BIT, 1994b, paragr. 212).
Ainsi, il doit non seulement exister une protection complète contre toute discrimination antisyndicale au sens de la convention no 98, mais, en vertu de l’article 3, il faut aussi disposer de moyens efficaces pour appliquer ces garanties:
Les normes législatives sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides, et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application. [...] L’obligation faite à l’employeur de prouver que la mesure alléguée comme antisyndicale était liée à des questions autres que syndicales, ou l’établissement d’une présomption en faveur des travailleurs constituent des moyens complémentaires pour assurer une protection efficace du droit syndical garanti par la convention. Une législation qui permet, en pratique, à l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un travailleur à condition de payer l’indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié [...] n’est pas suffisante au regard de l’article 1 de la convention. La législation devrait également prévoir un mécanisme efficace de mise en œuvre des moyens de réparation, la réintégration du travailleur licencié avec dédommagement rétroactif constituant le remède le plus approprié aux actes de discrimination antisyndicale (BIT, 1994b).
La garantie énoncée à l’article 4 de la convention no 98 est interprétée comme protégeant à la fois le droit d’engager une négociation collective et l’autonomie des parties à la négociation. Autrement dit, le fait de refuser à des employeurs et à des travailleurs le droit d’entreprendre une négociation collective s’ils le désirent est incompatible avec l’article 4; toutefois, il n’est pas contraire à la convention de refuser ce droit aux membres des forces armées et de la police, car «la convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat». Non seulement les parties doivent être libres d’engager une négociation collective si elles le veulent, mais encore, il faut leur permettre de mener la négociation comme elles le jugent bon et de parvenir à une entente qu’elles auront elles-mêmes négociée sans ingérence des autorités publiques — sous réserve de certains critères liés à «des raisons impérieuses d’intérêt national économique» (BIT, 1994b) et de conditions raisonnables quant à la forme, à l’enregistrement, etc.
Toutefois, l’article 4 n’est pas interprété comme protégeant le droit des syndicats d’être reconnus aux fins de la négociation collective. Les organes de contrôle ont souligné à maintes reprises que pareille reconnaissance était souhaitable, mais ils se sont abstenus de passer à l’étape suivante: ils n’ont pas déclaré que le refus de reconnaître un syndicat ou l’absence d’un mécanisme pouvant obliger l’employeur à reconnaître le syndicat auquel les salariés sont affiliés constituaient des violations de l’article 4 (BIT, 1994b, 1995a). Ils ont motivé cette interprétation en indiquant que la reconnaissance obligatoire amputerait la négociation collective du caractère volontaire prévu à l’article 4 (BIT, 1995a). On peut répliquer à cela que le droit apparent de pratiquer la négociation collective est inévitablement compromis si les employeurs sont libres de refuser d’y participer, nonobstant leur droit de négocier s’ils le désirent. Par ailleurs, l’idée de permettre aux employeurs de refuser de reconnaître les syndicats dont leurs salariés sont membres semble assez difficile à concilier avec le devoir de «promouvoir» la négociation collective qui est manifestement l’objet principal de l’article 4 (Creighton, 1994).
Les normes internationales du travail relatives à la sécurité et à la santé au travail consacrent le concept de participation bi- ou tripartite dans trois contextes principaux: 1) formulation et mise en œuvre d’une politique nationale; 2) consultation entre employeurs et travailleurs sur le lieu de travail; 3) participation conjointe des employeurs et des travailleurs à la formulation et à la mise en œuvre d’une politique sur le lieu de travail. La participation effective des employeurs et (surtout) des travailleurs dans ces trois contextes dépend donc absolument d’une reconnaissance adéquate de leurs droits d’association et de représentation.
Le respect du droit de constituer des organisations et de s’y affilier est manifestement un préalable fondamental des trois formes de participation conjointe. La consultation et la participation au niveau gouvernemental sont possibles uniquement s’il existe des organisations puissantes et efficaces pouvant être considérées comme représentatives des intérêts de leurs membres. Cela est indispensable à la fois pour faciliter la communication et pour amener le gouvernement à prendre au sérieux les opinions exprimées par les représentants des employeurs et des travailleurs. A fortiori, la consultation et la participation dans l’entreprise ne constituent une proposition réaliste que si les travailleurs ont le droit de former des organisations et de s’affilier à celles qui sont en mesure de représenter leurs intérêts dans les discussions avec les employeurs et leurs organisations, de fournir des ressources pour soutenir les représentants des travailleurs, d’intervenir utilement dans les échanges avec les services publics d’inspection du travail, etc. Théoriquement, les représentants des travailleurs devraient pouvoir exercer leurs fonctions dans l’entreprise sans qu’il soit nécessaire d’entretenir des liens avec une organisation de niveau supérieur, mais les rapports de force dans la plupart des entreprises sont tels que les représentants des travailleurs ont peu de chances de pouvoir exercer leurs fonctions avec efficacité sans le soutien d’une telle organisation. En tout état de cause, il faut au moins que les travailleurs puissent se faire représenter et faire valoir leurs intérêts de cette façon s’ils le souhaitent.
Le libre fonctionnement des organisations d’employeurs et de travailleurs est également un préalable fondamental à toute participation significative, et ce, à tous les niveaux. Par exemple, il est indispensable que les organisations de travailleurs aient le droit de formuler et de mettre en œuvre, sans ingérence extérieure, leurs politiques en matière de sécurité et de santé au travail, aux fins de la consultation avec le gouvernement concernant: 1) les questions telles que la réglementation des matières et des procédés dangereux; 2) la formulation de la politique législative relative à la réparation des accidents du travail ou à la réadaptation des travailleurs accidentés. Cette autonomie est d’autant plus importante dans l’entreprise que les organisations de travailleurs ont besoin d’établir et de maintenir la capacité de défendre les intérêts de leurs membres dans les discussions avec les employeurs en matière de sécurité et de santé au travail, notamment sur les points suivants: droits d’accès aux lieux de travail pour les dirigeants syndicaux ou les spécialistes de la sécurité et de la santé; recours aux autorités publiques et à leur aide dans les situations dangereuses; dans certaines circonstances, lancement d’une action syndicale afin de protéger la sécurité et la santé de leurs membres.
Pour être efficace, le libre fonctionnement requiert aussi que les membres et les dirigeants des syndicats bénéficient d’une protection suffisante contre toute forme de discrimination ou de représailles motivée par leur affiliation syndicale ou leurs activités syndicales, ou parce qu’ils seraient à l’origine de poursuites judiciaires en matière de sécurité et de santé au travail ou qu’ils y auraient participé. Autrement dit, les garanties contre la discrimination énoncées à l’article 1 de la convention no 98 sont tout aussi pertinentes dans le cas de l’activité syndicale relative à la sécurité et à la santé au travail que pour toutes les autres formes d’activité syndicale comme la négociation collective, le recrutement, etc.
Le droit d’engager une négociation collective en toute indépendance est aussi un élément capital de la participation effective des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail. Les garanties énoncées à l’article 4 de la convention no 98 sont importantes dans ce contexte. Toutefois, il convient de répéter qu’elles ne s’étendent pas au droit à la reconnaissance aux fins de la négociation. D’un autre côté, des dispositions comme celles contenues à l’article 19 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, peuvent être perçues comme imposant quasiment la reconnaissance syndicale dans les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail:
Des dispositions devront être prises au niveau de l’entreprise aux termes desquelles:
En pratique, il serait très difficile d’appliquer ces dispositions sans accorder une certaine reconnaissance officielle au rôle des organisations de travailleurs. Par conséquent, cette situation met une fois de plus en relief l’importance d’une reconnaissance adéquate des droits d’association et de représentation, comme condition préalable de la mise au point et de l’application de stratégies efficaces en matière de sécurité et de santé au travail, tant au niveau national qu’à celui de l’entreprise.
La négociation collective est le processus par lequel les travailleurs, en tant que groupe, négocient avec leur employeur; elle peut avoir lieu à divers niveaux (entreprise, branche d’activité ou niveau national). Traditionnellement, cette négociation porte sur les salaires, les avantages sociaux, les conditions de travail et un traitement équitable. Elle peut aussi avoir trait à des questions qui ne touchent pas directement les travailleurs occupés dans l’entreprise, comme dans le cas de l’augmentation des pensions des travailleurs retraités. Il est plus rare que la négociation collective déborde vraiment le cadre du milieu de travail et porte, par exemple, sur la protection de l’environnement.
Dans une très petite entreprise, les travailleurs en tant que groupe peuvent négocier collectivement avec leur employeur. Ce genre de négociation collective officieuse existe depuis des siècles. Néanmoins, de nos jours, la négociation collective est surtout le fait d’organisations de travailleurs ou de syndicats.
La convention (no 154) de l’OIT sur la négociation collective, 1981, en donne une définition très générale à l’article 2:
[...] le terme [...] s’applique à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de:
a) fixer les conditions de travail et d’emploi; et/ou
b) régler les relations entre les employeurs et les travailleurs; et/ou
c) régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs.
La négociation collective permet de faire progresser le niveau de vie et d’améliorer les conditions de travail, d’où son importance. Même si la sécurité et la santé au travail sont régies par la législation nationale de presque tous les pays, la négociation collective constitue souvent le mécanisme d’application pratique de ces lois sur les lieux de travail. Ainsi, la législation peut prescrire l’établissement de comités d’hygiène et de sécurité ou de comités d’entreprise, mais laisser à l’employeur et à l’organisation de travailleurs le soin d’en négocier les modalités d’application.
Malheureusement, la négociation collective est contestée par des employeurs autoritaires et des gouvernements répressifs, et ce, dans des pays développés comme dans des pays en développement. Elle existe rarement dans le secteur non structuré ou dans les petites entreprises traditionnelles. Par conséquent, la majorité des travailleurs dans le monde ne jouit pas des avantages d’une réelle négociation collective dans un cadre où les droits des travailleurs sont garantis par la loi.
Il existe une longue tradition d’action collective des organisations de travailleurs en faveur de la sécurité et de la santé au travail. En 1775, le chirurgien anglais Percival Pott a dressé le premier constat connu de cancer professionnel — le cancer de la peau chez les ramoneurs de Londres (Lehman, 1977). Deux ans plus tard, la guilde des ramoneurs danois ordonnait que l’on permette aux apprentis de prendre un bain tous les jours: c’est là la première intervention connue d’une organisation de travailleurs pour prévenir le cancer professionnel.
Toutefois, la sécurité et la santé furent rarement au cœur des premières luttes ouvrières, du moins d’une manière explicite. Les travailleurs exerçant des métiers dangereux étaient accablés de problèmes plus pressants, comme les salaires de famine, la durée exténuante du travail et les pouvoirs arbitraires des propriétaires d’usines et de mines. Le nombre des accidents et des décès témoignait bien des dangers quotidiens qui guettaient les travailleurs, mais la santé au travail n’était pas un concept très bien compris. Les organisations de travailleurs étaient faibles et constamment en butte aux attaques des propriétaires et des gouvernements. A l’époque, elles avaient pour seul souci de chercher à survivre. En conséquence, les revendications des travailleurs au XIXe siècle ont rarement pris la forme de campagnes pour des conditions de travail plus sûres (Corn, 1978).
Malgré tout, il est parfois arrivé que la sécurité et la santé viennent se greffer sur d’autres revendications lors des premières luttes ouvrières. Au XIXe siècle, vers la fin des années vingt, les ouvriers du textile aux Etats-Unis ont commencé à se mobiliser pour obtenir une réduction de la durée du travail. La main-d’œuvre était surtout composée de femmes, comme les dirigeantes des syndicats embryonnaires qui allaient devenir les associations ouvrières féministes de la Nouvelle-Angleterre. Elles avaient fait de la journée de 10 heures pour laquelle elles militaient une question de bien-être général. Mais, lors de leurs dépositions devant l’Assemblée législative du Massachusetts, des travailleurs dénoncèrent aussi les effets de journées de 12 à 14 heures de travail, dans des filatures mal aérées, et firent état d’une «terrible maladie insidieuse» qu’ils attribuaient à la poussière de coton et à la mauvaise ventilation; ces témoignages figurent maintenant parmi les premiers constats de byssinose. Les travailleurs, hommes et femmes, n’obtinrent pas vraiment gain de cause, que ce soit auprès des propriétaires d’usines ou du législateur (Foner, 1977).
D’autres actions syndicales engagées à l’époque portaient davantage sur les effets des risques professionnels, plutôt que sur leur prévention. Au XIXe siècle, de nombreux syndicats ont créé des programmes d’assistance sociale à l’intention de leurs membres, notamment sous forme de prestations versées aux invalides du travail ou aux survivants. Au Canada et aux Etats-Unis, les syndicats de mineurs sont allés plus loin en ouvrant des hôpitaux, des cliniques et même des cimetières pour leurs membres (Derickson, 1988). Pendant que les syndicats tentaient de négocier de meilleures conditions de travail avec les employeurs, en Amérique du Nord, la plupart des mouvements de revendication en faveur de la sécurité et de la santé au travail avaient lieu dans les mines et s’adressaient au pouvoir législatif des Etats ou des provinces (Fox, 1990).
En Europe, la situation a commencé à changer vers la fin du XIXe siècle, avec l’apparition d’organisations de travailleurs plus puissantes. En 1903, les syndicats français et allemands de peintres lancèrent une campagne contre les risques de la peinture au plomb. En 1911, le syndicat allemand des ouvriers de fabriques établit un programme énergique d’hygiène du travail, avec publication de documents à vocation pédagogique sur les risques chimiques; sa campagne pour l’adoption de mesures de prévention du cancer du poumon provoqué par les chromates se solda par des changements dans les méthodes de production. Au Royaume-Uni, les syndicats allèrent en justice pour représenter leurs membres qui demandaient réparation et luttèrent pour l’amélioration de la législation et de la réglementation. Leurs interventions mirent en évidence l’interaction entre la négociation collective en faveur de la sécurité et de la santé et le système d’inspection du travail dans les usines. En 1905, par exemple, les syndicats déposèrent 268 plaintes auprès de l’inspection du travail britannique (Teleky, 1948). Dès 1942, la Confédération patronale suédoise (SAF) et la Confédération suédoise des syndicats (LO) ont conclu un accord national sur le milieu de travail, relatif aux services locaux de sécurité et d’hygiène. Cet accord a été revu et élargi à plusieurs reprises; c’est ainsi qu’en 1976 la Fédération des salariés de l’industrie et des services (PTK) s’est associée aux deux premières parties à l’origine de cet accord (Joint Industrial Safety Council of Sweden, 1988).
L’Amérique du Nord restait à la traîne. Certains grands employeurs ont officiellement institué des programmes internes de sécurité au tournant du siècle (voir Brody, 1960, pour une description de ces programmes dans la sidérurgie, ou encore le complaisant Year Book of the American Iron and Steel Institute for 1914 (AISI, 1915)). Ces programmes étaient très paternalistes et misaient davantage sur la discipline que sur l’éducation; ils partaient souvent du principe que les travailleurs étaient eux-mêmes responsables des accidents du travail. Des catastrophes, comme le grand incendie à la Triangle Shirtwaist Company où 146 personnes perdirent la vie à New York en 1911, conduisirent les syndicats à faire campagne pour améliorer la situation et aboutirent à l’adoption d’une législation plus efficace en matière de protection contre les incendies. Il fallut toutefois attendre l’arrivée de syndicats puissants dans les années trente et quarante pour voir la sécurité et la santé figurer au nombre des grandes revendications ouvrières. Ainsi, en 1942, la constitution adoptée par le Syndicat unifié des travailleurs de la sidérurgie d’Amérique (USWA) lors de sa fondation prévoyait que chaque section locale devait établir un comité de sécurité et d’hygiène. Vers le milieu des années cinquante, des comités paritaires de sécurité et d’hygiène avaient été créés dans la plupart des mines et des manufactures syndiquées et dans de nombreuses autres entreprises du bâtiment et des services; la majorité des conventions collectives comprenaient une section sur la sécurité et l’hygiène.
|
La convention entre la Bethlehem Steel Corporation et l’USWA est un exemple caractéristique d’accord conclu dans une grande entreprise syndiquée de l’industrie manufacturière aux Etats-Unis. Les conventions collectives de la sidérurgie contiennent depuis plus de cinquante ans des dispositions sur la sécurité et la santé. Bon nombre des dispositions négociées par le passé accordaient aux travailleurs et au syndicat des droits qui ont ensuite été garantis par la législation. Malgré cela, elles demeurent inscrites dans le texte de la convention: elles protègent ainsi les travailleurs contre toute modification de la législation et permettent au syndicat de soumettre toute infraction à un arbitrage impartial, au lieu d’aller en justice. La convention conclue avec la Bethlehem Steel Corporation est entrée en vigueur le 1er août 1993 et doit prendre fin le 1er août 1999. Elle concerne 17 000 travailleurs répartis dans six établissements; le document compte 275 pages, dont 17 sont consacrées à la sécurité et à la santé. L’article 1 du chapitre sur la sécurité et la santé engage l’entreprise et le syndicat à coopérer en vue d’éliminer les accidents et les risques pour la santé. L’entreprise est tenue de garantir la sécurité et la salubrité des lieux de travail, de se conformer à la législation fédérale et à celle des Etats, de fournir gratuitement aux travailleurs l’équipement de protection nécessaire; elle doit également informer le syndicat sur la sécurité des produits chimiques et les travailleurs sur les risques des substances toxiques et les moyens de prévention technique. Pour comprendre les risques potentiels, le service central de sécurité et de santé du syndicat a droit à toute information «pertinente et essentielle» dont dispose l’entreprise. Cette dernière doit surveiller l’atmosphère des lieux de travail et les autres facteurs environnementaux à la demande du coprésident syndical du comité de sécurité et de santé de l’établissement. L’article 2 institue des comités paritaires de sécurité et de santé dans l’établissement et au niveau national, en établit le règlement, impose la formation de leurs membres, garantit à ces personnes l’accès à toutes les parties de l’établissement pour faciliter leurs travaux et fixe les modalités de leur rémunération dans l’exercice de leurs fonctions. L’article prévoit aussi le règlement des différends relatifs à l’équipement de protection, oblige l’entreprise à informer le syndicat de tous les accidents potentiellement invalidants, institue un système d’enquête paritaire sur les accidents, oblige l’entreprise à rassembler certaines données statistiques sur la sécurité et la santé et à les transmettre au syndicat, et établit un vaste programme de formation à la prévention à l’intention de tous les salariés. L’article 3 autorise les travailleurs à se retirer d’une situation de travail comportant des risques supérieurs à ceux qui sont «inhérents à l’exploitation», et prévoit un mécanisme d’arbitrage pour régler tout litige portant sur le refus de travailler dans ces circonstances. En vertu de cet article, un travailleur ne peut faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire pour avoir agi de bonne foi et en fonction de faits concrets objectifs, même si une enquête ultérieure révèle qu’en réalité le risque n’existait pas. L’article 4 précise que le rôle du comité est consultatif et que, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, les membres du comité et les dirigeants du syndicat ne sauraient être tenus pour responsables des accidents ou des maladies. L’article 5 précise que l’alcoolisme et la toxicomanie sont des états pathologiques qui se soignent et instaure un programme de réadaptation. L’article 6 établit un grand programme de prévention des émanations de monoxyde de carbone qui constituent un grave danger au cours de la première transformation du fer et de l’acier. L’article 7 prescrit la remise de bons aux travailleurs pour l’achat de chaussures de sécurité. L’article 8 dispose que l’entreprise préservera le caractère confidentiel des dossiers médicaux, sauf dans certaines circonstances limitées. Il précise en outre que les travailleurs peuvent consulter leur dossier médical et le communiquer au syndicat ou à leur médecin traitant. Les médecins de l’entreprise sont tenus pour leur part d’informer les travailleurs de toute constatation médicale grave. L’article 9 instaure un programme de surveillance médicale. L’article 10 établit un programme d’enquête et de prévention des risques liés aux terminaux à écran de visualisation. L’article 11 prévoit la nomination, dans chaque établissement, de délégués à la sécurité; ces délégués sont choisis par le syndicat, mais payés par l’entreprise. De plus, une annexe de la convention impose à l’entreprise et au syndicat de réviser, dans chaque établissement, le programme de sécurité du matériel roulant sur rails (ce type de matériel sur rails fixes est en effet la cause première des décès par traumatisme dans la sidérurgie américaine). |
On considère généralement la négociation collective comme un processus formel qui se déroule à intervalles réguliers et qui se conclut par une convention écrite entre l’organisation de travailleurs et l’employeur (ou les employeurs). De telles négociations supposent une série de demandes ou de propositions, suivies de contre-propositions et de longues délibérations qui débouchent éventuellement sur la signature d’une convention collective, d’un protocole d’entente, de déclarations conjointes ou de codes de bonnes pratiques établis d’un commun accord.
Cependant, on peut aussi considérer que la négociation collective est un processus continu de règlement des problèmes au fur et à mesure qu’ils se posent. Ce genre de négociation a lieu chaque fois qu’un délégué d’atelier rencontre un cadre pour régler un différend ou un grief, chaque fois qu’un comité paritaire de sécurité et d’hygiène se réunit pour discuter des problèmes qui se posent dans l’établissement, chaque fois qu’une équipe paritaire patronale-syndicale étudie un nouveau programme d’entreprise.
C’est cette souplesse qui est le gage de la pérennité de la négociation collective. Formelle ou non, la négociation repose toutefois sur une condition préalable: pour qu’elle aboutisse, les représentants respectifs des deux parties doivent être investis du pouvoir de négocier, de conclure un accord et de le faire respecter.
La négociation collective est parfois envisagée comme une épreuve de force au cours de laquelle un gain pour une partie équivaut à une perte pour l’autre. L’employeur verra, par exemple, dans une hausse salariale une menace pour ses profits et dans un accord de non-licenciement une entrave à sa liberté de manœuvre. Si la négociation est assimilée à une épreuve de force, le pouvoir relatif ou pouvoir de marchandage des parties devient l’élément déterminant le résultat. Pour l’organisation des travailleurs, ce pouvoir se traduit par la capacité d’arrêter la production au moyen d’une grève, d’organiser le boycottage du produit ou du service de l’employeur, ou d’user d’autres moyens de pression, tout en s’assurant de la loyauté de ses membres. Pour l’employeur, le pouvoir réside dans sa capacité de résister à ces pressions, de remplacer les grévistes dans les pays où cela est permis, ou de tenir bon jusqu’à ce que les travailleurs soient contraints de reprendre le travail aux conditions arrêtées par la direction.
Bien évidemment, dans la grande majorité des cas, les négociations collectives sont couronnées de succès et se terminent sans arrêt de travail. Néanmoins, c’est précisément la crainte d’un arrêt de travail qui incite les deux parties à parvenir à un règlement. Ce genre de négociation est parfois appelé négociation de positions: au départ, les parties exposent leurs points de vue respectifs, puis elles lâchent du lest et progressent jusqu’à ce qu’un compromis soit trouvé, selon le rapport des forces en présence.
Il existe un second modèle dans lequel la négociation collective est qualifiée de recherche mutuelle d’une solution optimale (Fisher et Ury, 1981). On présume alors qu’un accord bien négocié permettra aux deux parties d’y trouver avantage. Une augmentation de salaire, par exemple, sera compensée par une amélioration de la productivité. Un accord de non-licenciement pourra inciter les travailleurs à être plus efficaces puisque leur emploi ne sera pas menacé. Ce genre de négociation est dit «à la satisfaction des deux parties» ou «gagnant-gagnant». L’important, c’est que chaque partie comprenne les intérêts de l’autre et trouve les solutions les plus avantageuses pour tous. La sécurité et la santé au travail sont souvent tenues pour un sujet idéal de négociation au profit mutuel des parties, car toutes deux ont intérêt à éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En pratique, les deux modèles ne s’excluent pas, chacun ayant son importance. Les négociateurs chevronnés chercheront toujours à comprendre leurs vis-à-vis et à trouver les points sur lesquels une convention intelligemment négociée pourrait bénéficier aux deux parties. Toutefois, il est peu probable qu’une partie sans pouvoir de marchandage puisse atteindre ses objectifs. Il restera toujours des domaines où les parties percevront différemment leurs intérêts et où le meilleur remède restera le maniement de la carotte et du bâton. La négociation de bonne foi réussit le mieux lorsque chaque partie craint le coup de bâton de l’autre.
Le pouvoir de marchandage demeure important même dans les négociations sur la sécurité et la santé. Ainsi, une entreprise sera moins disposée à réduire son taux d’accidents si elle peut en faire porter les coûts par la collectivité. S’il est possible de remplacer facilement et à bon compte les travailleurs accidentés, sans avoir à leur verser des indemnités substantielles, la direction peut être tentée de se dispenser d’améliorer la sécurité, qui peut coûter cher. C’est particulièrement vrai dans le cas des maladies professionnelles à longue période de latence: l’installation de moyens de prévention technique est onéreuse, mais leur utilité ne se manifeste pas avant de nombreuses années. En conséquence, le syndicat aura vraisemblablement plus de succès si les travailleurs peuvent bloquer la production ou faire intervenir un inspecteur de l’Etat lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord.
Les conventions internationales du travail de l’OIT, qu’elles portent sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, sur le droit d’organisation et de négociation collective ou sur la sécurité et la santé au travail, reconnaissent le rôle des organisations de travailleurs. Ces instruments établissent un cadre international, mais seules la législation et la réglementation nationales garantissent dans la pratique les droits des travailleurs.
Naturellement, le fondement juridique, le niveau et même les modalités de la négociation collective varient selon les pays. La législation de la plupart des pays industriels comporte un système de réglementation de la négociation collective. Même dans l’Union européenne, la réglementation diffère grandement, passant d’une approche minimaliste en Allemagne à un cadre beaucoup plus élaboré en France. La portée légale des conventions collectives n’est pas non plus la même partout. Dans la plupart des pays, la loi oblige les parties à se conformer aux conventions collectives qui les lient. Par contre, au Royaume-Uni, les conventions sont considérées comme dépourvues de caractère obligatoire, et leur application dépend de la bonne foi des parties, renforcée par la menace d’un arrêt de travail. Ces écarts devraient se réduire au fur et à mesure des progrès de l’unification de l’Europe.
Le niveau de la négociation est lui aussi très différent. Aux Etats-Unis, au Japon et dans la plupart des pays d’Amérique latine, la négociation se fait dans chaque entreprise, bien que les syndicats essaient souvent de négocier des conventions «types» avec tous les grands employeurs d’une branche. A l’autre extrême, l’Autriche, la Belgique et les pays nordiques ont tendance à centraliser fortement la négociation; la plupart des entreprises sont régies par une convention-cadre négociée entre des fédérations nationales représentant les syndicats et les employeurs. Les ententes sectorielles portant sur des branches d’activité ou des professions particulières sont courantes dans certains pays, notamment en Allemagne et en France.
Les pays francophones d’Afrique tendent à suivre l’exemple de la France et à négocier par branche d’activité. C’est aussi le cas dans certains pays anglophones en développement, tandis que dans d’autres, plusieurs syndicats négocient au nom de différents groupes de travailleurs d’une seule entreprise.
Le niveau de la négociation détermine en partie la portée de la convention collective. En France et en Allemagne par exemple, la convention collective vise habituellement quiconque entre dans la profession ou la branche d’activité où elle s’applique. Par contre, aux Etats-Unis et dans d’autres pays où la négociation se déroule au niveau de l’entreprise, la convention collective s’applique uniquement aux établissements qui ont reconnu le syndicat comme agent négociateur.
La mesure dans laquelle la loi nationale facilite ou entrave la syndicalisation et la négociation collective est un facteur encore plus important pour déterminer la portée de cette négociation. Dans certains pays, par exemple, les salariés du secteur public ne sont pas autorisés à négocier collectivement. Dans d’autres, les syndicats du secteur public connaissent une croissance rapide. Il s’ensuit que le pourcentage des travailleurs régis par des conventions collectives varie énormément selon les pays: il culmine à près de 90% en Allemagne et dans les pays nordiques, et tombe à moins de 10% dans de nombreux pays en développement.
Le cadre juridique influe également sur la manière dont la négociation collective s’applique à la sécurité et à la santé au travail. Par exemple, la loi américaine sur la sécurité et la santé au travail confère aux organisations de travailleurs le droit à l’information sur les produits chimiques dangereux et autres risques dans l’établissement, le droit d’accompagner un inspecteur du travail et un droit limité de participation aux poursuites en justice intentées par le gouvernement contre un employeur pour infraction aux normes.
De nombreux pays vont plus loin. La plupart des pays industriels imposent aux entreprises de mettre sur pied des comités d’hygiène et de sécurité. La province de l’Ontario, au Canada, exige la nomination de délégués à la sécurité et à la santé par les travailleurs dans la plupart des lieux de travail, ainsi que leur formation aux frais de l’employeur. La loi sur le milieu de travail adoptée par la Suède dispose que chaque section locale d’un syndicat nomme des délégués à la sécurité. Ces délégués ont de larges droits à l’information et à la consultation, mais, surtout, ils sont habilités à suspendre l’exécution de tout travail dangereux en attendant la décision de l’inspection du travail.
Ces lois renforcent la négociation collective en matière de sécurité et de santé au travail. Les comités paritaires obligatoires de sécurité fournissent un mécanisme à l’usage de la négociation. La formation donne aux représentants syndicaux les connaissances dont ils ont besoin pour participer efficacement aux travaux des comités. Le droit d’interrompre tout travail dangereux incite les deux parties à éliminer les sources de danger.
En l’absence d’un mécanisme d’application, les conventions collectives n’ont à l’évidence qu’une valeur limitée. La grève est un des moyens dont disposent les organisations de travailleurs pour réagir à une violation présumée de la part de l’employeur; de son côté, l’employeur peut décréter un lock-out et priver les membres de l’organisation de travailleurs de leur emploi jusqu’à ce que le différend soit réglé. Cependant, la plupart des conventions collectives conclues dans les pays développés reposent sur des modalités d’application moins conflictuelles. De fait, maintes conventions collectives interdisent tout simplement la grève ou le lock-out pendant toute la durée de leur validité (clauses de non-recours à la grève et obligation de paix sociale). D’autres conventions restreignent l’exercice du droit de grève et de lock-out à des situations spécifiques; par exemple, les contrats négociés aux Etats-Unis entre le syndicat unifié des travailleurs de l’automobile et les grands constructeurs automobiles permettent le recours à la grève quand les conditions de travail ne sont pas sûres, mais non pour régler des questions concernant les salaires ou les avantages sociaux pendant la durée de la convention.
L’arbitrage est un mécanisme d’application courant dans les pays développés; les conflits sont renvoyés devant un arbitre impartial choisi d’un commun accord par l’employeur et l’organisation de travailleurs. Dans certains cas, les conflits peuvent être tranchés par le système judiciaire — tribunaux ordinaires, tribunaux spéciaux du travail ou commissions spéciales. Aux Etats-Unis, par exemple, tout litige concernant l’interprétation de la convention est habituellement soumis à l’arbitrage. Cependant, si la partie déboutée refuse de se conformer à la décision de l’arbitre, la partie ayant obtenu gain de cause peut s’adresser aux tribunaux pour la faire appliquer. Un organisme quasi judiciaire, la Commission nationale des relations professionnelles (National Labor Relations Board), connaît des plaintes relatives aux pratiques de travail déloyales, comme le refus de négocier de bonne foi de la part d’une partie. Dans de nombreux autres pays, ce sont les tribunaux du travail qui remplissent ce rôle.
La négociation collective est un processus dynamique dans tous les systèmes de relations professionnelles où elle est pratiquée. En Europe, la situation évolue rapidement. Les pays nordiques se caractérisent par des conventions collectives globales sur le milieu de travail qui sont négociées au niveau national et intégrées dans des lois très élaborées. La syndicalisation est très forte; les conventions collectives et la loi prescrivent la création de comités d’hygiène et de sécurité et la nomination de délégués à la sécurité dans la plupart des lieux de travail. Les autres pays européens ne disposent pas de mécanismes de négociation collective aussi pointus en matière de sécurité et de santé et le taux de syndicalisation n’y est pas aussi élevé. Les Etats membres de l’Union européenne sont appelés à harmoniser leur législation nationale aux termes de l’Acte unique européen et de la directive-cadre concernant la sécurité et la santé (Hecker, 1993). Les syndicats cherchent à coordonner leurs efforts, principalement à travers la Confédération européenne des syndicats. Certains signes montrent qu’en définitive la négociation nationale sera remplacée, ou plus vraisemblablement complétée, par des conventions au niveau européen, quoique cette perspective suscite une forte résistance des employeurs. Le congé parental est le premier exemple de ce type de négociation à l’échelle européenne. En matière de sécurité et de santé, le GMB, syndicat des employés municipaux, de la métallurgie et des industries diverses, au Royaume-Uni, a proposé la constitution d’un ambitieux fonds paneuropéen du milieu de travail, qui s’inscrirait dans la lignée des fonds de ce genre établis dans les pays nordiques.
En Europe centrale et orientale, ainsi que dans les anciens pays membres de l’Union soviétique, les choses changent encore plus rapidement. Sous le régime communiste, la réglementation en matière de sécurité et de santé était très étendue, mais rarement appliquée. Il existait certes des syndicats, mais ils étaient placés sous le contrôle du parti communiste. Dans les entreprises, les syndicats tenaient lieu de services de relations professionnelles contrôlés par la direction, sans aucune négociation bipartite. Les nouveaux syndicats indépendants ont précipité la chute du communisme; parfois, leurs revendications portaient sur les conditions de travail ou des mesures sanitaires aussi élémentaires que la fourniture de savon dans les douches pour les mineurs de charbon. Aujourd’hui, les anciens syndicats ont disparu ou luttent pour se reconstituer. Quant aux nouveaux syndicats indépendants, ils s’efforcent de se départir de leurs réflexes d’organisations politiques habituées à affronter le gouvernement pour devenir des organisations pratiquant la négociation collective et représentant leurs membres sur les lieux de travail. Les mauvaises conditions de travail qui, souvent, ne cessent de se dégrader vont demeurer une question importante.
Prônant la participation, le perfectionnement permanent et la formation continue des travailleurs, le système japonais encourage effectivement la sécurité et la santé, mais uniquement lorsque celles-ci font explicitement partie des objectifs de l’entreprise. La plupart des syndicats japonais n’existent qu’au niveau de l’entreprise; les négociations se déroulent dans un système de consultation permanente (Inohara, 1990). Des comités d’hygiène et de sécurité sont établis en application de la loi de 1972 sur la sécurité et l’hygiène du travail, telle que modifiée.
Les conventions collectives aux Etats-Unis comportent des dispositions assez détaillées sur la sécurité et la santé, et ce, pour deux raisons. Premièrement, la sécurité et la santé sont des enjeux importants pour les syndicats nord-américains, comme c’est le cas pour leurs homologues dans tous les pays industriels. Toutefois, la législation comporte de nombreuses lacunes par rapport à celle d’autres pays, ce qui force les syndicats à négocier des droits et des protections qui sont déjà garantis par la loi ailleurs dans le monde. Par exemple, les comités paritaires d’hygiène et de sécurité constituent un important mécanisme de négociation et de coopération au jour le jour entre les travailleurs et les employeurs, mais rien dans la loi des Etats-Unis sur la sécurité et l’hygiène en matière d’emploi n’exige la formation de tels comités. Par conséquent, les syndicats doivent négocier pour obtenir leur création, et comme le taux de syndicalisation est faible aux Etats-Unis, la majorité des travailleurs n’ont pas accès à ces comités. La protection juridique étant peu importante et peu claire, bon nombre de syndicats américains ont dû par ailleurs négocier dans leurs conventions des clauses interdisant toutes représailles contre les travailleurs qui refusent de travailler dans des conditions présentant des risques imminents et sérieux pour leur vie ou leur santé.
Au Canada, la législation diffère d’une province à une autre, mais elle est généralement plus contraignante que celle des Etats-Unis. Les syndicats n’ont pas à négocier pour obtenir la création de comités d’hygiène et de sécurité, mais ils peuvent le faire pour les élargir ou leur donner des pouvoirs accrus. La loi mexicaine impose aussi la constitution de comités d’hygiène et de sécurité.
Dans les pays en développement, la situation varie. Les organisations de travailleurs du Brésil, de l’Inde et du Zimbabwe, entre autres, accordent de plus en plus d’importance à la sécurité et à la santé, en organisant des campagnes pour améliorer la législation et en recourant à la négociation collective. Ainsi, le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) s’est battu pour que le Code national du travail — y compris les dispositions sur la sécurité et la santé — s’applique aussi dans les zones franches d’exportation (voir encadré). Dans bien des régions du monde, les syndicats sont très contrôlés, voire carrément interdits, et la grande majorité des travailleurs des pays en développement n’appartient à aucune organisation et ne bénéficie pas de la négociation collective.
|
Afin de faire modifier la législation et d’améliorer les conventions collectives, le Congrès des syndicats du Zimbabwe (Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU)) a lancé une campagne nationale en faveur des droits des victimes d’accidents du travail, qui conjugue des mesures à prendre au niveau national et dans les entreprises. Depuis 1990, la législation du Zimbabwe prévoit l’établissement de comités de sécurité, la nomination de délégués à la sécurité et à la santé au travail et de surveillants de la sécurité dans tous les lieux de travail. Le ZCTU insiste pour que les délégués soient élus par les travailleurs. Sa campagne nationale comporte trois revendications: 1. Travail en sécurité. Il s’agit de déterminer les risques sur les lieux de travail au moyen d’enquêtes sur les accidents et de négocier pour obtenir de meilleures conditions. 2. Participation des travailleurs et des syndicats aux questions de santé des travailleurs. Les travailleurs doivent pouvoir élire leurs propres délégués à la sécurité et à la santé, obtenir des informations, par exemple des fiches de données de sécurité et des rapports d’inspecteurs du travail, participer aux enquêtes et à l’établissement de rapports sur les accidents et les lésions professionnelles (comme c’est le cas en Suède). 3. Réparation et prestation de soins adéquats aux victimes d’accidents de travail. Ce point s’étend à la révision des barèmes d’indemnisation. 4. Sécurité de l’emploi pour les victimes d’accidents du travail. Les représentants syndicaux ont négocié le droit des victimes d’accidents du travail de retrouver un emploi et de bénéficier de mesures facilitant leur placement. Pour le ZCTU, le programme de formation visant à accroître la participation réelle des travailleurs à la sécurité et à la santé dans l’atelier est une étape cruciale dans la prévention des accidents. La formation des représentants des travailleurs a consisté en visites des lieux de travail et en préparation de rapports sur tous les risques identifiés; ces rapports sont d’abord communiqués aux travailleurs avant d’être remis à la direction aux fins de discussion. Une fois en fonction, les délégués syndicaux à la sécurité et à la santé participent aux inspections et veillent à ce que les accidents soient déclarés. Il s’agit là d’une mesure particulièrement importante dans des secteurs qui, sans cela, seraient inaccessibles, comme l’agriculture. Le ZCTU exige également l’imposition de sanctions plus élevées aux employeurs reconnus coupables d’infractions à la législation relative à la sécurité et à la santé. par la rédactrice de ce chapitre (texte tiré de Loewenson, 1992). |
Les organisations de travailleurs et la négociation collective devront relever des défis importants au cours des années à venir. Pratiquement, toute la négociation collective a lieu dans les entreprises, les branches d’activité ou encore au niveau national. Or, la mondialisation de l’économie ne cesse de progresser. En dehors de l’Europe, les organisations de travailleurs n’ont pas encore mis au point des mécanismes efficaces de négociation transfrontalière. La négociation collective multinationale est un objectif prioritaire des fédérations internationales du travail. Le meilleur moyen de la promouvoir passe par des structures syndicales internationales plus fortes et plus efficaces, de solides clauses sociales dans les accords sur le commerce international et des instruments internationaux adaptés à la situation, comme ceux qu’a mis en place l’Organisation internationale du Travail. Par exemple, la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale contient des dispositions précises sur la négociation collective, ainsi que sur la sécurité et la santé au travail. De nombreux syndicats nouent des liens directs avec leurs homologues d’autres pays pour coordonner leurs négociations et se prêter assistance. Les relations entre les syndicats de mineurs des Etats-Unis et ceux de la Colombie en sont un bon exemple (Zinn, 1995).
Les progrès technologiques et l’évolution rapide de l’organisation du travail risquent de balayer les conventions collectives en vigueur. Les organisations de travailleurs cherchent à mettre en place une forme de négociation continue pour faire face aux changements qui affectent les lieux de travail. Elles ont pris conscience depuis longtemps des liens qui existent entre le milieu de travail et l’environnement. Certains syndicats ont commencé à intégrer les enjeux de l’environnement dans les conventions collectives et dans les programmes éducatifs qu’ils organisent à l’intention de leurs membres. C’est le cas, par exemple, du syndicat des industries manufacturières-sciences-finances (Manufacturing-Science-Finance (MSF)) au Royaume-Uni, qui propose un accord modèle sur l’environnement.
L’un des buts fondamentaux des syndicats est de mettre les droits de l’homme et le bien-être à l’abri de la concurrence économique — afin d’empêcher une entreprise ou une nation d’appauvrir ses travailleurs et de les forcer à travailler dans des conditions dangereuses pour s’assurer un avantage concurrentiel. La négociation collective est primordiale pour la sécurité et la santé. Pourtant, les organisations de travailleurs, essentielles à la négociation collective, sont en butte à des attaques dans de nombreux pays, qu’ils soient développés ou en développement. Seules leur pérennité et leur vitalité permettront à la plupart des travailleurs de jouir d’un meilleur niveau de vie et de meilleures conditions de travail; sinon, ils s’enfonceront dans le cycle de la pauvreté, des accidents et des maladies.
La coopération entre les travailleurs, les employeurs et le gouvernement pour l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de sécurité et de santé au travail, au niveau national ou régional, est chose courante dans un grand nombre de pays. Il est fréquent également que les groupes d’intérêts et les spécialistes participent à ce processus. Cette coopération est très poussée et elle a été institutionnalisée dans plusieurs pays par la création d’organismes de consultation et de collaboration. Ces organismes sont en principe très bien acceptés par tous les acteurs du marché du travail pour lesquels la sécurité et la santé au travail constituent une préoccupation commune et qui attachent une grande importance au dialogue entre les partenaires sociaux, le gouvernement et les autres parties intéressées.
La forme des institutions qui ont été mises sur pied pour faciliter cette coopération varie considérablement. Une approche consiste à établir des organismes consultatifs ad hoc ou permanents pour conseiller le gouvernement sur les questions relatives à la politique de sécurité et de santé au travail. Techniquement, le gouvernement n’est pas obligé de suivre les recommandations qui lui sont faites mais, en pratique, il lui est difficile de ne pas en tenir compte.
Une autre approche veut que les partenaires sociaux et les autres parties intéressées coopèrent activement avec le gouvernement au sein des institutions publiques chargées de mettre en œuvre la politique de sécurité et de santé au travail. La participation des intervenants non gouvernementaux dans les institutions publiques responsables de ces questions passe normalement par la représentation des organisations d’employeurs et de travailleurs et, dans certains cas, d’autres parties, au conseil d’administration de l’institution; parfois, la participation s’étend à la gestion et même à la réalisation des projets. Dans la plupart des cas, les représentants en question sont nommés par le gouvernement sur recommandation des parties représentées; dans d’autres, les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de nommer directement leurs représentants. Les organes au niveau national (ou de la région, de l’Etat ou de la province) sont normalement dotés de structures ou de dispositifs intéressant la branche d’activité, l’entreprise ou l’établissement.
La constitution d’organismes consultatifs chargés de conseiller le gouvernement sur l’élaboration des politiques et des normes est sans doute la forme la plus courante de coopération. On en trouve des exemples très divers — de la version modeste nécessitant peu de ressources, aux approches plus institutionnalisées qui en appellent de plus considérables. Les Etats-Unis sont un bon exemple d’un pays retenant une approche restrictive. Au niveau fédéral, la Commission consultative nationale de sécurité et d’hygiène du travail (National Advisory Committee on Occupational Safety and Health), établie en vertu de la loi de 1970 sur la question, est le principal organe consultatif permanent. Cette commission comprend des représentants des employeurs et des salariés, des spécialistes de la sécurité et de l’hygiène du travail, ainsi qu’un représentant de l’intérêt général qui assure la présidence. La Commission est chargée de faire des recommandations au secrétaire au travail et au secrétaire à la santé et au bien-être. En pratique, toutefois, la Commission ne s’est pas réunie souvent. Ses membres ne sont pas rémunérés et le secrétariat au travail finance, sur son budget, les services d’une personne chargée du secrétariat général et, au besoin, d’autres services de soutien. Les frais de fonctionnement de cette commission sont donc très modiques, bien que les contraintes budgétaires actuelles menacent même ces services de soutien. Un organe permanent similaire, le Conseil consultatif fédéral de la sécurité et de la santé au travail (Federal Advisory Council on Occupational Safety and Health), a été établi en juillet 1971, aux termes du décret-loi 11612; il a pour mission de conseiller le secrétaire au travail sur les sujets concernant la sécurité et la santé des travailleurs fédéraux.
La loi de 1970 sur la sécurité et l’hygiène du travail prescrit aussi l’établissement de comités consultatifs spéciaux pour aider à l’élaboration des normes. Ces comités sont nommés par le secrétaire au travail et se composent de quinze membres au maximum, dont un ou plusieurs sont désignés par le secrétaire à la santé et au bien-être. Chaque comité doit comprendre un nombre égal de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. Le secrétaire au travail peut aussi nommer un ou plusieurs représentants des organismes responsables de la sécurité et de l’hygiène dans les Etats fédérés, ainsi que des experts, par exemple des représentants des organisations professionnelles de techniciens ou de spécialistes de la sécurité et de la santé au travail, ou d’organisations nationales de normalisation. On recourt abondamment à ces comités qui demeurent parfois en exercice durant plusieurs années pour remplir leur mandat. Les réunions peuvent être fréquentes, selon la nature des travaux à accomplir. Bien que les membres de ces comités ne soient en principe pas rémunérés, le secrétaire au travail leur rembourse leurs frais de déplacement sur une base raisonnable et paie les services de soutien comme par le passé. Des comités ont ainsi été constitués pour élaborer des normes sur l’agriculture, les poussières d’amiante, les substances cancérogènes, les émissions des fours à coke, les risques de contamination cutanée, l’étiquetage des produits dangereux, les contraintes thermiques, les installations des terminaux maritimes, le bruit, la sécurité et la santé des dockers, l’emploi sur les chantiers navals, le montage des structures d’acier, etc.
D’autres comités spéciaux du même type établis aux termes de lois analogues relèvent du secrétaire au travail. C’est notamment le cas des comités établis en application de la loi fédérale de 1977 sur la sécurité et la santé dans les mines. Malgré tout, les coûts liés à la constitution et au fonctionnement de ces comités restent plutôt modestes: frais administratifs réduits; infrastructure légère; participation bénévole des intervenants externes; dissolution du comité dès la fin de son mandat.
D’autres pays ont adopté des formes plus élaborées et institutionnalisées de consultation. Ainsi, aux Pays-Bas, le Conseil du milieu de travail est l’organisme supérieur établi en application de la loi de 1990 sur le même sujet. Sur demande ou de son propre chef, le Conseil donne des avis au ministère des Affaires sociales et de l’Emploi et fait part de ses observations concernant les nouveaux projets de loi; il peut aussi proposer une nouvelle politique ou une nouvelle mesure législative. Il est également appelé à se prononcer sur l’octroi des subventions et des bourses de recherche sur le milieu de travail, sur les autorisations d’exemption, sur la formulation des directives gouvernementales et sur la politique de l’inspection du travail. Le Conseil comprend huit représentants des organisations centrales d’employeurs, huit des organisations centrales de travailleurs et sept des organismes gouvernementaux. Seuls les représentants des employeurs et des travailleurs ont le droit de vote et la présidence du Conseil est confiée à une personne indépendante. Le Conseil se réunit tous les mois. Il a établi une quinzaine de comités de travail sur des sujets spécifiques; de plus, des groupes de travail ad hoc sont constitués au besoin sur des questions plus précises. Les experts externes jouent un rôle important au sein des comités et des groupes de travail; ces organes préparent des rapports et des documents qui sont examinés lors des réunions du Conseil et forment souvent la base des positions que celui-ci adoptera par la suite. Le Conseil présente des recommandations générales qui sont publiées. Le plus souvent, les parties essaient de parvenir à un consensus; les opinions dissidentes sont transmises au ministre des Affaires sociales et de l’Emploi. Plus d’une centaine de personnes participent aux travaux du Conseil et à ceux de ses organes affiliés; le Conseil mobilise d’importantes ressources administratives et financières.
D’autres organismes consultatifs de moindre envergure existent aux Pays-Bas et traitent de questions plus spécifiques de sécurité et de santé au travail. On peut notamment citer la Fondation pour le milieu de travail dans le bâtiment, la Fondation pour les soins de santé en agriculture, la Commission pour la prévention des catastrophes causées par les substances dangereuses et la Commission de l’inspection du travail et de la politique d’application.
Parmi les autres pays dotés d’organismes consultatifs bipartites, tripartites ou multipartites chargés de faire des recommandations sur les politiques et les normes de sécurité et de santé au travail figurent le Canada (Comités spéciaux sur la réforme législative et l’établissement des normes, au niveau fédéral; Forum pour l’action en matière de santé et de sécurité au travail, en Alberta; Comité directeur mixte sur les substances dangereuses utilisées en milieu de travail, en Ontario; Comité consultatif pour la prévention des dorsalgies, à Terre-Neuve; Comité de sécurité et de santé au travail, à l’île du Prince-Edouard; Conseil consultatif sur la sécurité et la santé au travail, au Manitoba; Conseil de la sécurité et de la santé au travail, dans la Saskatchewan; Forum pour la sécurité dans la foresterie, en Colombie-Britannique). On peut aussi ajouter le Danemark (Conseil du milieu de travail); la France (Conseil central pour la prévention des risques professionnels et Commission nationale de l’hygiène et de la sécurité du travail en agriculture); l’Italie (Commission consultative permanente pour la prévention des accidents du travail et la santé au travail); l’Allemagne (Conseil consultatif auprès de l’Institut fédéral de la sécurité et de la santé au travail); et l’Espagne (Conseil général de l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail).
Dans plusieurs pays, des organismes bipartites, tripartites ou multipartites collaborent aussi à l’application de la politique. Il s’agit habituellement d’instances publiques qui regroupent des représentants des employeurs et des travailleurs et, dans certains cas, d’autres personnes ou groupes d’intérêts, et qui élaborent la politique et la mettent en œuvre. Normalement, ces organismes sont d’une taille beaucoup plus importante que les comités, commissions ou conseils consultatifs et sont responsables de l’application de la politique gouvernementale; ils gèrent souvent des budgets importants et disposent d’un nombreux personnel.
La Commission de la sécurité et de la santé (Health and Safety Commission (HSC) du Royaume-Uni), établie aux termes de la loi de 1974 sur la sécurité et l’hygiène au travail, est un bon exemple de ce genre d’organisme. Elle s’assure que des mesures adéquates sont prises pour garantir la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs, protéger la population contre les risques professionnels, contrôler l’entreposage et l’utilisation des explosifs, des produits hautement inflammables et autres substances dangereuses, et limiter l’émission de substances nocives ou sensibilisantes en milieu de travail. Cette commission relève du secrétariat d’Etat à l’éducation et à l’emploi, mais rend également compte à d’autres secrétariats d’Etat — commerce et industrie, transports, environnement et agriculture. Elle est composée de 9 personnes, toutes nommées par le secrétaire d’Etat à l’éducation et à l’emploi: un président, 3 membres nommés après consultation de l’organisation d’employeurs la plus représentative, 3 membres nommés après consultation de la principale centrale syndicale, et 2 membres nommés après consultation d’associations d’autorités locales.
La commission est assistée de plusieurs organismes subsidiaires (voir figure 21.3), dont le plus important est la Direction de la sécurité et de la santé (Health and Safety Executive (HSE)), organe statutaire distinct dirigé par trois personnes nommées par la commission avec l’approbation du secrétaire d’Etat à l’éducation et à l’emploi. Cet organe est chargé de l’exécution des tâches de la commission, notamment l’application des normes établies en vertu de ladite loi de 1974 sur la santé et la sécurité et exerce d’autres fonctions qui lui sont déléguées par la commission. Les autorités locales assument aussi des responsabilités relatives à l’application de certains volets de la législation en matière de sécurité et de santé. De plus, plusieurs comités consultatifs bipartites, tripartites ou multipartites, selon le cas, assistent la commission dans ses travaux. Ces comités sont organisés soit par sujet d’étude: substances toxiques, agents pathogènes virulents, substances dangereuses, modifications génétiques, santé au travail, émissions dans l’environnement, installations nucléaires et rayonnements ionisants, soit par branche d’activité: agriculture, céramique, construction, enseignement, fonderies, santé, pétrole, papier et carton, imprimerie, transports ferroviaires, caoutchouc, coton et textiles. Les comités par sujet à caractère multipartite comptent de 12 à 18 membres et un président; ils comprennent souvent des experts ainsi que des représentants des organisations centrales de travailleurs et d’employeurs, du gouvernement et d’autres groupes d’intérêts. Pour leur part, les comités par branche d’activité sont surtout bipartites et comprennent une dizaine de membres représentant en nombre égal les organisations centrales de travailleurs et d’employeurs, la présidence étant assurée par un représentant du gouvernement. La HSC et le HSE disposent de ressources considérables. En 1993, ils employaient 4 538 personnes et avaient un budget de 211,8 millions de livres sterling.
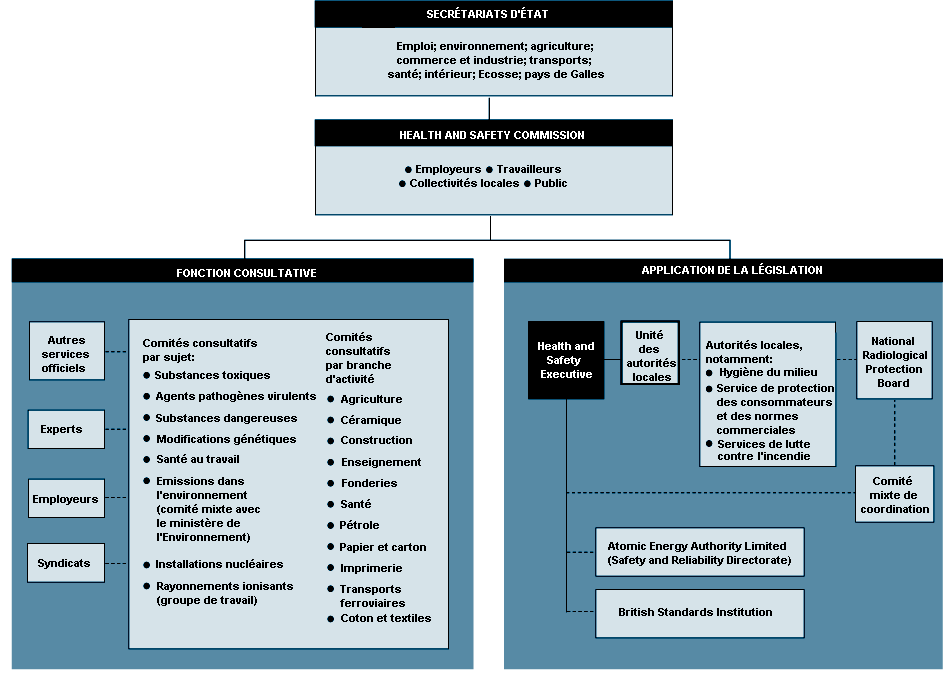
On trouve au Canada d’autres exemples d’organismes ayant vocation de collaboration. Au niveau fédéral, le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail est la principale source canadienne d’information sur le sujet. Outre cette fonction d’information, le Centre s’emploie à promouvoir la santé et la sécurité en milieu de travail, encourage l’établissement de normes strictes en la matière et contribue à l’élaboration de programmes et de politiques visant à réduire ou à éliminer les risques professionnels. Le Centre a été institué en application d’une loi adoptée par le parlement en 1978; il est doté d’un organe directeur tripartite qui en garantit l’impartialité en matière de sécurité et de santé au travail et l’objectivité sur le plan de l’information. Cet organe directeur comprend un président et 12 gouverneurs, dont 4 représentent le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, 4 les syndicats, et 4 les employeurs. Le Centre dispose d’importantes ressources humaines et financières; en 1993, ses dépenses ont totalisé environ 8,3 millions de dollars canadiens.
Il existe aussi dans les provinces des organismes ayant vocation de collaboration. Au Québec, les deux plus importants sont la Commission de la santé et la sécurité au travail (CSST) et l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail (IRSST). La CSST remplit deux fonctions. La première est d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de santé et de sécurité au travail, y compris l’établissement et l’application de normes, et d’assurer les services suivants: soutien à la réalisation de programmes de prévention et à la concrétisation de mécanismes de participation et de services de santé; formation, information et recherche. La deuxième consiste à indemniser les victimes d’accidents du travail et à gérer le fonds d’assurance établi dans ce but, auquel les employeurs sont tenus de contribuer. La CSST, qui a été instituée en vertu d’une loi adoptée en 1981 et qui a remplacé la Commission des accidents du travail fondée en 1931, est dotée d’un conseil d’administration bipartite composé de 7 représentants des travailleurs, de 7 représentants des employeurs et d’un président. Les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis sur les listes proposées par les organisations les plus représentatives des deux parties. La CSST gère d’imposantes ressources humaines et financières; à la fin de 1992, elle comptait 3 013 employés permanents et 652 employés temporaires, et ses dépenses s’élevaient à 2 151,7 millions de dollars canadiens.
L’IRSST, fondé au Québec en 1980, a pour mandat de contribuer, par la recherche scientifique, à la détermination et à l’élimination des risques sur les lieux de travail, ainsi qu’à la réadaptation des travailleurs victimes d’accidents du travail. Le conseil d’administration de l’Institut est le même que celui de la CSST, bien qu’il s’agisse d’une institution indépendante. L’Institut compte aussi un conseil scientifique consultatif composé de 4 représentants des organisations de travailleurs, de 4 représentants des organisations d’employeurs, de 6 représentants de la communauté scientifique et technique, et de son directeur général. En 1992, les dépenses de l’Institut, qui employait 126 personnes, étaient de 17,9 millions de dollars canadiens.
En Ontario, l’Agence pour la santé et la sécurité au travail, fondée en 1990 aux termes d’un amendement à la loi sur la santé et la sécurité au travail, est également chargée d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de prévention de cette province et d’en gérer les programmes. Son conseil d’administration bipartite comprend 18 personnes: les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs y ont respectivement 9 représentants. Un représentant de chacune des deux parties assume la fonction de coprésident-directeur général. L’agence dispose d’importantes ressources: 64,9 millions de dollars canadiens en 1992.
La Suède avait une longue tradition d’organismes de collaboration dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, mais en 1992 elle a décidé de rejeter cette forme d’organisation au profit d’organismes consultatifs. Précisons que cette réforme ne se limitait pas à la sécurité et à la santé au travail, mais qu’elle visait aussi tous les organismes ayant vocation de collaboration dans lesquels les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs avaient un pouvoir de décision au niveau national. C’est la principale organisation d’employeurs qui a été à l’origine du changement en décidant unilatéralement de se retirer des institutions publiques ayant vocation de collaboration. Pour elle, les groupes de pression ne doivent exercer aucune responsabilité politique dans la gestion des institutions publiques et doivent laisser au parlement et au gouvernement ce rôle et cette responsabilité politiques. Elle estimait en outre que la fonction de toute organisation d’employeurs est de représenter les intérêts de ses membres, intérêts qui peuvent être en contradiction avec ceux des institutions publiques dès lors que cette organisation est représentée aux conseils d’administration de ces institutions et que sa participation a pour effet d’affaiblir la démocratie et nuit au développement des institutions publiques. Les organisations de travailleurs ne partageaient pas ce point de vue, mais le gouver-nement a conclu que, sans représentation de la principale organisation d’employeurs, les organes à vocation de collaboration n’avaient plus de raison d’être; il a donc décidé que les travailleurs, les employeurs et autres groupes de pression seraient représentés uniquement par des organismes consultatifs. Par conséquent, les anciens organismes s’occupant de prévention, notamment la Commission nationale de la sécurité et de la santé au travail, l’Institut national de la santé au travail et le Fonds pour la vie active, qui étaient auparavant dotés d’organes de contrôle tripartites ou multipartites, ont été restructurés.
Bien que dans la plupart des pays, les organismes de collaboration soient plus rares que les organismes consultatifs, la suppression des institutions suédoises du premier type, tout au moins dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, semble être un cas isolé. Au Royaume-Uni, si certaines de ces institutions, notamment celles qui s’occupaient de politique économique, de formation et d’emploi, ont été démantelées au cours des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix par les gouvernements conservateurs successifs, la HSC n’a pas été touchée. Certains voient dans cette décision le fait que la sécurité et la santé au travail préoccupent autant les organisations d’employeurs et de travailleurs que le gouvernement et les autres parties intéressées et que tous ont intérêt à s’entendre sur l’élaboration et l’application de la politique y relative. Au Canada, des organismes ayant vocation de collaboration ont été créés au niveau fédéral et dans certaines provinces, précisément parce que l’on a jugé cette approche plus propice à la conclusion d’un accord entre les acteurs du marché du travail, et parce que l’application des lois sur la sécurité et la santé au travail paraîtrait ainsi plus juste et plus impartiale aux intéressés.
Sur un plan plus général, il existe cependant deux organismes consultatifs nationaux qui s’occupent aussi de sécurité et de santé au travail, mais dans le cadre de leurs vastes mandats respectifs: en effet, ils sont appelés à se prononcer sur toutes les grandes questions sociales et économiques d’importance nationale. Aux Pays-Bas, la Fondation du travail, instituée en mai 1945, est un organisme bipartite géré conjointement par un nombre égal de représentants des organisations centrales d’employeurs et de travailleurs (y compris les agriculteurs) et joue un rôle consultatif important auprès du gouvernement. Historiquement, sa principale fonction est de s’occuper des questions de politique salariale, mais elle fait également valoir son point de vue sur d’autres conditions de travail. Le deuxième organisme consultatif national d’envergure aux Pays-Bas est le Conseil économique et social, qui a été fondé en 1950 en vertu de la loi sur l’organisation de l’industrie. Ce conseil tripartite comprend 15 représentants des organisations centrales patronales, 15 représentants des centrales syndicales et 15 experts indépendants. Les représentants des employeurs et des travailleurs sont nommés par leurs organisations respectives, tandis que les experts indépendants le sont par l’Etat. En procédant à ces nominations, l’Etat s’efforce de maintenir un juste équilibre entre les principaux partis politiques. Le Conseil est indépendant du gouvernement; il est financé par un impôt payé par les employeurs. Il dispose d’un budget de plusieurs millions de dollars E.-U. et de son propre secrétariat général. Le Conseil se réunit normalement une fois par mois; il est assisté de plusieurs comités permanents et spéciaux, souvent à composition tripartite. Le gouvernement est légalement tenu de soumettre à l’avis du Conseil tous les projets de loi portant sur des questions socio-économiques et sur la législation du travail, dont font partie les propositions relatives à la sécurité et à la santé au travail.
Ajoutons enfin qu’un certain nombre de pays exigent que des comités d’hygiène et de sécurité soient constitués, ou qu’ils puissent l’être, dans les entreprises qui emploient plus d’un certain nombre de salariés. Ces comités sont bipartites et comprennent des représentants des employeurs et des travailleurs. Ils ont normalement pour fonction d’étudier et de proposer les voies et moyens permettant de contribuer activement à la concrétisation des mesures visant à garantir les meilleures conditions de sécurité et de santé possibles dans l’établissement; ce rôle peut comprendre la promotion et la surveillance des conditions de sécurité et de santé dans l’entreprise afin de veiller, entre autres, au respect des lois et règlements en vigueur. Ces comités mixtes ont normalement un caractère consultatif. La loi impose la création de comités de sécurité et de santé en Allemagne, en Belgique, au Canada, en Espagne, en France et aux Pays-Bas, par exemple.
L’expression participation des travailleurs est très large et englobe diverses formes de participation à la prise de décisions, habituellement au niveau de l’entreprise. Elles s’ajoutent à d’autres formes de participation dans la branche d’activité et au niveau national, par exemple au sein des organismes de coopération tripartites. Les modalités de la participation des travailleurs diffèrent grandement selon leurs fonctions et leurs pouvoirs, qui vont de la simple suggestion d’un employé à la cogestion de certaines activités par les représentants des travailleurs et la direction. Les mécanismes utilisés pour stimuler la participation des salariés varient tellement qu’il est impossible de les passer ici tous en revue. Nous nous limiterons aux principales formes de participation qui ont suscité de l’intérêt ces derniers temps, particulièrement dans le domaine de l’organisation du travail; on peut y ajouter l’exemple historique de l’autogestion telle qu’elle était pratiquée par les travailleurs dans l’ancienne Yougoslavie. Particulièrement pertinents de nos jours, les comités mixtes de sécurité et de santé sont examinés comme une forme particulière de participation des travailleurs dans le contexte plus large des relations professionnelles.
L’idée de la participation des travailleurs est née en Europe, où la négociation collective se déroule habituellement par branche ou par industrie; auparavant, cette situation laissait souvent un vide sur le plan de la représentation des travailleurs au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, vide que les conseils d’usine, les comités de travailleurs, les comités d’entreprise, etc., ont comblé. De nombreux pays en développement ont également adopté des dispositions législatives en vue de se doter de comités d’entreprise ou de structures similaires (Pakistan, Thaïlande, Zimbabwe, par exemple) pour promouvoir la coopération entre la direction et les travailleurs. Les relations entre ces comités et les syndicats et la négociation collective ont donné lieu à nombre de négociations et à un travail législatif important. L’article 5 de la convention (no 135) de l’OIT concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder, 1971, reflète cette situation: «lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises [...] pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats [...].»
Les travailleurs peuvent participer directement à la prise de décisions, ou indirectement par l’entremise de leurs représentants — syndicats ou représentants élus. A compter des années quatre-vingt, la participation directe des travailleurs s’est développée, pour peu que l’on comprenne la participation comme un moyen d’influer sur le travail ou sur la façon dont il doit être exécuté. Ainsi, les travailleurs peuvent «participer» à des décisions concernant le travail même quand l’établissement n’est pas doté d’un organe établi à cet effet, un cercle de qualité par exemple. En conséquence, un simple exercice d’enrichissement des tâches peut constituer une forme de promotion de la participation directe des travailleurs.
La participation directe peut intervenir sur le plan individuel — par exemple, dans le cadre de programmes de suggestions ou d’enrichissement des tâches. Elle peut aussi se faire en groupe — comme dans les cercles de qualité ou des groupes analogues restreints. Le travail en équipe constitue en soi une forme de participation directe de groupe. La participation directe peut être intégrée dans la prise de décisions concernant le travail de tous les jours, ou se faire en dehors du quotidien, notamment en cas d’adhésion volontaire à un cercle de qualité qui se démarque de la structure de groupe utilisée habituellement. La participation directe peut aussi revêtir un caractère «consultatif» ou «délibératif». Dans une étude, la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail s’est penchée de manière relativement approfondie sur cette facette particulière de la participation directe (Regalia et Gill, 1996). La participation consultative encourage les travailleurs à s’exprimer à titre individuel ou collectif, et elle leur en donne les moyens, mais il appartient à la direction d’accepter ou de rejeter leurs propositions. La participation délibérative confie aux salariés certaines responsabilités traditionnelles de la direction, comme c’est le cas pour le travail en équipe ou les groupes de travail semi-autonomes dans lesquels certains pouvoirs sont délégués aux travailleurs.
L’expression comités d’entreprise désigne des organes de représentation des travailleurs, d’ordinaire au niveau de l’établissement, mais aussi à des niveaux supérieurs (société, groupe de sociétés, branche d’activité, Union européenne). La relation avec les syndicats est souvent définie par la loi ou précisée dans la convention collective, mais il arrive parfois que des tensions persistent entre ces institutions. Le recours aux comités d’entreprise, parfois appelés conseils d’entreprise, conseils d’usine, comités de travailleurs, comités de coopération, etc., est très répandu; c’est une pratique bien ancrée dans plusieurs pays européens, notamment en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France et aux Pays-Bas; sous l’impulsion de la directive 94/45/CE de 1994 sur les comités d’entreprise européens, on peut s’attendre à ce qu’elle se développe encore au sein des grandes entreprises de cette région. Plusieurs pays d’Europe centrale et orientale, dont la Hongrie et la Pologne, ont adopté des lois qui favorisent l’instauration de comités d’entreprise. Ces comités existent également dans certains pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie; par exemple, la réforme du droit du travail entreprise en Afrique du Sud après l’abolition de l’apartheid porte en partie sur l’instauration d’un régime particulier de comités d’entreprise, parallèlement aux structures syndicales.
C’est l’Allemagne qui offre le meilleur exemple des prérogatives qui peuvent être accordées aux comités d’entreprise, bien qu’à certains égards il s’agisse d’un cas unique. Weiss (1992) décrit les comités d’entreprise dans ce pays comme une forme de représentation institutionnalisée des intérêts des travailleurs dans un établissement. Le comité d’entreprise jouit de droits à l’information, à la consultation (comme dans tous les pays) et à la cogestion (ce qui est beaucoup plus rare). La cogestion est la forme la plus poussée de participation; elle prévoit la participation aux dispositions sur la sécurité et la santé au travail et l’adoption officielle d’un plan visant à concilier les intérêts des parties et d’un «plan social» dans l’éventualité d’une modification importante dans l’établissement, comme la fermeture d’un atelier. Les droits de cogestion s’étendent aussi aux directives concernant la sélection et l’évaluation du personnel, la formation en cours d’emploi et les mesures touchant les travailleurs à titre individuel — classification, mutation et licenciement, par exemple. Le comité d’entreprise allemand est habilité à conclure des conventions à son niveau et à porter plainte s’il estime que la convention n’est pas respectée. Au nombre des questions relevant obligatoirement de la cogestion figurent notamment: la prévention des accidents et la protection de la santé, le règlement interne de l’entreprise, l’organisation du temps de travail, la détermination des taux de rémunération au rendement, le mode de paiement et les principes généraux régissant les congés. Pour toutes ces questions, l’employeur ne peut agir sans le consentement du comité. Le comité d’entreprise est également habilité à décider de saisir la commission d’arbitrage de l’établissement de toute question visant à faire appliquer les dispositions prises. Comme l’explique Weiss (1992), le rôle du comité est de participer à l’application des décisions après que l’employeur les a prises. Le droit de consultation permet au comité d’influer sur les décisions de l’employeur, mais l’absence de consultation n’a pas pour effet d’invalider celles-ci. Voici quelques-uns des sujets pour lesquels la consultation est obligatoire: la protection contre le licenciement; la protection contre les risques techniques; la formation; la préparation d’un plan social.
Le comité d’entreprise doit observer les principes de la coopération avec l’employeur et préserver la paix dans l’entreprise (aucun arrêt de travail); il doit aussi coopérer avec les syndicats en place et avec l’organisation d’employeurs compétente. Il doit mener ses activités en toute impartialité, sans discrimination fondée sur la race, la religion ou la croyance, la nationalité, l’origine, l’activité politique ou syndicale, le sexe ou l’âge des salariés. L’employeur fournit au comité d’entreprise les installations et les moyens financiers nécessaires et est responsable de ses actions.
En Allemagne, les comités d’entreprise sont élus par les travailleurs manuels et les employés dans des élections distinctes. Bien qu’il n’y ait aucun lien juridique entre les représentants élus au comité d’entreprise et les délégués syndicaux, en pratique il s’agit souvent des mêmes personnes. En Allemagne et en Autriche, une représentation particulière est garantie aux travailleurs handicapés, aux jeunes travailleurs et aux stagiaires. Les membres du comité ne sont pas rémunérés, mais les dépenses qu’ils sont appelés à faire dans l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursées. A l’expiration de leur mandat, les membres retrouvent le même niveau de rémunération et de classification et jouissent d’une protection spéciale contre le licenciement. Ils doivent bénéficier du temps libre nécessaire aux activités du comité et aux cours de formation. Toutes ces garanties sont conformes à l’article 1 de la convention (no 135) de l’OIT concernant les représentants des travailleurs, qui dispose qu’ils «bénéficient d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs [...]».
Dans de nombreux pays, les modèles de comités d’entreprise sont moins ambitieux et ne confèrent que des droits à l’information et à la consultation. L’établissement d’un comité d’entreprise ou d’un comité de travailleurs, surtout lorsque le syndicat est faiblement implanté dans les ateliers, offre au personnel une bonne occasion de se faire entendre sur le lieu de travail.
Les cercles de qualité et autres activités de groupe se sont rapidement implantés dans un grand nombre d’entreprises de quelques pays d’Europe occidentale (notamment en France et au Royaume-Uni) au début des années quatre-vingt, comme cela s’était produit un peu plus tôt aux Etats-Unis. Ils s’inspirent des programmes de «qualité de la vie au travail» (QVT) ou d’«humanisation du travail» qui ont été lancés au début des années soixante-dix. Ils se sont répandus beaucoup plus tard dans d’autres pays occidentaux (Allemagne) et sont encore très peu nombreux, semble-t-il, dans les pays où les groupes de projet paritaires sont la formule la plus courante pour traiter de l’organisation du travail, comme en Suède. A l’époque, leur essor reposait sur la conviction que la capacité du Japon de fabriquer à bas coût des produits innovants de haute qualité était due à ses méthodes de gestion des ressources humaines; les cercles de qualité étaient l’élément caractéristique le plus visible et le plus facilement transposable du modèle japonais. On s’attend généralement à ce que les cercles de qualité produisent deux effets: d’une part, améliorer la qualité et la productivité et, d’autre part, susciter chez les travailleurs le sentiment de participer aux décisions, ce qui entraîne une plus grande satisfaction au travail et l’amélioration des relations professionnelles. Le Japon a misé surtout sur le premier aspect, alors que l’Amérique du Nord et l’Europe ont privilégié le second. On constate également des différences structurelles: au Japon, les animateurs de ces cercles sont normalement nommés par la direction, mais en Allemagne, ils sont souvent élus. A l’heure actuelle, les programmes de QVT s’emploient surtout à améliorer la productivité et la compétitivité (Ozaki, 1996).
Dans certains pays où ils ont été expérimentés à grande échelle dans les années quatre-vingt, notamment en France et au Royaume-Uni, les cercles de qualité n’ont pas donné les résultats escomptés et se sont révélés relativement inefficaces, d’où une certaine désaffection à leur égard. De nombreux cercles ont disparu quelques années à peine après leur création; bien d’autres existent encore sur le papier, mais sont en fait moribonds. Cet échec tient à plusieurs facteurs: les cercles tendaient à court-circuiter les voies hiérarchiques normales; la direction n’exerçait aucun contrôle sur les membres; les cercles fixaient leurs propres objectifs sans tenir compte des priorités de la direction; le manque d’enthousiasme, voire l’hostilité, des cadres intermédiaires; l’absence d’engagement durable de la part de la haute direction; le champ d’action des cercles était restreint à des questions professionnelles d’ordre mineur.
La constatation de ces défauts a débouché sur l’élaboration de la théorie du «management total de la qualité» (TQM). Certains principes du TQM ont une incidence sur la participation des travailleurs: tous sont tenus de participer au processus d’amélioration des activités de l’entreprise, et la responsabilité de la qualité incombe aux personnes qui, de fait, contrôlent la qualité de ce qu’ils font. Le TQM favorise donc l’élargissement du champ de compétence professionnelle et l’enrichissement des tâches qui conduisent aux groupes de travail semi-autonomes. Elle facilite aussi la coordination horizontale dans l’entreprise, entre autres, par des équipes de projet spéciales, multifonctionnelles ou interdépartementales.
La constitution de groupes de projet paritaires pour étudier les meilleures façons d’introduire des changements technologiques et organisationnels en misant sur les efforts communs des cadres et des travailleurs est une caractéristique constante des relations professionnelles dans certains pays, comme la Suède. Un groupe de projet paritaire est normalement composé de membres de la direction, de délégués d’atelier et de travailleurs de base, qui sont aidés par des experts de l’extérieur. La direction et le syndicat intéressés constituent souvent des groupes de projet paritaires distincts chargés de quatre sujets: nouvelle technologie, organisation du travail, formation et milieu de travail. Le modèle suédois est un exemple remarquable de la participation directe des travailleurs dans l’atelier, qui s’insère dans un système de relations professionnelles solidement établi. On retrouve également ce système dans d’autres pays, notamment en Allemagne et au Japon.
Le travail de groupe en semi-autonomie et le travail en équipe sont deux formes de participation directe des travailleurs d’un atelier aux décisions concernant le travail, et ce, à l’intérieur de la sphère de production, contrairement au groupe de projet paritaire qui est une forme de participation hors de la sphère de production. La principale différence réside dans le degré d’autonomie dont jouissent les membres de l’équipe ou du groupe pour organiser leur travail. Le travail de groupe en semi-autonomie est un modèle très répandu en Scandinavie, quoique ces derniers temps, on revienne à une approche plus traditionnelle; il est également expérimenté ailleurs en Europe.
Les expériences de travail de groupe en semi-autonomie sont généralement sur le déclin, mais le travail en équipe se répand rapidement dans tous les pays occidentaux. Le degré d’autonomie accordé à l’équipe et sa structure varient considérablement d’une entreprise à une autre. Dans de nombreux pays, le chef d’équipe est habituellement nommé par la direction, mais dans quelques-uns (Allemagne), il est souvent élu par ses collègues. Bien souvent, la création des équipes modifie substantiellement le rôle des cadres qui voient leurs responsabilités grandir. Ils conseillent les membres de l’équipe et facilitent la communication verticale et horizontale, mais ils perdent leur fonction de surveillance proprement dite. Les employeurs manifestent un intérêt grandissant pour le travail en équipe, parce qu’il stimule généralement l’amélioration des compétences des travailleurs et élargit l’éventail des tâches que ces derniers sont capables d’accomplir, permettant ainsi une plus grande souplesse dans les processus de production. Toutefois, cette formule est parfois critiquée par les travailleurs qui y voient un moyen de les amener à travailler plus «de leur propre chef», en substituant la pression de leurs collègues à celle exercée naguère par la direction.
Certains commentateurs considèrent les formes d’actionnariat ouvrier et de représentation des salariés au conseil d’administration de l’entreprise comme des manifestations de la participation des travailleurs. En Allemagne et dans les pays nordiques, entre autres, les travailleurs participent indirectement, c’est-à-dire par leurs représentants, aux conseils de surveillance des sociétés. Les représentants des travailleurs sont intégrés dans la structure traditionnelle du conseil d’administration de la société, dans lequel ils sont en minorité (malgré leur nombre parfois élevé, comme c’est le cas en Allemagne). Cette formule ne comporte pas nécessairement une participation à la direction active de l’entreprise, mais les représentants des travailleurs ont le même statut que les autres membres du conseil. Autrement dit, ils doivent d’abord et avant tout se soucier des intérêts de l’entreprise et respecter le secret des délibérations comme les autres membres du conseil d’administration. Néanmoins, le fait de siéger au conseil peut donner accès à une meilleure information et plusieurs syndicats veulent obtenir le droit d’être représentés dans les conseils d’administration des entreprises. C’est un phénomène que l’on constate aujourd’hui en Europe orientale et occidentale ainsi qu’en Amérique du Nord, mais qui demeure plutôt rare ailleurs.
Détenir des actions d’une société à responsabilité limitée représente un autre mode de participation des travailleurs: ils parviennent parfois à réunir suffisamment de capital pour acheter une entreprise qui, autrement, serait contrainte de fermer ses portes. Cette situation s’explique ainsi: un travailleur qui s’associe financièrement à une société se donnera beaucoup de mal pour qu’elle réussisse. Ce type de participation comporte d’importantes variantes: la forme (droit au rendement des capitaux investis ou droits de contrôle); le degré (montant des dividendes et date de paiement); les raisons qui motivent cette participation financière. De toute manière, cette pratique a surtout cours en Europe et en Amérique du Nord. Cependant, si on tient les coopératives pour une variante de ce type de participation, la notion de travailleurs actionnaires est alors beaucoup plus répandue dans le monde. Il serait intéressant d’étudier si, et dans quelle mesure, l’actionnariat ouvrier a une incidence sur la sécurité et la santé au travail.
L’instauration de comités d’hygiène et de sécurité et la nomination de délégués constituent une forme particulière de participation des travailleurs (pour le modèle danois, voir encadré) prescrite par la législation de plusieurs pays (par exemple, en Belgique et dans plusieurs provinces canadiennes, au Danemark, en France, aux Pays-Bas et en Suède). Les petites entreprises — dont la définition varie selon le pays — en sont habituellement exemptes, mais à l’instar des grandes entreprises et de leur propre chef, elles mettent souvent sur pied des comités d’hygiène et de sécurité. De plus, dans nombre de cas, les conventions collectives prévoient la création et la désignation de délégués (Canada, Etats-Unis).
|
Le Danemark est un bon exemple de pays où de nombreuses institutions jouent un rôle en matière de sécurité et de santé au travail. Voici les principales caractéristiques des relations professionnelles dans ce pays. LA NÉGOCIATION COLLECTIVE: négociation de conventions par lesquelles les syndicats et les employeurs fixent les salaires, les conditions de travail, etc. Il convient de signaler les points suivants: les délégués d’atelier sont élus par les travailleurs aux termes des conventions collectives; ils jouissent d’une protection légale contre le licenciement et assurent la liaison entre les travailleurs et la direction pour ce qui touche aux conditions de travail; la convention collective sur la coopération et les comités de coopération dispose que les travailleurs à titre individuel et les groupes de travailleurs reçoivent des informations en temps utile pour pouvoir faire connaître leur avis avant qu’une décision soit prise; elle prévoit l’établissement de comités de coopération; un comité de coopération doit être mis sur pied dans toutes les entreprises employant plus de 35 travailleurs (25 dans la fonction publique). Il s’agit de comités paritaires chargés de promouvoir la coopération dans les opérations quotidiennes. Ils doivent être consultés sur l’introduction de nouvelles technologies et sur l’organisation de la production; ils jouissent de certains droits de cogestion en ce qui concerne les conditions de travail, la formation et les données personnelles; la convention collective nationale sur les conflits du travail (de 1910) confère aux travailleurs le droit (rarement exercé) de cesser le travail pour des motifs d’absolue nécessité («vie, bien-être ou honneur»). D’autres conventions collectives contiennent des dispositions sur la formation et les syndicats se chargent aussi de la dispenser. LA LOI-CADRE: la loi sur le milieu de travail est l’instrument qui permet aux entreprises de résoudre elles-mêmes les questions relatives à la sécurité et à la santé, sous l’égide des organisations patronales et syndicales, avec les conseils et sous le contrôle de l’inspection du travail (art. 1 b)). La législation établit un système complet, qui part de l’établissement et remonte au niveau national, pour favoriser la participation des travailleurs: les délégués à la sécurité sont obligatoirement élus dans les entreprises qui emploient au moins 10 travailleurs; ils jouissent de la même protection contre le licenciement et les représailles que les délégués d’atelier et ils ont droit au remboursement des dépenses encourues dans l’exercice de leurs fonctions officielles; le groupe de sécurité est formé du délégué à la sécurité et de l’agent responsable du service. Ses attributions sont les suivantes:
Les membres du groupe de sécurité ont droit à la formation et à l’information nécessaires. Un comité de sécurité doit être constitué dans toute entreprise qui emploie au moins 20 travailleurs. Dans les entreprises comptant plus de deux groupes de sécurité, ce comité est formé de travailleurs élus parmi les délégués à la sécurité, de deux agents responsables de services et d’un représentant de l’employeur. En voici les fonctions:
LE CONSEIL DU MILIEU DE TRAVAIL (ARBEJDSMILJØRÅDET): les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à la définition et à l’application des politiques de prévention au niveau national. Composition du Conseil: 11 représentants des organisations représentant les travailleurs manuels et non manuels, un représentant du personnel de maîtrise, 10 représentants des organisations d’employeurs, plus un médecin du travail, un technicien et des représentants gouvernementaux sans droit de vote. Voici ses fonctions:
LE FONDS POUR LE MILIEU DE TRAVAIL (ARBEJDSMILJØFONDET): est géré par un conseil tripartite. Sa mission première est l’information et la formation, mais il s’occupe aussi du financement des programmes de recherche. LES CONSEILS DE SÉCURITÉ DES PROFESSIONS (BRANCHESIKKERHEDSRÅDENE): 12 conseils examinent les problèmes propres à leur profession ou à leur branche et conseillent les entreprises sur les mesures à prendre. Ils sont également consultés sur les projets de loi. Ils comptent un nombre égal de représentants des organisations d’employeurs et des responsables de services d’une part, et des organisations de travailleurs, d’autre part. LES AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES: en outre, le ministère du Travail, l’inspection du travail, et l’Institut danois du milieu de travail qui en dépend, offrent divers services et conseils dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Les conflits collectifs du travail sont entendus par les tribunaux du travail. par la rédactrice de ce chapitre (texte tiré de Vogel, 1994) |
Souvent, les conventions collectives viennent renforcer les pouvoirs que la loi garantit et confère aux délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. Les relations entre, d’une part, ces comités et ces délégués et, d’autre part, les syndicats et les comités d’entreprise, leur élection ou leur nomination, leurs tâches, leurs fonctions et leur influence varient selon les pays. En tant que forme de participation des travailleurs dans le domaine spécialisé de la sécurité et de la santé, les comités et les délégués peuvent contribuer à l’amélioration des conditions de travail et des relations professionnelles. Les critères les plus propices à leur succès sont les suivants: faire partie intégrante du programme de sécurité et de santé mis en place par la direction; obtenir des informations suffisantes; faire participer le personnel subalterne à leurs activités pour assurer la continuité; s’appuyer sur un programme gouvernemental efficace en matière d’inspection du travail. Quand les employeurs offrent des services de santé au travail ou disposent de spécialistes de la sécurité, une relation fructueuse avec ces intervenants peut aussi favoriser le succès des comités d’hygiène et de sécurité. Une enquête menée dans des entreprises au Royaume-Uni a révélé que «les comités consultatifs paritaires, dont tous les représentants des salariés sont nommés par les syndicats, ont permis de réduire considérablement le nombre des accidents du travail, en comparaison avec celui des accidents du travail survenus dans des établissements où la direction décide seule des dispositions relatives à la sécurité et à la santé» (Reilly, Paci et Holl, 1995). Selon ces auteurs, les comités consultatifs paritaires jouent un rôle important même lorsque les représentants des salariés sont nommés d’une autre façon. Toutefois, selon d’autres études, les comités d’hygiène et de sécurité ne comblent pas vraiment les attentes qu’ils suscitent, et ce, pour de multiples raisons: manque de soutien de la part de la direction; participants mal informés ou insuffisamment formés; faible représentation des travailleurs, etc.
Les représentants des travailleurs peuvent être nommés par la direction (c’est le cas dans de nombreuses entreprises non syndiquées), désignés par le syndicat (Royaume-Uni) ou élus directement par les travailleurs au niveau de l’entreprise ou à un niveau supérieur (Danemark). Un système parallèle sera utilisé pour les représentants des travailleurs dans un comité mixte de sécurité et de santé qui, tout en étant bipartite, ne sera pas toujours paritaire. Les institutions générales de représentation des travailleurs sont souvent complétées par des structures spéciales de représentation en matière de sécurité et de santé (Espagne). Le mécanisme choisi correspond souvent aux autres institutions de relations professionnelles en place dans un pays: en France, par exemple, les salariés membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel; en Allemagne, les membres désignés par le conseil d’entreprise sont choisis parmi ceux qui siègent aux comités d’hygiène et de sécurité. Les comités d’entreprise aux Pays-Bas peuvent déléguer leurs pouvoirs à un comité chargé de la sécurité, de la santé et du bien-être. Un lien solide, sinon une identification, entre les représentants syndicaux et les délégués à la sécurité et à la santé est habituellement jugé souhaitable (Irlande, Norvège, Québec (Canada), Suède), mais lorsque la syndicalisation est faible, on court le risque de priver de très nombreux travailleurs du droit de faire entendre leur voix sur ces questions. La théorie selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité ont un effet d’entraînement et peuvent stimuler une participation accrue des travailleurs dans d’autres domaines reste donc encore à prouver.
Normalement, les délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé bénéficient des droits suivants: droit d’accès à l’information sur la santé, la sécurité et l’introduction des nouvelles technologies; droit d’être consultés sur ces questions; droit de participer à la surveillance des conditions de travail; droit d’accompagner les inspecteurs (parfois appelé «droit de circulation»); droit de participer aux enquêtes après accident; droit de présenter des recommandations à la direction en vue d’améliorer les conditions de travail. Dans certains pays, leurs pouvoirs sont plus étendus et comprennent le droit de codécision, celui de demander des inspections et des enquêtes sur les accidents, et celui d’étudier les rapports présentés au gouvernement par la direction. Et surtout, certains délégués des travailleurs ont le pouvoir d’ordonner l’arrêt d’une opération présentant un risque imminent (intervention également appelée «red-tagging» ou «alerte rouge» en raison du panneau indicateur installé sur place), comme au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède. Dans certains cas, notamment en France et dans certaines provinces du Canada, ils participent directement à l’application des règlements d’hygiène et de sécurité. La consultation préalable du comité paritaire est parfois obligatoire avant qu’un employeur puisse apporter des modifications importantes aux conditions d’hygiène, de sécurité ou de travail (en France et aux Pays-Bas). En Belgique, les services de santé interentreprises relèvent d’un comité paritaire. En Italie, le rôle du comité englobe la promotion de la prévention; en Grèce, les comités peuvent, avec l’accord de l’employeur, demander l’opinion de spécialistes sur des questions d’hygiène et de sécurité.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé sont nécessairement protégés contre la discrimination ou les représailles. Ils ont au minimum droit à un peu de temps libre, sans perte de salaire, et aux moyens nécessaires (dont la définition est souvent controversée) pour exercer leurs fonctions. De plus, pendant qu’ils sont en fonction, certains sont en particulier protégés contre toute mise à pied pour raisons économiques (compressions de personnel), ou bénéficient d’une protection supplémentaire contre le licenciement (Belgique). Bien souvent, ils ont droit à une formation spécialisée (Danemark).
L’influence que peuvent avoir les délégués des travailleurs et les comités paritaires d’hygiène et de sécurité dépend évidemment non seulement des droits et des devoirs prescrits par la loi ou la convention collective, mais encore de la façon dont ils sont mis en pratique. D’autres facteurs interviennent, qui influent sur la participation des travailleurs en général. Les délégués et les comités paritaires ne remplacent ni une application effective des normes de sécurité et de santé par le gouvernement, ni ce que l’on peut accomplir par la négociation collective. Toutefois, «la plupart des observateurs estiment qu’en la matière les comités [paritaires d’hygiène et de sécurité dûment autorisés] offrent un cadre réglementaire plus efficace que l’inspection du travail ou les programmes fondés sur la responsabilité civile» (Kaufman et Kleiner, 1993). Quoi qu’il en soit, la tendance va nettement dans le sens d’une participation accrue des travailleurs aux questions de sécurité et de santé, du moins dans la législation et les conventions collectives des grandes entreprises. Lorsqu’ils fonctionnent bien, les comités paritaires d’hygiène et de sécurité peuvent constituer un excellent outil d’identification des problèmes et de sensibilisation aux risques et sont donc dotés du potentiel voulu pour réduire la fréquence des accidents du travail, des maladies professionnelles et des décès attribuables au milieu de travail. Leur efficacité dépend toutefois d’un grand nombre de facteurs inhérents aux différents systèmes des relations professionnelles et de l’approche stratégique adoptée dans le milieu de travail à l’égard de la sécurité et de la santé.
Schregle (1994) fait observer ce qui suit:
En pratique, aucune de ces formes de participation des travailleurs n’a donné les résultats escomptés, et ce, pour de multiples raisons. En particulier, les syndicats et les employeurs n’ont généralement pas la même idée de la participation. Alors que les travailleurs désirent exercer une influence tangible et concrète sur les décisions de l’employeur, au sens d’un partage du pouvoir, les employeurs se réclament catégoriquement des droits ou des prérogatives de la direction, qui dérivent du principe de la propriété privée, à savoir le droit de diriger l’entreprise selon leurs propres critères et l’exclusivité du pouvoir de décision; tout au plus reconnaissent-ils aux travailleurs le droit d’exprimer leurs opinions sans lier la direction. Tout cela a pour effet de semer la confusion autour des notions de consultation, de participation des travailleurs, de participation des travailleurs à la gestion, de codécision, de cogestion, etc.
Il n’en reste pas moins que sur la plupart des lieux de travail du monde, il y a très peu de véritable participation des travailleurs dans l’entreprise. Le premier niveau de participation et, certes, le préalable à toute participation, est l’accès à l’information, suivi de la consultation. En Europe, des recherches ont révélé des écarts considérables dans le degré d’application de la directive du 12 juin 1989 sur la sécurité et la santé pour ce qui est de la participation des travailleurs; peut-être la participation connaîtra-t-elle un regain de vie sous l’impulsion de la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 sur les comités d’entreprise européens. D’autres régions sont caractérisées par une forte non-participation, mais on nourrit toujours de grands espoirs dans le renforcement des mécanismes de participation des travailleurs dans l’entreprise.
La manière traditionnelle d’envisager la participation des travailleurs en tant que moteur d’une plus grande coopération entre travailleurs et direction est loin d’être satisfaisante sur le plan de la sécurité et de la santé. Que les relations professionnelles soient conflictuelles ou marquées par une volonté de coopération ne fait pas vraiment avancer le débat. Comme le signale Vogel (1994):
[...] de toute évidence, le problème de la participation des travailleurs ne se limite pas aux formes institutionnalisées de participation à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise. Le fondement de la participation réside dans la reconnaissance des intérêts distincts en jeu, ce qui donne lieu à des interprétations spécifiques [...] La légitimité essentielle de la participation doit être trouvée en dehors de l’entreprise, dans l’exigence démocratique qui refuse d’admettre que l’autodétermination des individus doive se limiter aux règles de la représentation politique, et dans l’idée que la santé est un processus social réfléchi par lequel les individus et les collectivités développent leurs propres stratégies d’épanouissement et de défense.
En définitive, les divers modèles de participation des travailleurs ont des fonctions différentes qui rendent difficile une analyse comparative de leurs retombées respectives. Toutefois, la portée de la négociation collective s’amenuisant, il faut s’attendre à un recours accru à des dispositions prises sur l’initiative de la direction en faveur de la participation des travailleurs.
La participation des travailleurs à l’organisation de la sécurité dans les établissements industriels peut être planifiée de bien des manières, suivant la législation et la pratique nationale. Cet article ne traite que des dispositions prises en vue de la consultation et de l’information et non des formes connexes de participation des travailleurs. Les autres aspects particuliers ayant un lien avec la consultation et l’information (par exemple, la participation aux inspections ou aux activités de formation, la demande d’inspection) sont abordés dans d’autres articles du présent chapitre.
L’idée que les employeurs et les travailleurs doivent travailler ensemble pour améliorer la sécurité et la santé au travail se fonde sur plusieurs principes:
Ces principes ont été énoncés dans la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de l’OIT. L’article 20 de cette convention prévoit que «la coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise devra être un élément essentiel des dispositions prises en matière d’organisation et dans d’autres domaines [...]» liés à la sécurité et à la santé au travail. En outre, le paragraphe 2, 1) de la recommandation de l’OIT (no 129) sur les communications dans l’entreprise, 1967, précise que:
[...] les employeurs et leurs organisations, de même que les travailleurs et leurs organisations devraient, dans leur intérêt commun, reconnaître l’importance, dans les entreprises, d’un climat de compréhension et de confiance réciproques, favorable à la fois à l’efficacité de l’entreprise et aux aspirations des travailleurs.
Ces textes partent de l’idée que les employeurs et les travailleurs ont un intérêt commun à établir un système d’autoréglementation dans la prévention des accidents du travail; de fait, ils s’intéressent davantage à la sécurité qu’à la santé au travail, parce qu’il est plus simple de prouver que le travail est à l’origine des accidents et donc plus facile d’obtenir réparation. C’est également pour cette raison que, dans de nombreux pays, les délégués à la sécurité ont été les premiers représentants des travailleurs sur les lieux de travail à voir leurs droits et leurs devoirs définis par la loi ou des conventions collectives. Aujourd’hui, il n’existe probablement aucun autre sujet des relations professionnelles et de la gestion des ressources humaines à propos duquel les partenaires sociaux soient aussi désireux de collaborer. Cependant, dans certains pays, les syndicats n’ont pas investi suffisamment de ressources dans leurs initiatives sur la sécurité et la santé pour faire de cette question un enjeu important des négociations ou de la surveillance au jour le jour de l’application des conventions.
L’obligation générale de l’employeur d’informer les travailleurs et/ou leurs représentants sur les questions de sécurité et de santé et de solliciter leur avis au moyen de consultations est énoncée à l’article 20 de la convention (no 174) de l’OIT sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993. Cet article dispose que:
Dans une installation à risques d’accident majeur, les travailleurs et leurs représentants doivent être consultés selon des procédures appropriées de coopération, afin d’établir un système de travail sûr.
Plus précisément, les travailleurs et leurs représentants doivent:
a) être informés de manière suffisante et appropriée des dangers liés à cette installation et de leurs conséquences possibles; b) être informés de toutes exigences, instructions ou recommandations émanant de l’autorité compétente; c) être consultés lors de l’élaboration des documents suivants et y avoir accès: i) rapport de sécurité; ii) plans et procédures d’urgence; iii) rapports sur les accidents.
Ces droits de consultation et d’information permettent donc aux travailleurs de «discuter avec l’employeur de tout danger potentiel qu’ils considèrent susceptible de causer un accident majeur» (art. 20 f)).
De façon plus générale, la convention no 155 de l’OIT fixe des règles qui concernent la sécurité et la santé des travailleurs et le milieu de travail, et contient des dispositions efficaces au niveau de l’entreprise (qu’elles soient régies par la loi ou par la négociation collective, voire par des pratiques locales ou internes), comme l’article 19 c): «les représentants des travailleurs […] recevront une information suffisante concernant les mesures prises par l’employeur pour garantir la sécurité et la santé; ils pourront consulter leurs organisations représentatives à propos de cette information, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux». Il est également précisé, à l’alinéa e) du même article, que «les travailleurs ou leurs représentants [...] seront habilités [...] à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l’employeur; à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise».
La recommandation 164 complète la convention no 155 et précise, au paragraphe 12, que des droits de consultation et d’information en matière de sécurité et de santé devraient être accordés à divers organismes participants: délégués des travailleurs à la sécurité; comités ouvriers ou conjoints de sécurité et d’hygiène; autres représentants des travailleurs. Ce texte énonce également des principes importants influant sur la nature et le contenu de l’information ou de la consultation. Ces pratiques devraient avant tout permettre à ces groupes spécialisés de représentation des travailleurs de «contribuer au processus de prise de décisions au niveau de l’entreprise en ce qui concerne les questions de sécurité et de santé» (paragr. 12, 2) e)).
Il ne suffit pas de reconnaître ces droits et d’en parler de manière abstraite; les travailleurs et leurs représentants devraient, aux termes du paragraphe 12, 2):
«a) recevoir une information suffisante sur les questions de sécurité et d’hygiène, avoir la possibilité d’examiner les facteurs qui affectent la sécurité et la santé des travailleurs et être encouragés à proposer des mesures dans ce domaine;
b) être consultés lorsque de nouvelles mesures importantes de sécurité et d’hygiène sont envisagées et avant qu’elles ne soient exécutées, et s’efforcer d’obtenir l’adhésion des travailleurs aux mesures en question;
c) être consultés sur tous changements envisagés quant aux procédés de travail, au contenu du travail ou à l’organisation du travail pouvant avoir des répercussions sur la sécurité ou la santé des travailleurs.»
Le principe selon lequel «les représentants des travailleurs […] devraient être informés et consultés préalablement par l’employeur sur les projets, mesures et décisions susceptibles d’avoir des conséquences nocives sur la santé des travailleurs [...]» (recommandation (no 156) de l’OIT sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, paragr, 21, 2)), traduit l’idée d’une «politique efficace de communication» énoncée en termes généraux au paragraphe 3 de la recommandation no 129, qui prescrit que «des informations soient diffusées et que des consultations aient lieu entre les parties intéressées avant que des décisions sur des questions d’intérêt majeur soient prises par la direction». Pour rendre ces méthodes efficaces, il faut donc «prendre des mesures nécessaires pour former les personnes qui utiliseront ces méthodes de communication» (paragr. 6).
En relations professionnelles, la méthode participative dans le domaine de la sécurité et de la santé est corroborée par d’autres textes de droit international. A cet égard, la directive 89/391/CEE offre un bon exemple de l’introduction de mesures visant à encourager l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs des Etats membres de l’Union européenne. L’article 10 dispose que l’employeur a l’obligation de prendre les mesures appropriées: 1) pour que les travailleurs et/ou leurs représentants reçoivent, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales, toutes les informations nécessaires concernant les risques pour la sécurité et la santé, les mesures de protection et de prévention (premiers secours, lutte contre l’incendie, évacuation des travailleurs, risque de danger grave et immédiat); 2) pour que les employeurs des travailleurs des entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent des informations adéquates concernant les points susmentionnés. De plus, «les travailleurs ou les représentants des travailleurs ayant une fonction spécifique de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs» doivent avoir accès à l’évaluation des risques et aux mesures de protection, aux rapports sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ont été victimes des travailleurs, et à l’information provenant tant des activités de protection et de prévention que des services d’inspection et organismes compétents pour la sécurité et la santé.
L’article 11 de cette directive établit un lien entre consultation et participation. En réalité, les employeurs ont l’obligation de consulter «les travailleurs et/ou leurs représentants et [de permettre] leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail. Cela implique la consultation des travailleurs, le droit des travailleurs et/ou de leurs représentants de faire des propositions, la participation équilibrée, conformément aux législations et/ou pratiques nationales». L’article poursuit ainsi:
Les travailleurs ou les représentants des travailleurs ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs participent de façon équilibrée, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, ou sont consultés au préalable et en temps utile par l’employeur [...]
Ces droits ont pour objectif de couvrir tout le champ des mesures susceptibles d’influer fortement sur la sécurité et la santé, comme la désignation des salariés chargés de pratiquer certaines interventions (premiers secours, lutte contre l’incendie et évacuation des travailleurs), ainsi que la planification et l’organisation d’une formation adéquate en matière de santé et de sécurité pendant toute la durée de la relation d’emploi (dès l’embauche et y compris toute mutation, sans oublier l’introduction de nouvelles technologies et la mise en service de matériel nouveau).
Le choix est clair: non au conflit, oui à la participation aux relations professionnelles dans le domaine de la sécurité et de la santé. Tel est le sens de la directive 89/391/CEE, qui va au-delà de la simple logique du droit à l’information. Le système repose sur une véritable forme de consultation, puisque l’action d’informer doit avoir lieu «au préalable et en temps utile» — autrement dit, non seulement avant que les décisions soient prises par l’employeur, mais assez tôt pour permettre aux travailleurs et à leurs représentants de les commenter et de présenter des propositions.
La directive emploie également l’expression ambiguë «participation équilibrée», qui ouvre la porte à diverses interprétations. C’est une notion plus large (ou du moins différente) que celle de la consultation, mais pas au point de constituer une forme de partage du pouvoir de décision qui empêcherait les employeurs de prendre des mesures qui n’auraient pas été approuvées au préalable par les travailleurs ou leurs représentants. De toute évidence, il s’agit d’une forme de participation qui dépasse la simple consultation (autrement, le titre de l’article 11 «consultation et participation» n’aurait aucun sens) sans aller nécessairement jusqu’à la prise de décisions conjointe. La notion reste dans le vague; elle englobe de multiples formes de participation des travailleurs, qui varient considérablement d’un Etat membre à un autre dans l’Union européenne. Quoi qu’il en soit, la directive n’impose nullement l’obligation d’instaurer une forme particulière de participation équilibrée.
Dans les textes de l’OIT et des CE, l’information semble être un concept selon lequel la direction informe de sa décision l’organisation représentant les travailleurs, par écrit ou dans le cadre d’une réunion, tandis que la consultation appelle la création de comités paritaires dans lesquels les représentants des travailleurs sont non seulement informés par la direction, mais peuvent également exprimer leur avis et attendre une justification de la décision en cas de divergence d’opinions. Ces notions diffèrent assurément de la négociation (lorsqu’un accord à caractère obligatoire, au niveau de l’entreprise ou interentreprises, est conclu à l’issue de discussions dans un comité de négociation) et de la cogestion (lorsque les travailleurs ont un droit de veto et que les décisions exigent l’accord des deux parties).
Dans le cas d’entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire, la directive 94/45/CE du Conseil de l’Union européenne du 22 septembre 1994 prévoit la création d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure en matière d’information et de consultation. Les informations «portent notamment sur des questions transnationales qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs» (art. 6, 3)). L’avenir nous dira si cette disposition sera appliquée aux fins de la sécurité et de la santé.
La nature dynamique de la consultation est également soulignée dans l’article 11, 3) de la directive 89/391/CEE, selon laquelle les représentants de travailleurs exerçant une fonction spécifique dans ce domaine «ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les travailleurs et/ou à éliminer les sources de danger».
Dans ses dispositions relatives à la gestion du risque, la directive attribue indiscutablement des responsabilités précises aux employeurs, mais encourage aussi une plus grande participation des travailleurs et de leurs représentants aux consultations concernant les stratégies de la direction en matière de sécurité et de santé. Les employeurs doivent évaluer les risques et présenter leurs systèmes de prévention sous forme de plan ou de déclaration. Dans tous les cas, ils sont tenus de consulter les travailleurs et/ou leurs représentants ou de les faire participer à la conception, à la mise en œuvre et à la surveillance de ces systèmes. Il est néanmoins indéniable qu’en conférant des droits de participation pertinents aux travailleurs cette directive adopte par la même occasion une approche «d’auto-évaluation». D’autres directives des CE exigent, entre autres, la consignation des résultats des mesures et des examens, et affirment le droit d’accès des travailleurs à ces dossiers.
La recommandation de l’OIT no 164 prévoit, au paragraphe 15, 2):
Les employeurs devraient être tenus d’enregistrer les données relatives à la sécurité, à la santé des travailleurs et au milieu de travail jugées indispensables par l’autorité ou les autorités compétentes et qui pourraient inclure les données concernant tous les accidents du travail et tous les cas d’atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci et donnant lieu à déclaration; les autorisations et les dérogations se rapportant à la législation ou aux prescriptions de sécurité et d’hygiène ainsi que les conditions éventuelles mises à ces autorisations ou à ces dérogations; les certificats relatifs à la surveillance de la santé des travailleurs dans l’entreprise; les données concernant l’exposition à des substances et à des agents déterminés.
Dans le monde entier, on s’accorde à reconnaître que les employeurs doivent établir des dossiers sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, par exemple, ou encore sur l’utilisation ou l’existence d’une surveillance biologique ou environnementale.
Dans certains systèmes de relations professionnelles (Italie), la loi ne confère aux représentants des travailleurs aucun droit spécifique à l’information et à la consultation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, bien que ces droits soient souvent inscrits dans les conventions collectives. La législation italienne accorde aux travailleurs le droit de contrôler eux-mêmes l’application des normes relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que le droit d’effectuer des études et d’adopter des mesures appropriées pour garantir la sécurité et la santé au travail. Dans d’autres systèmes (Royaume-Uni), pour que l’information sur les questions de santé et de sécurité soit divulguée comme le prévoit la loi, il faut d’abord nommer des délégués à la sécurité. Pour cela, il faut qu’il existe une organisation syndicale reconnue dans l’entreprise. Si l’employeur refuse le statut requis à une organisation syndicale reconnue ou lui retire sa reconnaissance, les droits de consultation et d’information ne peuvent être exercés.
Ces cas nationaux posent la question de savoir dans quelle mesure la participation réelle des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé dépend de l’adoption de dispositions légales. Un certain encadrement juridique paraît certes utile et semble donner les meilleurs résultats quand la législation prévoit l’élection de représentants des travailleurs et leur confère des droits suffisamment forts pour leur permettre d’exercer leurs fonctions indépendamment de la direction, tout en permettant une certaine diversité au niveau de l’organisation de la participation dans différents secteurs et sociétés.
En règle générale, les systèmes de relations professionnelles s’appuient sur la loi qui impose d’informer et de consulter les représentants des travailleurs sur les affaires de sécurité et de santé. Lorsque des comités paritaires composés de membres de la direction et de représentants des travailleurs sont formés, ils sont investis de pouvoirs considérables. En France, par exemple, le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut proposer des mesures préventives; un employeur qui refuse de s’y conformer doit justifier sa position. Pourtant, dans la pratique, les délégués à la sécurité semblent parfois plus efficaces que les comités paritaires parce qu’ils dépendent moins de l’existence d’une relation de coopération.
Grâce à diverses formes de participation représentative, les travailleurs bénéficient généralement des droits que leur reconnaissent les conventions et les recommandations internationales du travail susmentionnées (ainsi que les directives des CE, le cas échéant), en particulier dans les pays industrialisés régis par les principes de l’économie de marché. Les délégués à la sécurité ou les membres des comités d’entreprise ont le droit d’être informés et consultés par l’employeur au sujet de toutes les questions concernant les opérations de l’entreprise et l’amélioration des conditions de travail, y compris la sécurité et la santé. Ils ont le droit de consulter tous les documents pertinents que l’employeur est légalement tenu de conserver, ainsi que toutes les déclarations y relatives et les résultats de toutes les recherches. Au besoin, ils peuvent également en obtenir copie.
Certains aspects (comme le recours à des experts, le déclenchement d’une inspection ou la participation à une inspection, et la protection contre les représailles) ont une forte incidence sur l’efficacité des droits à l’information et à la consultation sur la sécurité et la santé, mais il existe en outre des facteurs généraux qu’il ne faut pas négliger. Premièrement, la taille de l’entreprise: les dispositifs de contrôle sont moins efficaces dans les petites unités dont les syndicats et d’autres formes de représentation des travailleurs sont pratiquement absents. De plus, ce sont les petits établissements qui sont les plus susceptibles de ne pas respecter les obligations légales.
Deuxièmement, quand les délégués à la sécurité font partie de l’organisation syndicale officielle du lieu de travail, les améliorations attendues ont plus de chances d’être mises en œuvre.
Troisièmement, les dispositions relatives à la consultation et à l’information sur la sécurité et la santé font ressortir le climat de conflit (Italie, Royaume-Uni) ou de coopération (Allemagne, Japon, pays nordiques) qui prévaut dans les relations professionnelles. Et, en général, la collaboration entre employeurs et travailleurs favorise la divulgation de l’information et la consultation.
Quatrièmement, il ne faut pas sous-estimer l’esprit d’initiative de la direction. La consultation et l’information sont plus efficaces que les droits reconnus par la loi lorsqu’elles sont imprégnées d’une culture d’entreprise qui les favorise. Selon leur attitude à l’égard de la formation, leur engagement à diffuser l’information et leur empressement à répondre aux questions, les employeurs sont à même de créer un climat d’affrontement ou de collaboration. Il est essentiel de pouvoir s’appuyer sur la loi pour garantir aux représentants des travailleurs une totale indépendance afin qu’ils aient les mains libres pour intervenir dans ce domaine, mais le succès des dispositions relatives à l’information et à la consultation repose en grande partie sur la volonté des deux parties.
Enfin, le succès de toute représentation des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail dépend essentiellement de la prise de conscience de la population en général. Cette forme particulière de participation exige que tous les travailleurs en comprennent la nécessité et y attachent l’importance voulue. Les données dont on dispose montrent que les travailleurs considèrent la sécurité et la santé comme l’une de leurs principales préoccupations professionnelles.
En règle générale, un délégué à la sécurité est réputé commettre un abus de confiance s’il divulgue une information quelconque ayant trait aux procédés de production d’un employeur ou à d’autres secrets professionnels. En outre, il est tenu à la discrétion au sujet de toute information qui lui est confiée et dont l’employeur indique le caractère confidentiel. La convention no 155 de l’OIT en tient dûment compte et dispose que les représentants des travailleurs dans l’entreprise pourront consulter leurs organisations représentatives à propos de l’information relative à la sécurité et à la santé au travail, «à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux» (art. 19 c)).
Dans certains systèmes (Grèce), les représentants des travailleurs siégeant dans des comités d’entreprise sont tenus de ne pas communiquer à des tiers les informations reçues qui revêtent une importance primordiale pour l’entreprise et nuiraient à sa capacité de concurrence si elles venaient à être divulguées. Les représentants des travailleurs et l’employeur sont censés décider ensemble de ce qui peut être divulgué. Dans d’autres systèmes (Luxembourg), lorsque les représentants des travailleurs sont en désaccord avec l’employeur quant à la classification confidentielle de l’information, ils peuvent en référer à l’inspection du travail, qui tranchera.
Dans certains pays, l’obligation de garder le secret est uniquement implicite (en Italie, par exemple). Par ailleurs, en l’absence de dispositions précises à cet égard (comme au Royaume-Uni), les représentants des travailleurs ne peuvent prétendre obtenir des renseignements relatifs à la santé d’une personne (sauf si celle-ci donne son consentement), ni d’information susceptible de nuire à la sécurité nationale ou à l’entreprise de l’employeur. Enfin, l’obligation de respecter la confidentialité (en Suède, par exemple) n’empêche pas forcément les délégués à la sécurité de transmettre l’information reçue à l’organe exécutif de leur organisation syndicale qui, lui aussi, est légalement tenu de garder le secret.
Tout programme ou toute politique d’ensemble concernant le développement des ressources humaines devrait comprendre un élément de formation, que ce soit dans l’entreprise, dans la branche d’activité ou au niveau national. La formation pourra d’autant plus facilement être mise en œuvre que l’on offrira un congé-éducation payé (voir encadré). Lorsque des dispositions à cet effet ne sont pas inscrites dans la législation nationale (comme elles le sont dans les Codes du travail de la France et de l’Espagne, par exemple), les représentants des employeurs et des travailleurs devraient négocier l’obtention d’un congé pour recevoir une formation appropriée à la sécurité et à la santé au travail.
Objectif de la normePromouvoir l’éducation et la formation pendant les heures de travail, avec versement de prestations financières. ObligationsTout Etat signataire qui ratifie la convention doit formuler et appliquer une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux, d’éducation générale, sociale ou civique et d’éducation syndicale. Cette politique doit tenir compte du stade de développement et des besoins particuliers du pays et doit être coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail. Le congé-éducation payé ne doit pas être refusé aux travailleurs en raison de leur race, de leur couleur, de leur sexe, de leur religion, de leur opinion politique, de leur ascendance nationale ou de leur origine sociale. Le financement des arrangements relatifs au congé-éducation payé devra être assuré de façon régulière et adéquate. La période de congé-éducation devra être assimilée à une période de travail effectif pour déterminer les droits à des prestations sociales et les autres droits découlant de la relation de travail. par la rédactrice de ce chapitre (texte tiré de la convention internationale du travail no 140, 1974) |
Tout accord négocié devra préciser les questions qui feront l’objet de la formation et arrêter les dispositions administratives, financières et organisationnelles. La formation à la prévention devrait englober les points suivants:
Toute formation comprend deux éléments principaux: le contenu et les méthodes. Ces éléments seront déterminés en fonction des objectifs de la formation et des aspirations des participants et des formateurs. En l’occurrence, la formation se proposera de contribuer à l’amélioration de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail; son contenu sera donc axé sur les moyens pratiques d’atteindre cet objectif. Cette approche appelle une évaluation des problèmes de prévention qui se posent aux travailleurs, à savoir:
Cette approche méthodologique permet de traiter systématiquement les questions: chaque problème est décrit et on examine comment et par qui il a été détecté, les mesures prises, le résultat obtenu.
Elle permet d’identifier les «bonnes» et les «mauvaises» pratiques de sécurité et de santé au travail, ce qui peut donner lieu, du moins en théorie, à une action commune de la part des employeurs et des travailleurs. Cette méthodologie ne porte des fruits qu’une fois satisfaite une forte demande d’information: textes de loi, règlements et normes, renseignements techniques sur la prévention, élimination des risques ou solution des problèmes, notamment les mesures prises ou les accords conclus entre d’autres syndicats et d’autres employeurs, ainsi que les solutions et les stratégies de remplacement.
Toute activité de formation réussie nécessitera l’utilisation de techniques actives d’apprentissage fondées sur l’expérience, les qualifications, les connaissances, l’attitude et les objectifs des participants. L’expérience et les connaissances sont examinées, les attitudes analysées et les qualifications étoffées et perfectionnées grâce à un travail collectif. Les participants sont incités à mettre en pratique dans leur milieu de travail les connaissances acquises au cours de leur formation. Ainsi, résultats concrets et contenu pertinent demeurent au cœur de l’activité de formation.
Le formateur et les stagiaires doivent se poser les questions suivantes quant aux méthodes d’apprentissage et au contenu de la formation: qu’avons-nous appris qui puisse s’appliquer à notre milieu de travail? La formation accroît-elle nos qualifications et nos connaissances? Nous aide-t-elle à travailler plus efficacement dans notre milieu de travail?
Le formateur devrait se poser ces questions au stade de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation de tout programme de formation; la méthodologie encourage les participants à avoir les mêmes exigences au cours de leur formation.
Cette méthode, souvent désignée par l’expression «apprentissage par l’action», fait largement appel à l’expérience, à l’attitude, aux qualifications et aux connaissances des participants. Il faut toujours ramener les objectifs d’une formation à des résultats concrets, et cette méthode devrait donc en faire partie intégrante. Ainsi, les activités énumérées au tableau 21.1 pourraient être intégrées dans des programmes de formation à la sécurité et à la santé.
|
Activité |
Compétences connexes |
|
Identifier les risques |
Analyse critique |
|
|
Echange d段nformation |
|
|
Examen de l段nformation |
|
Résoudre les problèmes |
Analyse critique |
|
|
Echange d段nformation |
|
|
Travail collectif |
|
|
Elaboration de stratégies |
|
Trouver l段nformation |
Utilisation des ressources |
|
|
Compétences en matière de recherche |
|
|
Réutilisation de l段nformation |
|
Modeler les comportements |
Analyse critique |
|
|
Réévaluation des attitudes |
|
|
Argumentation efficace et débat constructif |
La formation à la sécurité et à la santé au travail permet de sensibiliser les travailleurs et les employeurs aux enjeux dans ce domaine et peut servir de point de départ à une action commune et à un accord sur la façon de surmonter les problèmes. Concrètement parlant, de bonnes pratiques en matière de sécurité et de santé permettent non seulement d’améliorer le milieu de travail et éventuellement la productivité, mais d’encourager également les partenaires sociaux à avoir une attitude plus positive à l’égard des relations professionnelles.
Le rôle clé que joue l’inspection du travail dans l’évolution des relations professionnelles est incontestable. De fait, l’histoire du droit du travail est calquée sur celle du système d’inspection du travail. Avant la création des premiers de ces services, les lois du travail n’étaient que de simples déclarations d’intention qui n’entraînaient aucune sanction en cas d’infraction. Le droit du travail est véritablement né au moment où un organe spécifique a été chargé de faire appliquer la réglementation et, partant, de donner effet à la loi en appliquant des sanctions.
Les premières tentatives nationales visant à établir un système d’inspection du travail étaient axées sur la création d’organismes qui intervenaient, à titre gracieux et en réaction à la nature particulière du libéralisme économique, pour protéger les femmes et les enfants occupés dans l’industrie. L’expérience révéla rapidement qu’il fallait instituer un organe de coercition véritablement habilité à protéger l’ensemble de la population active. La première loi instituant un corps d’inspection officiel dans les fabriques a été adoptée au Royaume-Uni en 1878, au motif que les modalités relatives à la nomination d’agents honoraires n’avaient pas été respectées et que, par conséquent, les mesures de protection n’avaient pas été appliquées. Cette première loi conférait aux inspecteurs des fabriques les pouvoirs suivants: accès sans restriction aux fabriques, liberté d’interroger les travailleurs et les employeurs, obtention de documents sur demande et pouvoir de régler les litiges et de constater les infractions.
Au cours des années suivantes, l’évolution des diverses réglementations a eu pour effet de réaffirmer l’autorité des inspecteurs en tant qu’agents de l’administration, en distinguant et en supprimant finalement leur fonction de juges. La notion d’inspecteur, fonctionnaire rémunéré, mais aussi intervenant dans le système de relations professionnelles, a alors fait son apparition: par sa présence sur les lieux de travail, ce serviteur de l’Etat incarne directement l’action gouvernementale et lui donne un visage humain. A cette fin, l’inspection du travail a été convertie en un organe chargé de la mise au point et de l’application de la législation; en fait, elle est devenue le pilier de la réforme sociale.
Cette double fonction (stricte surveillance et observation active des faits) caractérise les origines de l’activité d’inspection au sein des institutions juridiques. D’une part, l’inspection du travail s’appuie sur des textes de loi clairs et précis qui doivent être appliqués; d’autre part, l’articulation et l’exercice correct de ses fonctions la conduisent à interpréter la lettre de la loi par l’action directe. Non seulement l’inspecteur doit connaître la lettre de la loi, mais encore il doit en maîtriser l’esprit. Il doit être sensible au monde du travail et posséder une connaissance approfondie tant des règlements que des procédés techniques et des méthodes de production. L’inspection est donc un instrument de la politique du travail, mais aussi une institution créative axée sur le progrès qui est essentiel à l’évolution même du droit du travail et des relations professionnelles.
L’évolution du monde du travail a eu pour effet d’approfondir et de renforcer le rôle de l’inspection du travail en tant qu’organe de contrôle indépendant au cœur du système des relations professionnelles. Parallèlement, les transformations du monde du travail ouvrent de nouvelles perspectives et créent de nouvelles formes de relations internes dans le microcosme complexe qu’est le lieu de travail. L’idée originelle d’une relation paternaliste entre l’inspecteur et les personnes faisant l’objet de l’inspection a vite cédé le pas à une action plus participative de la part des représentants des employeurs et des travailleurs, l’inspecteur incitant les parties intéressées à prendre part à ses activités. C’est pourquoi la législation de nombreux pays a confié à l’inspecteur du travail le rôle de conciliateur dans les conflits collectifs.
En même temps que le rôle de l’inspecteur du travail mandaté par l’Etat s’affirmait, les percées du mouvement syndical et des organisations professionnelles suscitèrent chez les travailleurs un intérêt plus vif à l’égard de l’inspection du travail et les poussèrent à y participer activement. Après diverses tentatives des travailleurs pour obtenir leur intégration dans l’inspection (par exemple, en cherchant à créer des postes de travailleur-inspecteur comme il en existait dans les pays communistes), le statut indépendant et objectif de l’inspection du travail a fini par l’emporter lorsqu’elle a été instituée en organe étatique formé de fonctionnaires. Néanmoins, les représentants des travailleurs et des employeurs n’ont pas perdu leur volonté de participation au contact de la nouvelle institution: l’inspection du travail est certes un organe indépendant, mais elle est devenue aussi un acteur qui occupe une place privilégiée dans le dialogue entre les deux parties.
Dans cette perspective, l’inspection du travail s’est développée progressivement et parallèlement à l’évolution économique et sociale. Par exemple, la tendance des Etats au protectionnisme durant le premier tiers du XXe siècle a entraîné des modifications importantes du droit du travail, un nombre considérable de diplômés ayant rejoint ceux qui avaient déjà été embauchés comme inspecteurs. Une des conséquences immédiates de ces développements a été la création d’une véritable administration du travail. De même, l’apparition de nouvelles formes d’organisation du travail et la pression des forces du marché sur la fonction publique à la fin du XXe siècle ont évidemment eu des répercussions sur l’inspection du travail dans nombre de pays.
Conçue à l’origine comme un corps de contrôleurs chargés de faire respecter la loi, l’inspection du travail a révisé ses propres activités au fil des années et s’est transformée en un mécanisme utile et bien intégré, réceptif aux besoins technologiques des nouvelles formes de travail. De même, le droit du travail s’est adapté aux nouveaux besoins de la production et des services et s’est étendu à des règlements de caractère technique. D’où l’apparition de sciences connexes comme la sociologie du travail, l’ergonomie, la sécurité et la santé au travail, l’économie du travail, etc. Ces nouvelles disciplines débordent le cadre purement juridique et l’inspecteur joue un rôle dynamique dans l’application véritable de la réglementation sur le lieu de travail, non seulement en imposant des sanctions, mais aussi en conseillant les représentants des travailleurs et des employeurs.
Les Etats ont adopté deux modes d’organisation de l’inspection du travail: l’inspection générale (qui a vu le jour en Europe continentale) et l’inspection spécialisée (née au Royaume-Uni). Sans débattre de leurs avantages respectifs, ces deux systèmes ont chacun leur propre appellation qui témoigne de deux points de vue très différents. Selon le mode généraliste (ou unitaire), l’inspection est effectuée par une seule personne, aidée de diverses institutions techniques, car ses tenants partent de l’hypothèse que l’expertise générale d’un inspecteur unique a de meilleures chances de déboucher sur une solution logique et cohérente des divers problèmes liés au travail. L’inspecteur généraliste est un arbitre (au sens de ce mot dans la Rome antique) qui, après consultation des organismes spécialisés pertinents, essaie de régler les difficultés et les problèmes que présente un lieu de travail précis. Il règle directement les conflits de travail. Pour sa part, l’inspection spécialisée agit directement par l’entremise d’un agent avant tout technicien chargé de résoudre des problèmes spécifiques dans un champ d’action plus restreint. Parallèlement, les questions relevant des relations professionnelles proprement dites sont laissées à des mécanismes bipartites ou parfois tripartites (employeurs, syndicats, autres organismes gouvernementaux), qui tentent de régler les conflits par le dialogue.
Malgré leurs divergences, les deux tendances ont ceci de commun: généraliste ou spécialiste, l’inspecteur du travail demeure l’incarnation vivante de la loi. Dans le système généraliste, la position centrale lui permet de déterminer les besoins immédiats et d’apporter des modifications en conséquence. Le cas de l’Italie illustre particulièrement bien cette situation: la loi habilite l’inspecteur du travail à prendre des mesures exécutoires pour compléter la réglementation générale ou pour lui substituer des règles plus spécifiques. Dans le cas de l’inspection spécialisée, l’inspecteur connaît à fond les problèmes et les normes techniques et peut donc évaluer les éventuels manquements aux obligations légales et à la prévention des risques, et proposer des solutions de rechange applicables sur-le-champ.
Outre ses fonctions de surveillance, l’inspecteur joue un rôle central et devient souvent le pilier des institutions sociales dans le domaine du travail. Non seulement il exerce un contrôle général des obligations légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, mais encore, dans nombre de pays, l’inspecteur du travail surveille l’exécution d’autres obligations — services sociaux, emploi de travailleurs étrangers, formation professionnelle, sécurité sociale, etc. Pour être efficace, l’inspection du travail devrait être dotée des caractéristiques énoncées dans la convention (no 81) de l’OIT sur l’inspection du travail, 1947: nombre suffisant d’inspecteurs, indépendance, formation et ressources appropriées, et pouvoirs nécessaires pour procéder aux inspections et imposer des solutions afin de remédier aux défectuosités constatées.
Dans de nombreux pays, l’inspection du travail est également chargée de régler les conflits de travail, de participer à la négociation des conventions collectives à la demande des parties, de prendre part aux activités de collecte et d’analyse des données socio-économiques, de rédiger des mémoires et, dans son domaine d’expertise technique, de conseiller les autorités du travail et de remplir d’autres fonctions d’ordre purement administratif. L’élargissement et la multiplicité de leurs tâches découlent du fait que les inspecteurs sont considérés comme des experts en relations professionnelles ayant en outre des connaissances techniques spécifiques. Cela reflète également une vision particulière du cadre de l’activité de l’entreprise, selon laquelle l’inspection du travail est tenue pour l’institution idéale aux fins de l’évaluation et de la solution des problèmes qui se posent dans le monde du travail. Toutefois, ce caractère multidisciplinaire se heurte dans certains cas à l’écueil de la dispersion. On peut se demander si les inspecteurs du travail, tenus d’assumer de multiples responsabilités, ne courent pas le risque de favoriser les activités de nature économique ou autre, au détriment de celles qui devraient constituer l’essentiel de leur mission.
La principale controverse au sujet de la délimitation des fonctions typiques et prioritaires de l’inspection du travail porte sur la fonction relative à la conciliation dans les conflits de travail. Le contrôle et la surveillance composent assurément la majeure partie de l’activité quotidienne d’un inspecteur, mais, de toute évidence, le lieu de travail n’en demeure pas moins le siège des conflits de travail, qu’ils soient individuels ou collectifs. On peut se poser la question de savoir si toutes les activités de contrôle et d’évaluation de l’inspection du travail ne constituent pas, jusqu’à un certain point, un traitement «palliatif» des conflits proprement dits. Prenons par exemple le cas de l’inspecteur qui demande l’application des dispositions légales sur le bruit. Dans bien des cas, son intervention fait suite à une plainte déposée par les représentants des travailleurs qui considèrent que le nombre élevé de décibels nuit à leur rendement. En conseillant l’employeur, l’inspecteur propose une mesure visant à résoudre un conflit individuel né des relations de travail quotidiennes. L’employeur peut adopter ou rejeter la solution proposée, sans préjudice de l’action en justice qui pourrait être intentée contre lui. De même, l’inspecteur qui se rend sur un lieu de travail pour vérifier si un acte de discrimination antisyndicale a été commis entend diagnostiquer et, si possible, éliminer les divergences internes qui opposent en l’occurrence les parties.
Dans quelle mesure la prévention des conflits diffère-t-elle de leur règlement dans les activités quotidiennes de l’inspecteur du travail? La réponse n’est pas aisée. L’imbrication de toutes les sphères qui composent le domaine des relations professionnelles fait que l’inspection du travail est non seulement l’incarnation de la loi, mais encore une institution qui occupe une place névralgique dans le système des relations professionnelles. Un service d’inspection qui examine l’ensemble du monde du travail sera en mesure de garantir de meilleures conditions de travail, un milieu de travail sûr et, par conséquent, de meilleures relations professionnelles.
Ces dernières années, la législation, les instruments internationaux et les études sur la sécurité et la santé au travail ont mis en lumière l’importance de l’information, de la consultation et de la coopération entre les travailleurs et les employeurs. Prévenir les conflits plutôt que les régler, voilà le mot d’ordre. D’aucuns prétendent que, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, les travailleurs et les employeurs partagent des intérêts communs et que les conflits peuvent donc être évités plus facilement. Et pourtant, il continue d’en surgir.
La relation d’emploi est tributaire d’intérêts et d’objectifs prioritaires divergents, ainsi que d’enjeux en évolution constante, y compris en matière de sécurité et de santé. Il ne manque donc pas d’occasions de désaccord susceptibles de dégénérer en conflits de travail. A supposer que l’importance de la sécurité et de la santé en général soit largement reconnue, la nécessité de prendre des mesures spécifiques ou leur mise en œuvre constituent des motifs potentiels de discorde, surtout lorsqu’elles exigent un surcroît de temps ou d’argent ou entraînent une baisse de la production. Lorsqu’on parle de sécurité et de santé, il y a peu d’absolus: ainsi, la notion de risque «acceptable» est relative. De nombreux enjeux appellent un débat pour trouver le juste milieu, en particulier compte tenu du fait qu’il faudra peut-être traiter des situations complexes avec une aide technique limitée et sans preuves scientifiques concluantes. De plus, les perceptions fluctuent continuellement au gré des nouvelles technologies, de la recherche médicale et scientifique, de l’évolution des comportements sociaux, etc. Ce domaine comporte donc un fort potentiel de divergences d’opinions et de conflits.
Le règlement équitable et efficace des conflits est essentiel dans tous les secteurs des relations professionnelles, mais peut-être davantage encore dans celui de la sécurité et de la santé. Les conflits peuvent être résolus à un stade précoce lorsqu’une des parties porte à la connaissance de l’autre des faits pertinents, que ce soit conformément aux procédures établies ou en dehors de celles-ci. On peut également recourir à la procédure interne de plaintes, ce qui exige d’habitude la participation de différents échelons de la hiérarchie. La conciliation ou la médiation permettent parfois de régler le différend ou encore un tribunal ordinaire ou un arbitre peuvent imposer une solution. Dans le domaine de la sécurité et de la santé, l’inspecteur du travail a également un rôle important à jouer dans le règlement des conflits. Il arrive que certains litiges mènent à un arrêt de travail qui, dans le cas de la sécurité et de la santé, peut être tenu ou non pour une grève au sens de la loi.
La sécurité et la santé peuvent donner lieu à divers types de conflits. Bien que le classement par catégorie ne soit pas toujours évident, il importe souvent de définir le conflit avec précision pour déterminer les mécanismes de règlement qui seront appliqués. Les conflits sont soit individuels, soit collectifs, selon leur origine ou selon la personne habilitée à les déclencher. En règle générale, un conflit individuel concerne un seul travailleur, alors qu’un conflit collectif touche un groupe de travailleurs, habituellement représenté par un syndicat. Une distinction supplémentaire est souvent faite entre conflit de droits et conflit d’intérêts. Un conflit de droits (également appelé conflit juridique) porte sur l’application ou l’interprétation de droits conférés par la loi ou par une disposition inscrite dans le contrat de travail ou la convention collective, tandis qu’un conflit d’intérêts porte sur la création de droits et d’obligations, ou sur la modification de ceux qui existent. Les conflits d’intérêts surviennent principalement en rapport avec la négociation collective.
Si le caractère — collectif ou individuel — du différend détermine parfois la procédure de règlement, c’est d’habitude l’interaction entre les catégories qui importe: les conflits de droits collectifs, d’intérêts collectifs et de droits individuels appellent d’ordinaire un traitement différent. Le présent article porte uniquement sur les deux premières catégories, mais il ne faut pas oublier que certaines étapes sont communes au règlement des conflits collectifs et à celui des plaintes individuelles.
Le conflit est qualifié de collectif ou d’individuel selon que la loi permet au syndicat de contester le point en litige. Dans un certain nombre de pays, le pouvoir de négocier en matière de santé et de sécurité ou autre n’est dévolu qu’à un syndicat dûment enregistré auprès des autorités publiques ou reconnu comme représentant un pourcentage donné des travailleurs intéressés. Dans plusieurs pays, ces préalables s’appliquent également au pouvoir de soulever des conflits de droits. Dans d’autres, il faut que l’employeur accepte de son plein gré de négocier avec le syndicat pour que celui-ci puisse intervenir au nom des salariés.
Un syndicat peut être en mesure d’engager la procédure de règlement de l’un des droits lorsque des obligations en matière de santé et de sécurité touchant le milieu de travail dans son ensemble sont en question, notamment si l’employeur ne se conforme pas à des dispositions conventionnelles ou légales établissant un niveau de bruit maximum, ou exigeant des précautions particulières en ce qui concerne les machines, ou la fourniture d’équipements de protection individuelle. Des conflits juridiques peuvent également survenir quand, par exemple, l’employeur s’abstient de consulter le comité de sécurité ou de santé (ou le délégué à la sécurité) ou de transmettre des informations comme la loi ou la convention collective l’y obligent. La convention étant par définition collective, tout manquement présumé est considéré dans certains pays comme un conflit collectif, en particulier quand cela concerne la mise en œuvre de dispositions d’application générale comme celles qui ont trait à la sécurité et à la santé, même si, en réalité, un seul travailleur est touché immédiatement et directement par l’infraction de l’employeur. Un conflit occasionné par une violation des dispositions légales peut être qualifié de collectif lorsque le syndicat intervient au nom de tous les travailleurs intéressés et qu’il est autorisé à le faire en raison de cette violation.
Les conflits d’intérêts collectifs en matière de sécurité et de santé peuvent revêtir bien des formes. Ce type de conflit peut découler des négociations entre le syndicat et l’employeur au sujet de la création d’un comité de sécurité et de santé ou des responsabilités de celui-ci, de l’introduction d’une nouvelle technologie, des mesures spécifiques concernant les matières dangereuses, de la protection de l’environnement, etc. Les négociations peuvent donner lieu à des déclarations de principe générales relatives à la sécurité et à la santé, à des améliorations spécifiques ou à des limites précises d’exposition. Lorsque les parties se retrouvent dans une impasse en cours de négociation, le traitement des points de désaccord est considéré comme une extension de la liberté de négocier collectivement. La convention (no 154) de l’OIT sur la négociation collective, 1981, a souligné l’importance de concevoir des organes et des procédures de règlement des conflits de travail de telle manière qu’ils contribuent à promouvoir la négociation collective (art. 5, 2) e)).
L’expression procédure de règlement des réclamations désigne généralement une procédure interne prévue par la convention collective pour aplanir les différends concernant l’application ou l’interprétation de la convention collective (conflits de droits). Cependant, des procédures semblables sont souvent établies même en l’absence d’un syndicat ou d’une convention collective, afin de régler les problèmes et les plaintes des travailleurs, car elles sont perçues comme un moyen plus équitable et moins coûteux de mettre fin aux conflits que le recours à la justice (McCabe, 1994). Normalement, la convention collective prévoit que la plainte sera examinée selon une procédure à plusieurs étapes en remontant la voie hiérarchique de l’organisation. Par exemple, un conflit sur la sécurité et la santé peut d’abord être soumis au chef immédiat. S’il n’est pas réglé à ce stade, le chef et le délégué à la sécurité et à la santé ont alors la possibilité d’entreprendre une enquête, dont les conclusions sont remises à un cadre ou, peut-être, au comité de sécurité et de santé. Si aucune solution n’est trouvée, un cadre supérieur peut alors intervenir. Il est possible qu’il faille épuiser plusieurs recours internes avant de faire appel à la procédure externe. La convention peut ensuite prévoir l’intervention d’une tierce partie, sous forme d’inspection, de conciliation et d’arbitrage, sujets qui seront abordés plus en détail ci-après.
Adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1967, la recommandation (no 130) sur l’examen des réclamations souligne l’importance d’une procédure de règlement dans le cas des conflits de droits, qu’ils soient individuels ou collectifs. Il y est précisé que les organisations de travailleurs ou les représentants des travailleurs dans l’entreprise devraient être associés aux employeurs pour établir et mettre en œuvre des procédures d’examen des réclamations dans l’entreprise. Ces procédures devraient être rapides, simples et ne comporter qu’un minimum de formalisme. Lorsque les procédures internes sont épuisées et qu’aucune solution acceptable pour les deux parties n’a été trouvée, la recommandation prévoit d’autres mesures pour parvenir à un règlement final, dont l’examen conjoint du cas par les organisations de travailleurs et d’employeurs, la conciliation ou l’arbitrage, et le recours à un tribunal du travail ou à une autre autorité judiciaire.
La convention collective ou la loi peuvent exiger que les conflits collectifs soient soumis à la conciliation ou à la médiation avant de recourir à d’autres procédures de règlement. Même sans être forcées de recourir à la conciliation, les parties peuvent volontairement demander à un conciliateur, un médiateur ou à une autre tierce partie neutre de les aider à aplanir leurs divergences en vue d’arriver à un accord. Certains systèmes de relations professionnelles distinguent, du moins en théorie, la conciliation et la médiation. En pratique, la différence n’est pas évidente et il est difficile de tracer une ligne de démarcation bien nette entre les deux. Le rôle du conciliateur est de rétablir la communication si les pourparlers ont été interrompus, d’aider les parties à trouver un terrain d’entente pour parvenir à un règlement et, peut-être, d’établir certains faits. Toutefois, le conciliateur ne fait aucune proposition formelle pour résoudre le conflit (bien qu’il se cantonne rarement, en pratique, à un rôle aussi passif). Le médiateur est tenu de proposer les conditions d’un règlement, mais les deux parties demeurent libres d’accepter ou de refuser ses propositions. Dans beaucoup de pays, il n’y a pas de véritable distinction entre la conciliation et la médiation: médiateurs et conciliateurs s’emploient les uns comme les autres à aider les parties au litige à trouver une solution, en usant de la stratégie la plus appropriée en l’espèce, tantôt passive, tantôt interventionniste.
La conciliation est l’une des procédures les plus répandues et elle est tenue pour l’une des plus efficaces en matière de règlement de conflits d’intérêts. En cours de négociation collective, on peut envisager la conciliation comme un prolongement des négociations avec l’aide d’une tierce partie neutre. Un nombre croissant de pays recourent aussi à la conciliation dès les premières étapes du règlement des conflits de droits. Le gouvernement peut offrir des services de conciliation ou constituer un organisme indépendant à cet effet. Dans certains pays, les inspecteurs du travail prennent part à la conciliation.
La recommandation (no 92) de l’OIT sur la conciliation et l’arbitrage volontaires, 1951, préconise l’établissement d’organismes de conciliation volontaire, gratuite et rapide, «en vue de contribuer à la prévention et au règlement des conflits de travail entre employeurs et travailleurs» (paragr. 1 et 3). La conciliation vise à garantir l’exercice réel du droit de négocier collectivement, objectif repris à l’article 6,3 de la Charte sociale européenne, adoptée le 10 octobre 1961.
L’arbitrage consiste en l’intervention d’une tierce partie neutre qui, bien que ne faisant pas partie de l’appareil judiciaire établi, est autorisée à imposer une décision. Dans plusieurs pays, la quasi-totalité des conflits de droits se rapportant à l’application ou à l’interprétation de la convention collective sont réglés par voie d’arbitrage exécutoire, parfois après l’échec de la conciliation obligatoire. Dans de nombreux pays, l’arbitrage est facultatif et volontaire, tandis qu’il est obligatoire dans d’autres. Lorsque l’arbitrage est imposé afin de résoudre des conflits d’intérêts, il se limite d’habitude à la fonction publique ou aux services essentiels. Ailleurs, toutefois, notamment dans certains pays en développement, l’arbitrage des conflits d’intérêts est plus généralisé.
La question de l’arbitrage fait l’objet de la recommandation (no 92) de l’OIT sur la conciliation et l’arbitrage volontaires, 1951. Comme dans le cas de la conciliation, cet instrument porte sur les conflits qui sont soumis volontairement à l’arbitrage et recommande aux parties de s’abstenir de recourir à la grève ou au lock-out pendant la durée de l’arbitrage et d’accepter la décision arbitrale. Le caractère volontaire de l’acceptation des conclusions de l’arbitre est également souligné dans la Charte sociale européenne. Si l’une des parties ou les autorités publiques peuvent engager la procédure d’arbitrage, celui-ci est alors réputé obligatoire. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT a déclaré que, dans le cas des conflits d’intérêts, l’arbitrage obligatoire va en général à l’encontre des principes énoncés dans la convention (no 98) de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, parce qu’il porte atteinte à l’autonomie des parties à la négociation (BIT, 1994b). De plus, toute décision arbitrale définitive liant les parties intéressées risque d’être considérée comme limitant de manière déraisonnable le droit de grève si le conflit n’a pas été soumis volontairement à l’arbitrage. La commission a indiqué que pareille interdiction limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (no 87) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (BIT, 1994b, paragr. 153).
L’administration du travail assume dans la plupart des pays des responsabilités variées, dont l’une des plus importantes consiste à inspecter les lieux de travail pour s’assurer qu’ils sont conformes à la législation sur l’emploi, notamment en matière de sécurité et de santé. Il n’est pas nécessaire qu’un conflit de travail éclate pour qu’un inspecteur intervienne. Toutefois, lorsqu’un conflit résulte d’une infraction présumée à la loi ou à la convention, l’inspecteur peut jouer un rôle important dans la recherche d’une solution.
L’administration du travail remplit habituellement une fonction plus active dans les conflits portant sur la sécurité et la santé que dans les autres. Le rôle de l’inspecteur dans les conflits est parfois défini dans les conventions collectives ou dans la législation relative à la sécurité et à la santé, au droit du travail, à la réparation des accidents du travail ou à une branche d’activité. Dans certains pays, le délégué à la sécurité ou le comité d’hygiène et de sécurité sont habilités à porter plainte contre l’employeur auprès de l’inspecteur du travail, d’un autre fonctionnaire de l’administration du travail ou d’un préposé à la sécurité et à la santé. L’inspecteur peut être appelé à intervenir si une partie allègue que la réglementation en matière de prévention n’est pas respectée. L’administration du travail peut également être tenue d’intervenir en raison de sa compétence en vertu des régimes d’indemnisation des travailleurs.
Les inspecteurs peuvent être investis du pouvoir d’ordonner des améliorations, des interdictions ou des arrêts de travail, d’imposer des amendes ou des sanctions, voire d’entamer des poursuites. Le cas échéant, l’action en justice sera intentée devant une instance civile ou pénale selon la nature de l’infraction, la gravité des conséquences, la connaissance préalable des conséquences éventuelles, et la répétition de l’infraction. Normalement, la décision d’un inspecteur peut faire l’objet d’un recours auprès de son supérieur hiérarchique, d’un organe spécialisé dans le domaine du travail ou de la sécurité et de la santé, ou d’un tribunal. Il peut exister des mécanismes distincts de recours administratif ou judiciaire pour les différentes branches d’activité (par exemple, les mines).
Adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1947, la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail encourage la collaboration entre les inspecteurs du travail et les représentants des travailleurs et des employeurs. En 1989, le Conseil des Communautés européennes a adopté la directive 89/391/CEE sur la sécurité et la santé des travailleurs, aux termes de laquelle les travailleurs et leurs représentants ont le droit de faire appel à l’autorité compétente en la matière s’ils ne sont pas convaincus que les mesures prises par l’employeur garantiront la sécurité et la santé au travail. Conformément à la directive, les représentants des travailleurs doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations pendant les visites effectuées par l’autorité compétente (art. 11, 6)).
Comme les conflits juridiques portent sur des droits ou des obligations qui existent déjà, leur règlement est régi par le principe général implicite selon lequel, en dernier ressort, ils relèvent de la compétence des tribunaux ou des arbitres et ne doivent pas être réglés par un recours à l’action directe, comme la grève. Certains pays laissent aux tribunaux ordinaires le soin de trancher tous les conflits de droits, qu’ils portent ou non sur les relations professionnelles. En revanche, dans beaucoup de pays, les tribunaux du travail ou certains tribunaux spécialisés sont saisis de conflits de droits. Ils connaissent des conflits de droits en général ou de certains types de conflits en particulier, par exemple les plaintes pour mesures disciplinaires ou pour licenciement injustifié. Ces organismes judiciaires spécialisés, compétents en matière de droit du travail, répondent à la nécessité de disposer de procédures rapides, peu onéreuses et sans formalités superflues. Les retards et les frais qu’entraîne le système judiciaire ordinaire sont jugés inacceptables lorsqu’il est question d’emploi, question d’une importance capitale pour la vie d’une personne et qui concerne souvent une relation qui doit être maintenue après le règlement du conflit. Il arrive que les tribunaux ordinaires et les tribunaux du travail se répartissent la juridiction en matière de conflits de droits collectifs. Par exemple, dans certains pays, le tribunal du travail peut uniquement trancher les conflits collectifs qui portent sur la violation présumée d’une convention collective, les violations de la loi relevant des tribunaux ordinaires.
Les tribunaux du travail sont souvent composés des représentants des travailleurs et des employeurs et d’un juge indépendant. Il existe aussi des tribunaux du travail formés uniquement de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs. Par cette composition bi- ou tripartite, on veut s’assurer que les membres du tribunal ont une bonne connaissance des relations professionnelles et que, par conséquent, les questions pertinentes seront examinées à fond et résolues en fonction des réalités du monde du travail. Ainsi, les décisions rendues par le tribunal inspireront d’autant plus confiance et seront d’autant plus convaincantes. Les représentants des travailleurs et des employeurs peuvent s’exprimer à égalité pour trancher le conflit, ou encore agir uniquement à titre consultatif. Dans d’autres pays, des juges sans lien avec les parties tranchent les conflits juridiques collectifs.
Dans quelques pays, les tribunaux du travail règlent les conflits collectifs portant sur le droit et sur les intérêts. Le principe évoqué à la section «L’arbitrage» vaut aussi pour les tribunaux: la nature volontaire de la négociation collective est mise à mal dès que le recours à la voie judiciaire est imposé pour régler un conflit d’intérêts.
Un arrêt de travail concerté peut être décidé pour toutes sortes de raisons. Le plus couramment, cette mesure est comprise comme un moyen de pression pour amener l’employeur à accepter certaines conditions, en cas d’impasse de la négociation collective. L’arrêt de travail est tenu pour une grève dans la plupart des pays et considéré normalement comme un moyen légitime à la disposition des travailleurs et de leurs organisations pour promouvoir et protéger leurs intérêts.
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté le 16 décembre 1966) reconnaît à l’article 8, 1) d)) que le droit de grève est un droit fondamental. La Charte sociale européenne, à l’article 6, 4)) associe le droit de grève au droit de négociation collective et déclare que les travailleurs et les employeurs disposent du droit d’action collective dans les cas de conflits d’intérêts, sous réserve des obligations dérivant de la convention collective. La Charte internationale américaine de garanties sociales (adoptée à Bogota le 30 avril 1948), article 27, reconnaît aux travailleurs le droit de faire grève; le droit de grève est donc un élément intrinsèque de la liberté syndicale, au même titre que le droit de négociation collective. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et le Comité de la liberté syndicale, qui relèvent du Conseil d’administration du BIT, reconnaissent que le droit de grève est inhérent aux principes généraux de la liberté syndicale énoncés dans la convention (no 87) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, bien qu’il ne soit pas expressément fait mention du droit de grève dans le texte de la convention. Selon la Commission d’experts, «l’interdiction générale des grèves limite considérablement les possibilités qu’ont les syndicats de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres [...] et le droit qu’ont les syndicats d’organiser leur activité» (BIT, 1994b, paragr. 147).
Dans certains pays, le droit de grève est reconnu au syndicat. Les grèves qui ne sont pas organisées ou autorisées par lui sont considérées comme «non officielles» et illégales. Dans d’autres pays, au contraire, le droit de grève est un droit individuel bien qu’il soit généralement exercé par un groupe, auquel cas la distinction entre grève «officielle» et «non officielle» importe peu.
Même dans les pays où le droit de grève est reconnu en principe, certaines catégories de travailleurs ne peuvent s’en prévaloir, par exemple les membres de la police ou des forces armées, ou encore les hauts fonctionnaires. Il arrive aussi que ce droit soit assujetti à certaines restrictions d’ordre procédural, par exemple l’obligation de donner un préavis ou de tenir un vote sur la grève. Dans plusieurs pays, les parties doivent s’abstenir de déclencher une grève ou d’imposer un lock-out tant que la convention collective est en vigueur, cette interdiction étant absolue ou visant certaines questions réglementées dans la convention. Souvent, l’obligation de «paix sociale» est expressément inscrite dans la législation ou dans les conventions collectives, ou reconnue implicitement par les décisions judiciaires. Dans beaucoup de pays, l’exercice du droit de grève est rigoureusement limité, voire carrément interdit, dans les services essentiels. Cette restriction aux principes généraux de l’OIT est permise à condition que soient tenus pour essentiels uniquement les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité et la santé de la personne (BIT, 1994b, paragr. 159).
Dans le cas des conflits qui portent sur la sécurité et la santé, il faut établir une distinction entre ceux qui concernent la négociation de certains droits (par exemple, la définition des fonctions précises d’un délégué à la sécurité aux fins de la mise en œuvre d’une politique générale en la matière) et ceux qui ont trait à des situations de danger imminent. La législation ou les conventions collectives accordent généralement aux travailleurs le droit d’arrêter le travail en cas de situation dangereuse ou quand ils croient qu’une telle situation existe. Ce droit s’exerce souvent sous la forme d’un droit individuel du travailleur ou des travailleurs directement exposés au risque. Il existe de multiples formules pour justifier un arrêt de travail. La conviction de bonne foi qu’il existe un danger peut suffire, ou bien il faudra peut-être en démontrer objectivement la réalité. Les avis divergent sur le point de savoir qui court un risque: le travailleur menacé d’un danger imminent peut arrêter de travailler, ou encore ce droit peut avoir une portée plus étendue et comprendre le danger pour autrui. En général, les arrêts de travail collectifs par solidarité (grève de solidarité ou de sympathie) ne sont pas prévus dans la législation ou les conventions collectives (et peuvent donc être déclarés illégaux), bien qu’en fait ils existent. Il arrive aussi que le pouvoir d’ordonner l’arrêt des opérations soit dévolu aux délégués à la sécurité dans l’établissement, qui peuvent les interrompre jusqu’à ce que l’administration du travail rende une décision finale.
La convention (no 155) de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dispose en son article 13 que les travailleurs devront être protégés contre toutes conséquences injustifiées s’ils s’écartent du danger lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé. L’article 8, 4) de la directive 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes comporte une disposition analogue — en cas de «danger grave, immédiat et qui ne peut être évité». Souvent, le droit d’interrompre le travail en raison d’un danger imminent est inscrit dans la législation sur la santé et la sécurité. Dans certains pays, ce droit trouve place dans la législation du travail, et l’arrêt de travail imposé pour des raisons de sécurité n’est pas tenu pour une grève; partant, il n’est pas nécessaire de suivre la procédure qui doit précéder une grève et l’obligation de paix sociale n’est pas transgressée. De même, lorsque l’employeur interdit l’accès du lieu de travail pour se conformer à une ordonnance d’arrêt de travail ou lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent pour la sécurité ou la santé, cette action patronale n’est généralement pas tenue pour un lock-out.
Un conflit individuel survient quand il y a désaccord entre un travailleur et son employeur sur un aspect de leur relation d’emploi. Un conflit individuel est un cas typique de «conflit de droits», puisqu’il porte sur l’application des conditions énoncées dans la loi ou dans un accord en vigueur, qu’il s’agisse d’une convention collective ou d’un contrat de travail individuel verbal ou écrit. Le montant du salaire versé ou le mode de paiement utilisé, l’horaire de travail, les conditions de travail, les congés, etc., sont des sujets possibles de litige. Dans le domaine de la sécurité et de la santé, le conflit individuel peut porter sur l’utilisation de l’équipement de protection individuelle, le paiement d’une indemnité supplémentaire pour l’exécution de tâches dangereuses, ou prime de risque (cette pratique est maintenant condamnée en faveur de l’élimination des risques), le refus d’exécuter un travail présentant un danger imminent et l’observation des règles de sécurité et de santé.
Un conflit individuel peut être déclaré par un travailleur qui fait valoir ses droits, réels ou présumés, ou qui conteste la mesure disciplinaire ou le licenciement imposé par l’employeur. Lorsque le litige est identique sur le fond aux plaintes déposées au nom d’autres travailleurs individuels ou qu’il soulève une question de principe importante pour le syndicat, le conflit individuel peut aussi mener à une action collective et, quand l’enjeu réside dans l’obtention de nouveaux droits, le conflit individuel peut se transformer en conflit d’intérêts. Par exemple, le travailleur qui refuse d’accomplir un travail qu’il estime trop dangereux risque une sanction disciplinaire, voire le licenciement; si le syndicat juge que ledit travail expose les autres travailleurs à un danger constant, il s’attaquera peut-être à cette situation en déclenchant une action collective, arrêt de travail compris (par exemple, une grève légale ou sauvage). Il est donc possible qu’un conflit individuel aboutisse à une action collective et devienne ainsi un conflit collectif. De même, le syndicat peut voir dans le litige une question de principe qui, s’il n’y est pas fait droit, le conduira à formuler de nouvelles exigences, ce qui se soldera par un conflit d’intérêts lors de futures négociations.
Le règlement d’un conflit individuel est en grande partie tributaire de trois facteurs: 1) la portée de la protection juridique accordée aux travailleurs dans le pays; 2) le fait que le travailleur soit protégé ou non par une convention collective; 3) la facilité avec laquelle le travailleur peut faire respecter ses droits en vertu de la loi ou aux termes d’une convention collective.
Malgré tout, certains droits individuels sont universels dans la plupart des pays, quelles que soient la durée de l’engagement ou la taille de l’entreprise. Au nombre de ces droits figure normalement la protection des travailleurs contre les représailles lorsqu’ils exercent une activité syndicale ou lorsqu’ils dénoncent aux autorités une violation présumée de la loi par leur employeur; dans ce dernier cas, il s’agit de la protection accordée à la personne «qui tire la sonnette d’alarme» et divulgue certaines informations. Dans la plupart des pays, la loi confère à tous les travailleurs une protection contre la discrimination fondée sur la race ou le sexe (y compris la grossesse) et, dans bien des cas, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, l’état matrimonial et les responsabilités familiales. Ces motifs énumérés dans la convention (no 158) de l’OIT sur le licenciement, 1982, sont considérés comme ne constituant pas des motifs valables de licenciement; la convention en ajoute d’autres: l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales; le fait de solliciter, d’exercer ou d’avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs; le fait d’avoir déposé une plainte, ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou d’avoir présenté un recours devant les autorités administratives. De toute évidence, ces trois derniers motifs non admis sont particulièrement pertinents pour la protection des droits des travailleurs à la sécurité et à la santé. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT a mis en relief la gravité des mesures de représailles, notamment sous forme de licenciement, contre un travailleur qui aurait dénoncé la non-application, par son employeur, de règles en matière de sécurité et d’hygiène du travail alors que l’intégrité physique des travailleurs, leur santé, leur vie même pouvaient être mises en danger. Lorsque des droits fondamentaux ou l’intégrité physique ou la vie des travailleurs sont en jeu, il serait souhaitable que les modalités de preuve (renversement de la charge de la preuve) et les mesures de réparation (réintégration) soient de nature à permettre aux travailleurs de dénoncer les pratiques illégales sans crainte de représailles (BIT, 1995c).
Cependant, pour ce qui est du maintien en emploi du travailleur, les deux déterminants principaux des droits de cette personne sont, d’une part, le mécanisme d’application de la loi dont elle dispose pour faire valoir ses droits et, d’autre part, le type de contrat de travail aux termes duquel elle a été embauchée. En général, plus la durée de l’engagement est longue, meilleure est la protection. Ainsi, un travailleur en période d’essai (quelques mois dans la plupart des pays) sera peu protégé contre le licenciement, voire pas du tout. Il en va de même du travailleur occasionnel (embauché à la journée) et du travailleur saisonnier (engagé pour une période limitée, chaque année à la même époque). Le travailleur bénéficiant d’un contrat de travail de durée déterminée sera protégé pendant la durée du contrat, mais en règle générale, sans droit de reconduction. Par comparaison, la situation des travailleurs embauchés aux termes d’un contrat de travail de durée indéterminée est la plus sûre, mais ces travailleurs peuvent quand même être licenciés pour des raisons particulières ou, plus généralement, pour ce que l’on qualifie de «faute grave». De plus, leurs postes peuvent être supprimés lors d’une restructuration de l’entreprise. Vu les pressions croissantes pour la flexibilité du marché du travail, la tendance la plus récente de la législation régissant les contrats de travail accorde plus de facilité aux employeurs désireux de «dégraisser l’effectif» au cours d’une restructuration. En outre, de nouvelles formes de relations de travail hors du cadre traditionnel employeur-salarié sont apparues; or, dans ces cas-là, le travailleur individuel sans statut risque d’être peu protégé par la loi.
Un conflit individuel peut souvent découler du refus d’un salarié d’exécuter un travail qui, à son avis, présente un risque imminent; il doit avoir des motifs raisonnables de croire à l’existence de ce risque et agir de bonne foi. Aux Etats-Unis, le travailleur doit avoir des motifs raisonnables de croire que l’exécution du travail constitue un danger imminent de mort ou de lésion corporelle grave. Dans certains pays, ce droit fait l’objet de la négociation collective; dans d’autres, il découle de la loi ou des interprétations des tribunaux. Malheureusement, ce droit important n’est pas encore universellement reconnu, bien qu’il soit énoncé en tant que principe fondamental à l’article 13 de la convention (no 155) de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Même quand ce droit est inscrit dans la loi, les salariés qui l’exercent peuvent redouter des représailles ou la perte de leur emploi, surtout s’ils ne sont pas soutenus par un syndicat ou des services d’inspection du travail efficaces.
Le droit de refuser un travail dangereux est normalement assorti du devoir de signaler immédiatement cette situation à l’employeur et, parfois, d’informer le comité paritaire de sécurité. Tant que le problème n’est pas réglé, l’employeur ne doit (ré)affecter à ce travail ni le travailleur qui a refusé de l’exécuter ni une autre personne à sa place. Si l’employeur passe outre à cette interdiction et qu’un travailleur est victime d’un accident, l’employeur peut être légalement passible de graves sanctions civiles et pénales (comme en France et au Venezuela). Au Canada, le travailleur qui refuse d’accomplir un travail dangereux et le délégué à la sécurité ont le droit d’être présents lorsque l’employeur entreprend une enquête sur place. Si le travailleur refuse toujours d’exécuter le travail après que l’employeur a pris des mesures correctives, une inspection gouvernementale accélérée peut être effectuée. L’employeur n’est pas en droit d’exiger que le salarié exécute ce travail, jusqu’à ce que l’autorité gouvernementale rende sa décision à la suite de l’inspection. De plus, l’employeur est censé donner au travailleur une autre affectation, de manière à ce que ce dernier ne subisse pas de perte de salaire. Quiconque est désigné pour exécuter le travail à la place du salarié qui a refusé de l’accomplir doit être mis au courant du refus de celui-ci.
La reconnaissance du droit de refuser un travail dangereux constitue une exception importante à la règle générale voulant que, d’une part, l’employeur attribue le travail et l’employé l’exécute et, d’autre part, que l’employé n’abandonne pas son poste et ne refuse pas de se conformer aux instructions de l’employeur. La justification conceptuelle du droit de refus réside dans l’urgence de la situation et dans la présence d’intérêts d’ordre public visant à sauver des vies (Bousiges, 1991; Renaud et Saint-Jacques, 1986).
La participation d’un travailleur à une grève pour protester contre des conditions de travail dangereuses est une autre source de conflit individuel. Le sort du travailleur dépendra de la légalité de l’arrêt de travail et de la mesure dans laquelle le droit de grève est garanti en l’espèce. Il ne s’agit pas seulement de la situation du droit de grève en tant que droit collectif, mais aussi de la façon dont le système juridique interprète la décision de se retirer du travail. Dans bon nombre de pays, faire la grève constitue une rupture du contrat de travail par le salarié. Que cette rupture soit pardonnée ou non dépend du rapport de forces entre le syndicat et l’employeur et, éventuellement, le gouvernement. Le travailleur assuré d’un solide droit de grève théorique, mais susceptible d’être remplacé de façon temporaire ou permanente, hésitera à en faire usage par crainte de perdre son emploi. Dans d’autres pays, la loi interdit explicitement le licenciement pour participation à une grève légale (Finlande, France).
Les moyens permettant de régler un conflit individuel sont généralement les mêmes que ceux dont on dispose pour régler les conflits collectifs. Cependant, les divers systèmes de relations professionnelles abordent chacun la question sous un angle différent. Dans certains pays (Allemagne, Israël, Lesotho et Namibie), les tribunaux du travail ont compétence pour résoudre les conflits collectifs et individuels. Les tribunaux du travail au Danemark et en Norvège connaissent uniquement des conflits collectifs, les plaintes des travailleurs individuels étant du ressort exclusif des tribunaux civils ordinaires. Dans d’autres pays, notamment en France et au Royaume-Uni, des mécanismes spéciaux sont réservés au règlement des conflits entre les travailleurs individuels et leurs employeurs. Aux Etats-Unis, les individus ont le droit d’intenter des poursuites pour discrimination illégale dans l’emploi devant des organes distincts de ceux qui sont saisis de pratiques de travail déloyales. Cependant, en milieu de travail non syndiqué et malgré les critiques des praticiens du monde du travail, l’arbitrage des conflits individuels à l’initiative de l’employeur est favorablement accueilli. En milieu de travail organisé, le syndicat peut donner suite au grief d’un travailleur protégé par une convention collective qui, habituellement, renvoie le conflit à l’arbitrage volontaire. La capacité d’un individu d’obtenir gain de cause est souvent tributaire de l’accès à des procédures équitables, rapides et d’un coût abordable, ainsi que de l’appui d’un syndicat ou d’un service d’inspection du travail compétent sur lequel il peut compter.